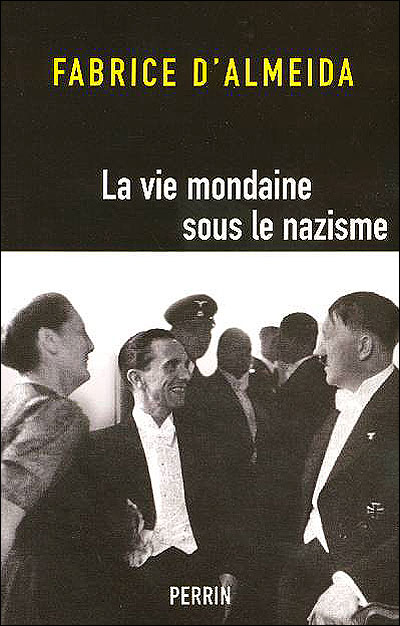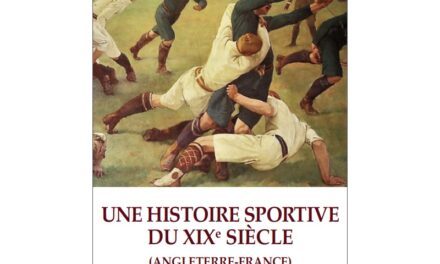Sous un titre qui pourrait paraître – bien à tort – léger, l’ouvrage de Fabrice d’Almeida est centré sur les relations entre la haute société allemande et les dirigeants nazis. Sujet crucial, car il touche à ce que l’auteur désigne comme « l’énigme la plus grande du national-socialisme », à savoir : « La juxtaposition d’une société qui se croit héritière des plus hautes valeurs de la culture avec le déchaînement d’une barbarie génocidaire » (p. 11). La question méritait un examen d’autant plus attentif que l’historiographie du nazisme a longtemps été dominée par la confrontation entre d’une part une vision se revendiquant du marxisme, tendant à réduire Hitler et ses comparses à des instruments – éventuellement indociles – du « grand Capital » allemand, et d’autre part une interprétation « libérale » pour laquelle la dynamique sociale du nazisme prenait appui sur la panique de classes moyennes menacées par la prolétarisation. Les deux approches ne laissaient finalement qu’une place secondaire ou subordonnée à la question du comportement des élites sociales.
Les relations entre celles-ci et les dirigeants nazis sont au contraire envisagées sous tous leurs aspects par Fabrice D’Almeida. Il s’attache notamment aux questions de sociabilité et aux convergences de représentations. La sociabilité mondaine vient initialement contribuer à combler le fossé entre les options jugées en général extrémistes d’Hitler et les aspirations de la haute société à une solution politique autoritaire et hiérarchique. Plus encore, elle est un élément de solidarité d’un groupe dirigeant dont l’identité sociale était peu cohérente. On ne peut s’étonner, dans ces conditions, de l’importance donnée par Hitler aux réceptions, visites, cadeaux et gratifications de toutes sortes impliquant les mondains. Fabrice d’Almeida analyse avec une grande précision les structures matérielles mises en place par le pouvoir pour développer et encadrer les manifestations mondaines. Il donne une interprétation convaincante du système de dons impulsé par Hitler dans la haute société dès lors que l’accès au pouvoir le place au centre d’un système clientéliste. Il ne laisse pas de côté l’analyse des systèmes comparables mis en place par Himmler dans la SS, ou par un dirigeant comme Goering, rouage essentiel du jeu mondain du nazisme. Goebbels s’attache lui à faire obtenir à certains des artistes qu’il reçoit de substantielles exemptions fiscales, dans une logique de gratification personnelle, sans mesure d’ensemble, et dans un but de sujétion. Ce faisant, le livre ramène aux travaux antérieurs qui soulignaient la multitude et la rivalité des lieux de pouvoir sous la dictature nazie.
La fécondité de la démarche de l’auteur lui permet justement de confirmer et de préciser des caractéristiques d’ensemble du régime nazi. Ainsi de la violence extrême du système. La destruction de la haute société juive ne se réduit pas à l’application de l’antisémitisme à un segment social particulier. Son étude permet de montrer qu’elle a constitué à la fois un des moyens privilégiés par les dirigeants nazis pour mettre en œuvre l’élimination de l’ensemble des Juifs d’Allemagne, et un des critères de sélection de la haute société, de ses membres et de ses institutions, jugés par Hitler et ses sbires à l’aune de leur assentiment à l’antisémitisme radical. On touche ici à la question du « travail de mise en cohésion des élites » (p. 226) à ses objectifs par le régime. Les vastes parties de chasse, organisées notamment par le « Grand Veneur » Goering, outre les gratifications apportées aux mondains invités et les occasions d’échanges personnalisés entre représentants des élites sociales et dirigeants nazis qu’elles multiplient, sont aussi des mises en scène des valeurs idéologiques du régime : prédominance virile, goût de la traque et de la mise à mort dans un parallèle quasi explicite avec la guerre, exaltation du « chasseur nordique » – Goering va jusqu’à introduire des troupeaux d’élans dans ses domaines de chasse – et de son milieu de vie sylvestre. L’étude minutieuse des rapports du pouvoir nazi aux usages diplomatiques, lesquels survalorisent la vie mondaine, montre que les responsables de cette administration, y compris les chefs du protocole, ont joué un rôle actif dans la mise en œuvre concrète du projet nazi. Ils sont même parfois en position d’initiative, comme s’ils avaient d’emblée intégré ce projet de domination, ou au moins les moyens d’y parvenir, ce alors que les notes internes du ministère des affaires étrangères permettaient à ces élégants diplomates de suivre le déroulement des entreprises génocidaires qui accompagnaient les conquêtes. La guerre souligne ce lien entre violence nazie et vie mondaine. Elle entraîne une intensification du système de dons et de gratifications mis en place par Hitler, système désormais nourri par les spoliations et l’aryanisation économique et qui prend ainsi une dimension clanique de partage du butin. De manière significative, Himmler et les dirigeants SS ne répugnent pas à offrir des objets fabriqués dans les camps.
Un autre thème connu, celui du nouveau découpage public/privé institué par le totalitarisme nazi, est aussi brillamment éclairé. Fabrice d’Almeida repère ainsi un net déclin des salons de la haute société qui ont évidemment perdu toute fonction politique et font l’objet d’un désintérêt de la part des grandes dames du régime alors que les jeunes mondains sont aspirés par le parti et ses activités. Ils témoignent ainsi d’un « glissement progressif vers l’action publique qui entrave les sociabilités privées » (p. 202). Dans un autre registre, la dictature totalitaire modifie la place des domestiques, notamment de ceux des hauts dirigeants, ne serait-ce que par leur connaissance des secrets d’Etat, dans le cadre du modèle de cour déjà évoqué.
Sur ces bases, la question des réfractaires au sein des élites sociales au travail de modelage entrepris par les dirigeants nazis peut être abordée avec une grande finesse. Hitler et ses adjoints anticipent les difficultés et tiennent compte des valeurs spécifiques du groupe. L’investissement du monde des courses hippiques constitue une sorte de contrepoint au développement par les nazis des sports de masse. Concernant les bals et réceptions, l’entreprise d’aryanisation de la musique de danse tient compte des réticences des mondains à l’égard de danses folkloriques « allemandes » jugées vulgaires. L’auteur relève aussi qu’en matière de tenue vestimentaire, qui n’est en rien anodine pour les autorités nazies, la haute société manifeste son attachement aux canons de la mode internationale. Reste que les réactions de rejet ou de refus du régime dans la haute société furent très minoritaires, tardives et dues pour l’essentiel à l’évidence de la défaite.
L’auteur excelle à insérer des fragments d’itinéraires individuels dans ses analyses d’ensemble. Il tord le cou au passage à des poncifs récurrents sur le nazisme, comme sa prétendue obsession sexuelle, alors que le régime institua, avec sa violence habituelle, un redoutable ordre moral. Basé à la fois sur une remarquable maîtrise de l’énorme bibliographie disponible, l’exploitation habile d’archives variées et la plus grande rigueur problématique, La Vie mondaine sous le nazisme est un excellent livre d’histoire sociale et culturelle. Il comporte une riche bibliographie qui va à l’essentiel, des annexes éclairantes et un index très bien construit.
CR par Benoit Marpeau, université de Caen Basse-Normandie