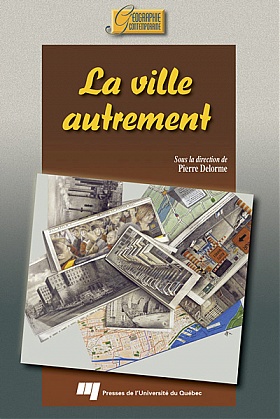
La préparation de la table ronde « La France en villes : que sera demain ? », qui se tiendra le 5 février 2011 à l’espace des Blancs Manteaux dans le cadre du Salon du livre de Sciences Humaines, légitime la parution d’un compte-rendu d’un livre sorti en 2005 aux PUQ.
Pierre Delorme, titulaire d’un doctorat en science politique, professeur au département d’études urbaines et touristiques à l’université du Québec à Montréal a réuni pour cet ouvrage une quinzaine d’auteurs issus de disciplines très variées. Il faut dire que la ville est un objet polysémique qui intéresse à la fois les sociologues, les politologues, les urbanistes, les économistes et les historiens, sans oublier les géographes.
La manière de penser la ville a évolué au cours du temps. Le premier chapitre de la partie Penser la ville, rédigé par Pierre Delorme, retient particulièrement l’attention car il permet de faire le bilan des évolutions épistémologiques de l’objet ville. Il rappelle le rôle qu’a joué la sociologie, « la science la plus apte à comprendre la ville » (sic) sur la ville dans le cadre de l’Ecole de Chicago. L’Ecologie urbaine s’inspire des travaux des biologistes qui étudient les êtres vivants dans leur interdépendance et dans leur rapport à l’environnement. Cette manière de voir la ville débouche sur l’étude des rapports entre industrialisation et urbanisation mais aussi sur le contrôle des forces sociales et économiques sur la ville qui prend la forme, dans la sociologie française, d’une analyse marxiste de la recherche urbaine. Henri Lefebvre (Le droit à la ville, la production de l’espace) comme Manuel Castells en sont les représentants. Castells voit la ville comme un système organisé par l’Etat (avant de la voir, ces dernières années, comme le lieu des réseaux). Cette approche a conduit la recherche à s’orienter vers l’analyse des politiques publiques qui a abouti à mettre sur le devant de la scène la notion de gouvernance. Delorme montre aussi que l’imaginaire urbain tient une place de plus en plus importante dans la manière d’analyser la ville. Comme le disaient en substance Jean-Jacques Rousseau ou Corneluis Castoriadis, si les hommes construisent la ville, ce sont bien les citoyens qui la font. Cette approche épistémologique trouve dans les articles suivants des éléments de complément. Le concept de sociabilité permet d’étudier « la relation symbolique ou réelle, de soi avec autrui ou avec son environnement, avec sa ville ». Cet attachement peut d’ailleurs être marqué dans le paysage comme le montre les travaux de Sylvie Paré sur les rapports entre groupes ethniques et environnements urbains. Les lieux de réunion (bistrots, parcs, lieux sportifs…) sont des lieux centraux de sociabilité, même si la solitude urbaine n’est pas pour autant niée.
La manière de gérer la ville est l’objet de la seconde partie intitulée Vivre la ville. Des études empiriques ont été menées sur le renouvellement du personnel politique au fil des élections municipales mais aussi sur la place des zones franches dans la ville. A contre-courant des thèses de Mike (Planète bidonvilles, 2005 ou Le pire des mondes possibles, de l’explosion urbaine au bidonville global, 2006), Jean Goulet montre que les bidonvilles sont des espaces urbains plus structurés qu’il n’y paraît. Il montre cela à partir d’une étude menée dans les bidonvilles d’Haïti en 2003. La question des mobilités est aussi analysée. Luc-Normand Tellier montre que cette question est intimement liée à celle de l’impôt. Pour lui, au lieu de taxer le foncier, il faut taxer les mobilités en mettant en place des péages urbains. En inversant la donne, on réduira les mobilités génératrices de pollution et d’étalement urbain. Car, en France comme au Québec, la maîtrise de l’étalement urbain est loin d’être parfaite. Vingt cinq ans après la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, qui devait instaurer la décentralisation du pouvoir aux collectivités locales, il apparaît que les dérives technocratiques de la loi ont accru les lourdeurs administratives plutôt que de permettre un développement régional efficient. Par ailleurs, la ville n’est pas vue comme une entité qui fonctionnerait seule mais comme le reflet de la mondialisation. « La production et la distribution de richesses, la prospérité et la paupérisation, la dynamique des réseaux sociaux ne peuvent être explorés sans considérer l’intégration économique mondiale et les effets sur la transformation de nos milieux de vie ».
Le nombre important de participants à cet ouvrage, comme le titre un peu « fourre-tout », est responsable d’un manque d’unité de l’ensemble. La diversité des textes est extrême. Certains sont très pessimistes, comme le texte de Carolle Simard sur les incivilités ou celui du philosophe Christian Saint-Germain sur la solitude urbaine. « Les villes modernes n’existent pas pour abriter des hommes. Elles sont des ruches d’illusion pour la conscience nomade. » D’autres textes sont optimistes comme celui de Michel Maffesoli avec son idée de « reliance », inspirée de la « médiance » d’Augustin Berque. La diversité est telle que l’absence de conclusion à l’ouvrage peut, peut être, s’expliquer par le désarroi du directeur de publication face à des contributions aussi variées. C’est du moins l’impression que l’on a quand on ferme le volume.













