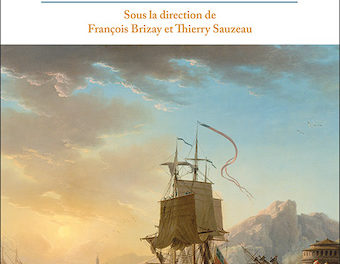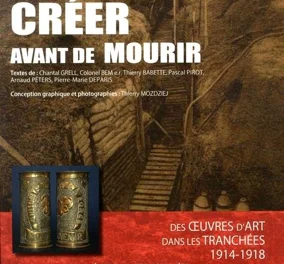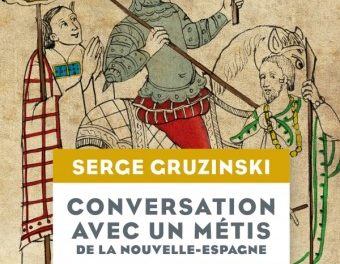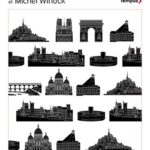L’Afrique du Sud est née au Cap. Deux faits l’indiquent : le 7 avril 1652, sous l’égide du commandeur hollandais Jan van Riebeeck, était fondé le premier établissement européen de la pointe Sud du continent africain, au pied de la montagne de la Table, embryon de la ville du Cap; le 11 février 1990, tout récemment libéré de sa dernière prison de Verster, Nelson Mandela prononçait son premier discours au balcon de l’hôtel de ville du Cap, annonçant la nouvelle Afrique du Sud post-apartheid pour laquelle il s’était tant battu.
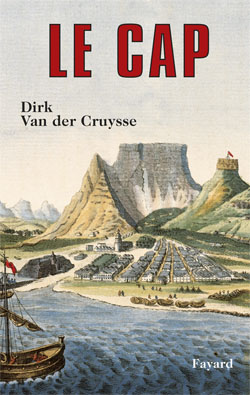
Dirk van der Cruysse nous emmène dans une belle promenade à travers l’histoire de cette ville « coincée » entre la montagne et la baie de la Table, à 50 kilomètres au nord du Cap de Bonne-Espérance. Professeur émérite de l’université d’Anvers, spécialiste, entre autres, de la littérature de voyages à l’époque moderne, il a notamment publié Louis XIV et le Siam, Le Noble désir de courir le monde. Voyager en Asie au XVIIe siècle ainsi que des éditions critiques de relations de voyageurs français, comme Le Journal du voyage de Siam de François-Timoléon de Choisy ou Le Voyage des Grandes Indes Orientales de Jean Guidon de Chambelle. C’est dire si sa spécialité ne le prédisposait guère à écrire l’histoire d’une ville. Mais l’auteur, au fil de ses recherches, s’est pris de passion pour Le Cap et son histoire. Son livre s’inscrit dans une collection (Histoire des grandes villes du monde) qui a à son actif de belles œuvres, dont l’une des plus magistrales est sans l’ombre d’un doute l’Histoire de Mexico de Serge Gruzinski. La somme publiée par Dirk van der Cruysse, quoique fort bien écrite, n’a ni le souffle ni l’originalité du volume consacré à Mexico, mais elle est de lecture fort agréable et apprend beaucoup, c’est bien là l’essentiel.
Structuré en 5 parties et 18 chapitres, l’ouvrage se veut la chronique d’une ville qui vit et se développe selon les rythmes que lui imposent les cadres dans lesquels elle s’insère pendant plus de trois siècles : la VOC (la Compagnie hollandaise des Indes orientales), l’Empire britannique et l’Afrique du Sud, devenue indépendante en 1961.
La pointe Sud de l’Afrique fut dépassée en 1488 par l’expédition conduite par le Portugais Dias, mais c’est sur le chemin du retour que le cap fut découvert par ce dernier qui en prit possession au nom du roi du Portugal et le baptisa « Cabo das Tormentas »; il fallut attendre la période hollandaise pour qu’on l’appelle « Cap de Bonne-Espérance ». Les Portugais, traumatisés par le massacre par les autochtones (Khoikhoi ou « Hottentots ») de Francisco de Almeida, premier vice-roi de l’Estado da India (l’Empire portugais d’Asie), privilégièrent l’escale du Mozambique au départ ou au retour de Goa, la capitale de cet empire. Il n’en reste pas moins qu’un Portugais, Antonio de Saldanha, fut en 1503 le premier Européen à gravir la montagne de la Table; quant à la baie du même nom, baptisée ainsi en 1601 par le navigateur hollandais van Spilbergen, elle était connue au XVIè siècle comme la baie de Saldanha (Saldanha n’a jamais mis les pieds dans l’actuelle baie qui porte son nom…).
Les Hollandais, qui mouillaient fréquemment dans la baie dans les premiers temps du XVIIè siècle, comptaient, semble-t-il, y établir une station de rafraîchissement, à mi-chemin entre la Hollande et Batavia. En 1616, les Heeren XVII, les Seigneurs qui dirigeaient la VOC, imposèrent à leurs flottes de se ravitailler dans la baie de la Table, à l’aller, et de relâcher à Sainte-Hélène au retour. Ils finirent par y fonder une station de ravitaillement fortifiée. Fondation techniquement illégale, note l’auteur, car l’endroit faisait partie du territoire concédé à la WIC (la Compagnie hollandaise des Indes occidentales).
L’établissement officiellement fondé en 1652 par le commandeur Jan van Riebeeck prit progressivement forme : un fort de terre, puis de pierre (1666), fut édifié; un Jardin de la Compagnie (Kompanjiestuijn), potager et fruitier, fut aménagé; des plants de vignes furent introduits qui débouchèrent sur une première pression en 1659; des esclaves africains furent importés, dont les trois-quarts étaient affectés aux travaux du Jardin de la Compagnie; une communauté d’agriculteurs et de fermiers blancs se constitua, occupant les meilleures terres des Khoi…
Un fort de terre et de pierre
Lorsque van Riebeeck quitta Le Cap en 1662 pour l’Asie, la colonie (depuis 1657) n’avait pas encore les allures d’une « ville », ce terme n’étant employé pour la première fois dans un document public qu’en janvier 1687. Ce vlek (bourg), parcouru par un réseau de canaux, avec digues, écluses et ponts, comme à Amsterdam, était organisé suivant un plan en damier : de passage au Cap, en 1836, Darwin notait ainsi que la ville du Cap était « conçue avec la précision rectangulaire d’une ville espagnole » (cité p. 280), mais à l’époque le comblement des canaux était déjà bien avancé.
L’un des successeurs de Jan van Riebeeck, Simon van der Stel (1679-1699), « s’impose comme le plus visionnaire et le plus entreprenant de tous les gouverneurs hollandais du Cap. » (p. 166) Il marqua notamment l’histoire de la région par la fondation de Stellenbosch et du domaine viticole de Constantia, dont le gouvernement du Cap fit l’acquisition en 1885 et qui trône aujourd’hui parmi les sites touristiques de marque de la région. Par ailleurs, il encouragea au début une immigration française huguenote, mais l’expérience tourna court face au refus des huguenots d’abandonner leur langue. Au terme de son mandat, la colonie se nourrissait désormais par ses propres moyens, fournissait les flottes de passage et exportait des excédents à Batavia. Quant à son fils, Willem Adriaan van der Stel, qui lui succéda (1699-1707), son action est notable, malgré les abus et les exactions dont se lassèrent les colons et qui provoquèrent son rappel en Hollande : plantation de plusieurs dizaines de milliers de chênes dans la région pour couvrir les besoins en bois des charpentiers et des cuisiniers notamment, construction d’une jetée en bois et de la Groote Kerk, la plus ancienne église d’Afrique du Sud.
La colonie continua de se développer au XVIIIè siècle : l’urbanisation s’étendit en direction des pentes de la montagne de la Table, l’importation d’esclaves se poursuivit à bon train et la population augmenta nettement. À la mort du gouverneur « autoritaire et éclairé » (p. 190), Ryk Tulbagh (1751-1771), la colonie du Cap comptait un peu plus de 8000 colons et bourgeois pour près de 9000 esclaves.
Les années 1790 allaient voir la colonie s’émanciper complètement de la tutelle de la VOC : « Lorsque [le gouverneur] van de Graaff fut rappelé en 1791, la VOC entrait dans la dernière phase de son existence bicentenaire. La régression du commerce asiatique, une dette écrasante et les frais considérables qu’entraînait la défense de ses possessions en Asie et au Cap sonnèrent le glas de l’ ‘Honorable Compagnie’, autrefois si puissante mais à présent exsangue.[…] On proposa une nouvelle lecture de l’acronyme VOC : ‘Vergaan Onder Corruptie’,
Prise par les Anglais
Ruinée par la corruption. » (p. 219) À la fin de 1795, la jeune République batave prenait un « Décret d’extinction de l’actuelle direction de la VOC » qui, dans les faits, nationalisait la Compagnie. Les Anglais qui, la même année, avaient pris Le Cap, en firent une colonie « de la Couronne », possession ratifiée au Congrès de Vienne, après le court intermède hollandais des années 1803-1806.
Le premier gouverneur anglais du Cap s’installa au « Tuynhuys », la résidence des gouverneurs hollandais édifiée dans le Jardin de la Compagnie, devenu au cours du XVIIIè siècle un jardin botanique qui faisait l’admiration des nombreux visiteurs de passage (l’abbé de La Caille, Bougainville ou Bernardin de Saint-Pierre). Le « Tuynhuys » fut rebaptisé « Government House »; ultérieurement agrandi et remodelé, il sert actuellement de résidence au président de l’Afrique du Sud.
La ville qui s’était appelée Kaapstad du temps des Hollandais fut rebaptisée Capetown, avant qu’en 1930 on ne la baptise Cape Town. La ville et la société s’anglicisèrent progressivement. En effet, l’immigration britannique fut encouragée, la langue anglaise devint en 1827 la seule langue administrative admise, l’empreinte du passé hollandais sur l’architecture de la ville s’estompa, comme le note un savant austro-hongrois en 1857 : « L’élément anglais, avec ses coutumes et lois stéréotypes imposées partout où il pénètre, a refoulé entièrement dans la capitale l’élément hollandais plus ancien, qui ne se maintient obstinément que dans les fermes isolées dans l’intérieur de la colonie. C’est à peine si l’on peut encore voir que la ville du Cap a été fondée par des Hollandais. » (cité p. 303) Mais, comme le souligne Dirk van der Cruysse, au début du XXe siècle, l’élite, blanche, britannique et afrikaner, souhaita « renouer avec un passé architectural hollandais négligé et en grande partie effacé à l’époque victorienne, l’architecture ‘Cape Dutch’, avec ses toits de chaumes, ses façades symétriques badigeonnées et ses élégants pignons aux courbes convexes et concaves. » (p. 383) L’un des plus beaux exemples de cette architecture « Cape Dutch » revisitée est fourni par la résidence de Groote Schuur à Rondebosch que Cecil Rhodes, un temps Premier ministre du Cap, commanda à l’architecte Herbert Baker.
Le 1er décembre 1834, l’esclavage fut officiellement aboli dans la colonie du Cap : « Lorsque, dans la bonne ville du Cap, les cloches sonnèrent minuit le 1er décembre, des feux de joie furent allumés sur la montagne de la Table, et un feu d’artifice au-dessus de la baie célébra la fin officielle de l’esclavage.[…] Comme aller pieds nus était le signe distinctif des esclaves, les affranchis s’étaient tous arrangés pour trouver des sandales ou des chaussures. » (pp. 277-278) Le passé de la colonie avait fait de la ville un lieu de métissage : la société captonienne était très bigarrée; un créole servait d’idiome vernaculaire, le melayu, devenu l’afrikaans, cette langue distincte du néerlandais et nourrie d’éléments empruntés aux parlers des populations diverses installées au Cap au fil du temps. Par ailleurs, sous la domination anglaise la société se diversifia sur le plan religieux: à l’arrivée des Anglais, seule la religion réformée calviniste était admise; par la suite, les différentes expressions de la foi chrétienne trouvèrent à s’exprimer, tel que l’anglicanisme, ainsi que d’autres confessions, comme le judaïsme (avec la première synagogue d’Afrique du Sud inaugurée en 1863) et l’islam, porté par la communauté malaise, installée dans le quartier de Bo-Kaap.
Au cours du XIXe siècle, la colonie du Cap ne cessa de s’étendre vers l’Est, ce qui contribua à dissocier de plus en plus la colonie de la ville proprement dite. L’extension de la colonie et les « guerres des Cafres » qui en découlèrent conduisirent le gouvernement colonial à prendre ses distances avec les affaires propres à la ville du Cap : la création d’un gouvernement municipal en 1840 permit donc aux élites urbaines de s’illustrer dans la gestion de la ville. Mais le suffrage censitaire ne donnait pas le pouvoir aux plus compétents, comme allait le montrer la lancinante question du mauvais entretien de la ville dénoncé régulièrement par la presse. Le gouvernement accorda par ailleurs à la colonie une constitution (1853) dotant notamment Le Cap d’une Chambre des Communes élue au suffrage censitaire, à côté d’un Conseil législatif, équivalent de la Chambre des Lords. Allaient suivre l’instauration d’un gouvernement « responsable » et d’un Premier ministre, dont le premier titulaire de la fonction fut le banquier John Molteno.
La découverte d’or et de diamants entraîna une véritable « révolution minérale » qui draîna une forte immigration, d’origine à la fois européenne et africaine, et d’importantes rentrées fiscales qui contribuèrent, selon l’appréciation d’un observateur, à « la métamorphose d’un trou provincial endormi en une ville florissante. » (cité p. 324).
Restrictions raciales
La population de la ville augmenta considérablement pour atteindre quelque 170000 habitants au début du XXè siècle. La ville se modernisa, avec l’inauguration en 1870 d’un port, qui n’allait cesser de s’étendre par la suite, la construction de la gare victorienne, l’introduction du télégraphe, de l’électricité, le développement de l’activité industrielle et commerciale, la mise en place d’un réseau d’égouts digne de ce nom. Parallèlement, des formes de ségrégation raciale commençaient à prendre racine : ainsi, « les Captoniens blancs qui en avaient les moyens [avaient] tendance à délaisser le centre pour s’installer dans de nouveaux faubourgs verts sur les versants nord et sud de la Table […], où des restrictions raciales étaient inscrites dans les actes de propriété » (p. 339); Ndabeni devint le premier township du Cap où étaient relégués des milliers de travailleurs noirs immigrés du Transkei, jugés indésirables en ville; le Morality Act de 1902 qui ordonnait la fermeture des nombreux bordels et tripots de la ville interdisait dans le même temps formellement les rapports sexuels entre hommes noirs et femmes blanches… Dans la nouvelle Union de l’Afrique du Sud, née en 1910, la ségrégation spatiale ne cessait de gagner du terrain. L’auteur résume bien la situation : « En 1940, pour la première fois depuis le début du XIXè siècle, le nombre des habitants noirs de la ville et de ses faubourgs dépassa celui de la population blanche. La guerre entraîna un fort accroissement démographique. […] Les immigrés blancs, des Afrikaners appauvris ou des Européens chassés par la guerre, se retrouvaient dans le District Six ou dans des quartiers ouvriers plus éloignés du centre, comme Woodstock ou Salt River. Les immigrés noirs se contentaient le plus souvent d’habitations de fortune dans les bidonvilles qui foisonnaient au sud-est de la ville. » (pp. 394-395) Les chapitres 13, 14 et 15 qui couvrent la période 1872-1947 foisonnent d’exemples qui confortent ce propos de l’auteur : « L’idéologie de l’apartheid n’est pas tombée du ciel un beau jour. Elle couvait depuis longtemps dans les replis de la très complexe société sud-africaine. » (p. 401)
La cinquième et dernière partie est d’ailleurs consacrée à la ville du Cap au temps de la domination du NP, le Parti nationaliste, arrivé au pouvoir en 1948. L’apartheid fut systématisé : « du berceau au tombeau, les différents groupes ethniques étaient condamnés à vivre et à mourir dans des espaces cloisonnés » (p. 428), formule qu’illustre tragiquement le Group Areas Act (loi sur les zones résidentielles exclusives) de 1950. Un Captonien sur trois vivait dans des zones urbaines mixtes, il fallait donc que, pour les architectes de l’apartheid, cette situation cesse : ainsi, le District Six, l’un des quartiers emblématiques de l’histoire métissée du Cap, fut décrété « zone banche » en 1965; ses habitants furent alors déportés loin de de là, à Bonteheuvel, l’un de ces vastes ghettos des Cape Flats désolés de la périphérie. Mais si le District Six fut rasé, il resta finalement inoccupé, « blessure au coeur de la ville la plus tolérante d’Afrique du Sud. » (p. 422)
La ville résista à sa manière : le boycott des célébrations du tricentenaire du débarquement de Jan van Riebeeck (1952) fut assez efficace et les manifestations organisées contre l’apartheid furent soutenues par des archevêques anglicans de poids, comme Geoffrey Clayton et Desmond Tutu. La municipalité du Cap fut également la première à abolir la ségrégation dans les autobus qui circulaient en ville ou à ouvrir les plages à tout le monde.
L’élection en 1994 de Nelson Mandela à la présidence de la nouvelle Afrique du Sud, multiraciale, ouvre assurément une nouvelle ère : toutefois, comme le note l’auteur, fort pessimiste, le pays de Mandela et de ses successeurs n’est pas « le paradis qui faisait battre les cœurs des manifestants de 1989 [la manifestation du 13 septembre, autorisée alors par le président De Klerk, entendait protester contre le massacre perpétré dans les townships des Cape Flats, où des violences avaient éclaté le soir des élections de 1989]. » (p. 489) L’auteur dresse alors un portrait sans complaisance des lendemains qui déchantent : « Une proportion non négligeable des résidants du Waterfront et des beaux quartiers du Cap (les banlieues à l’ouest et au sud de la Table) n’est pas d’origine captonienne. Les viols, meurtres et pillages qui désolent les banlieues de Johannesburg, Pretoria ou Durban inquiètent la minorité blanche, et la réputation de sécurité relative dont jouit Le Cap agit comme un aimant. Pour ceux qui en ont les moyens, Cape Town est devenu Escape Town. » (p. 479) Nous terminerons, pour notre part, sur une note plus optimiste : Helen Zille, élue à la tête de la municipalité en 2006, a reçu en 2008 le prix du « Meilleur Maire du monde » pour avoir notamment, sous son mandat, vu croître le produit brut du Cap métropolitain et baisser la dette municipale, le chômage et la délinquance.
Fort bien édité, doté d’annexes (listes des dirigeants de la ville depuis l’origine), d’une chronologie, d’une copieuse bibliographie, d’un double index, onomastique et toponymique, et de nombreuses notes, hélas reléguées en fin d’ouvrage, le livre de Dirk van der Cruysse est une bonne synthèse sur l’histoire du Cap. S’il n’apporte rien du strict point de vue de l’histoire urbaine ou de la sociologie historique des «classes urbaines», il est en revanche susceptible de fournir d’appréciables exemples concernant l’histoire de l’Empire britannique et de la « britishness ».