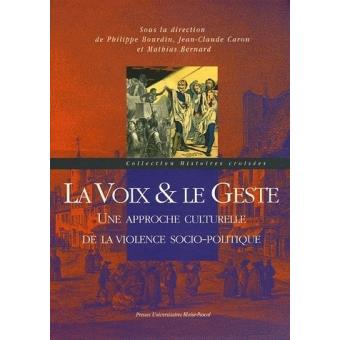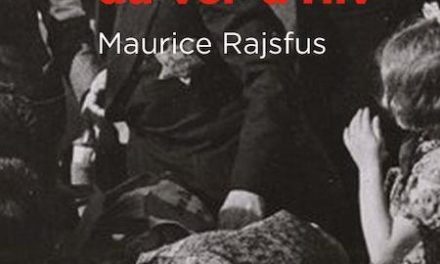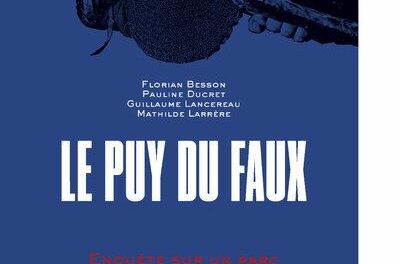placent dans le champ de l’histoire des pratiques et des cultures politiques sur le long terme, du XVIIIe (en particulier la période révolutionnaire) au XXe siècles.Le projet se place dans le droit fil d’une ligne directrice suivie depuis quelques années, ses initiateurs cherchant à définir plus particulièrement comment se construit l’espace public (démocratique et étatique). Ils rappellent que si la violence, y compris dans ses aspects socio-politiques, est un objet d’étude exploré depuis relativement longtemps par la recherche historique, ses représentations méritaient un éclairage particulier qu’offre ce volume. En effet, les formes qu’elles empruntent (au travers de supports de plus en plus diversifiés au fur et à mesure du temps, avec l’apparition de la photographie, d’images animées bientôt sonoriséesCatherine Bertho Lavenir montre d’ailleurs très bien le rôle de l’audiovisuel dans la construction du sens des actes terroristes, une construction qui se fait d’autant mieux avec la présence fortuite de la caméra au moment de l’événement (on pense à l’attentat de Dallas contre Kennedy). Mais on pourrait en dire autant des constructions a posteriori quand il s’agit de faire la relation d’un fait, de susciter la compassion (attentats du métro Saint-Michel), ce qui a pour effet de limiter « l’impact brut du fait divers et de le réinscrire dans un cadre de perception collectif »., de la radiodiffusion, de la chansonOn lira notamment le très bon travail de Valérie Mazerolle, doctorante à Clermont-Ferrand, « Quand la chanson se fait violence : analyse socio-sémiologique du répertoire de Colette Magny (1967-1972) »., etc.) témoignent de la persistance du conflit comme mode de gestion sociale : alors que le discours politique fait de plus en plus appel à un règlement pacifique des difficultés, cette dimension émerge beaucoup difficilement dans les actes.
Ces considérations justifient pleinement l’intérêt d’explorer la représentation de la violence socio-politique, d’autant que celle-ci, dans son expression, peut tout aussi bien
être assez ancienne alors que ses traits nous sont encore familiers.En outre, les auteurs insistent sur la question des caractères identitaires qui s’expriment au travers du contexte (le terme de « paysage » lui est substitué) sonore et gestuel, dont le repérage par les uns et les autres permet de vérifier l’appartenance à un groupe donné. Cette vérification se fait à l’intérieur du groupe lui-même, les acteurs recourant à des formes d’expression et à une mise en scène (consciente ou non) spécifiques servant non seulement leur objectif d’identification, mais également à attester de leur appartenance personnelle aux yeux de leurs pairs : il s’agit de trouver une légitimation. Cette vérification est importante, puisqu’elle vise à renforcer la cohésion du
groupe. Mais elle comporte en même temps un aspect discriminatoire destiné à ceux qui sont à l’extérieur : il s’agit alors de s’affirmer par l’exclusion de ceux qui ne peuvent y appartenir à ce groupe, du fait de leur méconnaissance des codes gestuels et sonores spécifiques qui y sont employés, ou tout simplement du fait de leur volonté de ne pas y recourir. L’utilisation de ces formes joue donc comme un facteur de discrimination : on se « reconnaît » par la voix et le geste. La question de l’identité vue sous cet angle est donc bien une question importante pour qui veut approfondir (ou simplement approcher) la culture politique de tel ou tel groupe. Mais on voit par là-même tout le bénéfice qu’on pourra retirer de la lecture de cet ouvrage, puisqu’il permet d’éclairer et donne à comprendre sur quel terreau se développe l’action politique et se meuvent ceux qui y participent, hommes ou femmes : c’est bien le projet soutenu par les tenants de l’histoire culturelle. C’est là que se trouve également l’intérêt pédagogique de
l’ouvrage, puisque cet angle pourra être utilisé aussi bien au collège qu’au lycée, ne serait-ce, parmi tant d’autres exemples, qu’au travers de la chanson ouvrière, de films d’actualité sur des manifestations, des grèves, etc.
Dans un premier chapitre, les auteurs ont d’abord cherché à voir comment le corps politique est mis en scène. Il s’agit d’abord de Louis XVI, considéré par Raymonde Monnier au travers del’épisode de Varennes (20-21 juin 1791), qui permet de voir l’accélération de la désacralisation du monarque (c’est l’aboutissement d’un processus déjà largement entamé depuis le prédécesseur de Louis XVI) et qui rend possible le passage à la République (l’idée monarchique tombe avec celui qui l’incarne) et surtout d’envisager la condamnation à mort du roi, étape cruciale avant sa mise à mort. R. Monnier montre justement comment s’effectue cette transition, à quels thèmes et à
quelles périodes on fait appel pour peser sur l’opinion publique. Le recours à l’Antiquité est fréquent : on convoque Brutus, héroïsé, pour rendre pensable la mort du tyran, auquel on oppose la liberté nouvelle. Ce sont ces mêmes thèmes qui sont utilisés lors de la cérémonie au cours de laquelle Voltaire est amené au Panthéon (11/7/1791). On voit également le désir du nouveau pouvoir de s’identifier à l’idée de liberté, en renvoyant l’Ancien Régime au monde des ténèbres, de l’oppression. Tout en continuant à puiser aux même sources, la jeune République cherche des héros vivants : elle les trouve avec les dépouilles des généraux de la Révolution, morts (Joubert, Desaix) au combat ou non (Leclerc, Kléber, Hoche). Bernard Gainot montre s’effectuent les rites organisés par la Première République, qui visent, au-delà du processus d’héroïsation, à
l’auto-célébration de la Nation qu’on souhaite tourner vers la vengeance de ses morts : le contexte de la guerre impose sa marque au contexte politique national. En tout cas, ces nouveaux héros gagnent le Panthéon, ce qui nous renvoie au tableau de Girodet, Apothéose des héros français morts pour la Patrie dans la guerre de la Liberté (1802),
qui associe la mythologie antique à la tradition médiévale. On fait appel au même thème de la liberté lors de l’attentat de Rastadt (9 floréal an VII – 28 avril 1799) qui vise le convoi des plénipotentiaires français et de leur famille. Les ministres Roberjot et Bonnier sont abattus, tandis que Jean Debry, blessé, parvient à fuir. Jean-Luc Chappey montre la construction de la relation de l’événement, qu’on déforme à l’envi, qu’on théâtralise (au sens propre comme au sens figuré), les corps martyrisés des ministres prouvant la bestialité des Autrichiens, leur inhumanité. On a beau jeu, alors, de les opposer à la France, incarnation de la civilisation. Il s’agit de renforcer la mobilisation française (on en appelle à la vengeance, là encore) mais aussi de susciter les craintes des Britanniques, dont l’Autriche recherche l’alliance.
Michel Biard montre l’insistance des dirigeants de la Convention thermidorienne à légitimer leur avènement par la dénonciation de la monstruosité de leurs prédécesseurs
au pouvoir, incarnés par les représentants en mission, symbole de la Terreur. Les Carrier, Collot d’Herbois et Robespierre deviennent alors le Mal absolu, les liberticides, la
démonstration même de la dérive révolutionnaire qui s’est développée sur la base de la violence et de la déraison. La nouvelle Convention cherche à prouver sa volonté de revenir à des bases plus saines, aux véritables sources de la Révolution et aux principes des Lumières. On a vu la forte implication du régime républicain dans les cérémonies
officielles. Dès la Restauration,on assiste à l’émergence d’une contre-culture au travers des « convois d’opposition », étudiés par Emmanuel Fureix. Malgré l’impératif de respect qu’elles impliquent, les funérailles d’opposants à la monarchie constituent autant d’occasions d’agitation, qui peuvent dégénérer en de véritables insurrections armées. C’est notamment le cas lors des obsèques du général Lamarque (qui servent de cadre à l’un des épisodes fameux des Misérables) en 1832, qui marquent un tournant. Avant cette date, la violence est ritualisée : la foule porte le cercueil du défunt ; le parcours passe par la Bastille et la place Vendôme ; on ne se prive pas d’adresser des gestes provocateurs aux forces de l’ordre (le drapeau rouge apparaît) et aux autorités, fustigées lors des éloges funèbres, lesquels ont donc valeur de discours politiques. Puis la violence symbolique fait place à une tension plus palpable, et conduisent à des heurts sanglants après 1832.
La rue s’affirme comme le lieu principal de la mise en scène du corps politique, comme on le voit à un autre moment, lors des opérations d’épuration qui marquent la Libération.
Pascal Gibert a pris le cadre de l’Auvergne pour mettre en lumière le processus qui accompagne les atteintes aux femmes et aux hommes incriminés. Il montre la spontanéité des tonte et des inscriptions dénonciatrices, individualisées ou non, perpétrées de jour ou de nuit (pour les secondes). Le premier type d’agression (que l’imaginaire collectif a principalement retenu) donne lieu à une théâtralisation : les accusées sont soumises à une déambulation dans les rues, avant que la tonte ait lieu, aux yeux de tous, manifestation de l’emprise des hommes sur l’espace public, mais signe de leur reconquête du même espace au détriment des occupants allemands (d’autres hommes) : la démonstration de la puissance virile passe par là. P. Gilbert montre également que les motifs ne sont pas majoritairement d’ordre sexuel (la collaboration dite
« horizontale »). Entrent aussi en ligne de compte les accusations d’ordre économique (marché noir…) et tout ce qui relève plus simplement de la délation.
La rue est également le lieu où s’exprime la xénophobie, comme dans les années 1880-1890 à Aigues-Mortes, Marseille ou Lyon, étudiée par Laurent Dornel, et dans laquelle on retrouve la même quête identitaire qui se construit par l’exclusion de l’Autre, ici les Italiens.
La question de la légitimité de la violence aux yeux de leurs auteurs s’impose. Louis Hincker montre ainsi comment les blessures reçues lors des journées de Février 1848 sont utilisées par leurs porteurs comme objet de fierté (qu’on retiendra également comme manifestation identitaire), comme brevet de civisme témoignant de leur courage mis au service de la liberté et de l’intérêt collectif et donc comme forme ultime du don de soi, ce en retour de quoi ils attendent une certaine forme de reconnaissance. L. Hincker montre pourtant l’évolution de l’utilisation faite ainsi des corps meurtris : dans un désir de pacification, les préoccupations de reconnaissance de l’État passent progressivement du combattant aux victimes de la répression. Le regard et l’attention publique passe ainsi de la récompense de la bravoure à l’indemnisation.
Dès lors, la perception de cette violence par un représentant de l’État peut également être intéressante à considérer. C’est ce qu’a fait Jean-Claude Caron, qui a travaillé sur un corpus d’informations diverses constitué par le sous-préfet d’Autun, à partir de sources de diverses origines (chefs d’entreprise, syndicats ouvriers, administration, chansons, presse…) sur les mouvements sociaux qui agitent la Saône-et-Loire vers 1899-1900, et en premier lieu Le Creusot. Outre son désir de mettre en valeur sa propre action dans les conflits (le titre du dossier est : Mes Grèves), on voit quel regard ce sous-préfet, radical, porte sur les personnages de la scène qu’il observe, et révèle ses
représentations à leur égard : l’ouvrier exalté, et donc imprévisible ; les grévistes « surexcités par la colère et l’alcool ».
Les conflits sociaux sont aussi le cadre de l’étude de Rémy Cazals, qui s’est intéressé à la représentation qu’en ont les participants à la grève des ouvriers lainiers de Mazamet, en 1909.
La place manque pour dire la richesse de l’ensemble des contributions (il y en a d’autres encore) et tout l’intérêt de cet ouvrage très dense. Ce qui précède l’aura peut-être
suggérer suffisamment. Insistons tout de même sur la grande diversité des situations prises sur l’ensemble de la période couverte, qui offre des angles d’approche de la violence socio-politique nombreux, que l’étudiant ou l’enseignant pourra mettre à profit. Dans le cadre pédagogique, on pourra réinterroger des sources qui apparaissent désuètes à l’heure de l’Internet : les chansons et les documents sonores d’une façon générale (discours, émissions radiodiffusées, témoignages oraux…). Mais on pourra également trouver matière à réinterroger les documents audio-visuels (reportages télévisés, films de fiction…) : en quoi permettent-ils de comprendre la violence socio-politique, comme élément de la culture politique.