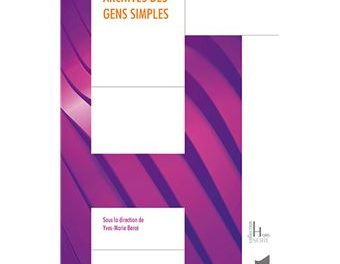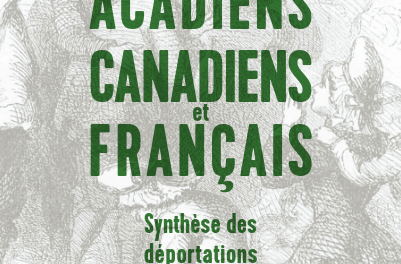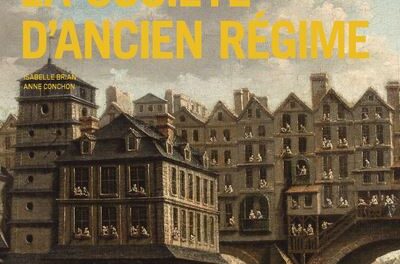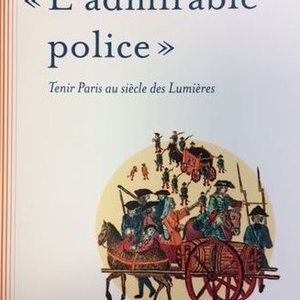
La police de Paris, en dépit de ses défauts, semble, aux yeux des observateurs étrangers du siècle des Lumières, comme «la plus «parfaite» pour tenir Paris, véritable monstre démographique qui ne cesse de croître. C’est sous Colbert 1619-1683 que la prise de conscience débuta, devant l’ampleur démographique galopant de la capitale. Il décida, pour cela, de jeter les bases d’un embryon administratif centralisé, la lieutenance générale de police en 1666-1667. Cette création ex-nihilo va ainsi préfigurer une mutation radicale du pouvoir policier parisien tout au long du siècle suivant. Les autorités souhaitent avant tout une police plus préventive que répressive et développent, en ce sens, un lourd appareil bureaucratique. Il s’agit avant tout d’améliorer le recrutement des commissaires au Châtelet, des inspecteurs et des auxiliaires, ces « mouches » et espions qui fréquentent des lieux allant du bordel à la loge maçonnique. Priorité lui est également donnée de surveiller étroitement le maillage urbain et de territorialiser ses missions. Mais devant la ville titanesque qu’est devenue Paris, la police souhaite aussi être utile au bien public. Elle diversifie ainsi ses missions : salubrité, hygiène, santé, voirie, arts et métiers, fluidité du trafic, numérotation des rues, deviennent aussi des compétences tentaculairesA ce titre et encore aujourd’hui, les pouvoirs de police du maire sont les héritiers directs de cette époque..
Si cette politique répond aux attentes sécuritaires de certaines franges de la population, elle nourrit, cependant, les tensions car cette force vigilante est également présente pour surveiller, punir, emprisonner, chasser les indésirables, user de lettres de cachet en blanc pour faire enfermer les séditieux. Aussi fait-elle naître d’importantes tensions. Car la police, qui se pique d’être juste, l’est rarement dans une société marquée par une forte inégalité sociale. La cristallisation des critiques autour du despotisme de la police est donc un ingrédient dans l’effervescence pré-révolutionnaire. A partir des années 1760, la philosophie du droit naturel, une nouvelle idée de la liberté et de la souveraineté politique, rendent l’arbitraire policier de moins en moins acceptable. Ces critiques rencontrent le vécu ordinaire de tous ceux qui ont la vie fragile et qui savent la police souvent dure aux pauvres. L’administration royale et les lieutenants généraux de police successifs ne se sont pas dédouanés de cette question brûlante. Entre le XVIIe siècle et la Révolution, il leur a fallu tenter de répondre aux défis lancés par la croissance rapide de la population et les besoins en approvisionnement, par l’expansion incontrôlable de l’espace urbain, par la multiplication des activités et des flux, enfin, par la modification de la société et des cultures dans la ville. L’édit de 1667 assignait à la nouvelle lieutenance de police, la mission de pourvoir à l’abondance, mais aussi d’éradiquer les fauteurs de trouble. Or, cette conception n’est plus de mise un siècle plus tard lorsque la mission de la police, selon le dictionnaire universel de Des Essarts, est de promouvoir le bonheur des hommes « pour l’intérêt général de la société ». Comme le précise Vincent Millot, plus qu’elle n’instaure et ne fige un nouveau dispositif institutionnel, la commission Colbert-Pussort de 1666 ouvre la voie à une dynamique socio-politique plus complexe que ce qu’ont bien voulu retenir pendant longtemps l’histoire institutionnelle et l’historiographie traditionnelle de la police. Gouverner Paris, sur le long terme, suppose la construction d’un nouveau compromis de l’ordre, la recherche d’un équilibre, d’abord avec les élites sociales et avec le pouvoir municipal, avec les robins du Parlement et des cours de justice puis avec des pans plus larges de la population pour valider et légitimer toutes sortes de nouveautés policières. Il fallut également innover et, de plus en plus, considérer l’espace en expansion de la ville, convenir de nouveau découpages du territoire urbain, de manières plus fonctionnelles de l’arpenter et d’y répartir des forces à proportion des densités de population et de la prolifération des activités. Depuis 1702, et la création des vingt quartiers de police qui sont surimposés à la trame des quartiers municipaux, le souci a été constant de « tenir le monstre parisien ». La police ne pouvait y parvenir uniquement en surveillant la population. Les effectifs auraient été bien trop insuffisants pour une ville qui dépasse les 500 000 habitants en 1700, à environ 700 000 en 1789. Et ce ne sont pas les 3 000 espions du lieutenant général de police entre 1747 et 1757, les 48 commissaires au Châtelet, la vingtaine d’inspecteurs et les 1 500 hommes de la garde, voire les troupes du Roi qui auraient pu y suppléer ! Il a fallu à la police et à ses lieutenant généraux savoir négocier, passer des compromis et des alliances, un art qui n’exclut pas certaines fois l’acte d’autorité et le rapport de force.
Cependant, comme le rappelle l’auteur, à juste titre, il faut pourtant se garder d’une lecture trop réductrice de la complexité des évolutions socio-politiques parisiennes, garder à l’esprit le tissu très dense des pratiques de sociabilité urbaine, des réseaux et des formes de notabilité, des jeux de protections et de clientèles qui associent puissants et moins puissants, cadres de paroisses et milieux plébéiens. Il ne faut pas, également, négliger les occasions de participation, profanes ou religieuses, et de contestation qui existent et qui se transforment le siècle durant. Il importe, aussi, de considérer les formes diversifiées de la politisation dans le sillage de l’agitation janséniste, de la protestation des parlements, de la politique telle qu’elle se faisait et telle qu’on la ressentait au cabaret, au tripot, au bordel ou sur le Pont-Neuf.
L’ouvrage de Vincent Millot s’attache avant tout à revenir sur les manières dont un ordre social peut s’élaborer et se construire, être traversé de tensions que l’on peut chercher à résoudre, voire de crises à anticiper. Une première partie tente d’apporter un début de réponse en examinant comment la formation progressive de « bons ouvriers de la police » a pu apparaître comme un gage de réalisation des desseins policiers et du soutien de la population. Commissaires enquêteurs-examinateurs au Châtelet, inspecteurs de police, mais aussi tout ceux qui « travaillent à la police », parmi lesquels les fameux espions ou mouches, forment néanmoins trois catégories qui jouissent d’une reconnaissance sociale inégale dans le temps, bien entendu en lien avec leur origine sociale et leurs manières de faire la police. Ces catégories ont essuyé des critiques plus ou moins virulentes. Mais, comme le précise l’auteur, il s’agit bien, ici, d’affronter les poncifs et les lieux communs parfois longuement colportés dans l’historiographie. Prévenir ou réprimer, rassurer ou protéger, c’est à travers la mise en œuvre de ces objectifs que la police du Châtelet s’efforce de construire et de consolider le compromis social ou d’obtenir le consentement de la population. Jusqu’au début des années 1760, la police se concentre sur la prophylaxie, celui de la police des subsistances qui doivent se trouver sur les marchés au bon prix. Ce qui est alors en jeu est la réalisation des promesses du sacre royal, à savoir rendre effectif la pacte nourricier qui soude les peuples dans l’obéissance au roi et, la manifestation concrète de la figure paternelle. Mais d’autres secteurs, bien plus larges, sont concernés : lutte contre les incendies, protection en cas d’inondation ou de calamités, assistance. Cette politique repose davantage sur l’expertise et le concours de la scienceQui de mieux que le personnage fictif de Nicolas Le Floch pour illustrer notre propos ? Voir Jean-François Parot http://www.nicolaslefloch.fr/Editions/Biographie-de-jean-francois-parot.htm.. Elle suppose aussi une gestion rationalisée des activités dans l’espace, que les autorités souhaitent assainir, fluidifier. Mais cette préoccupation resserre les mailles de filet policier et facile l’exercice d’une surveillance plus stricte des lieux et groupes à risques. C’est pourquoi, la protection assurée par la police auprès de la population trouve sa contrepartie dans l’insécurité qui doit frapper les indésirables. Les retrancher du corps social est une constante policière inégalement appréciée de la population.
En définitive, la cristallisation des critiques autour de despotisme de la police est sans doute un ingrédient dans l’effervescence pré-révolutionnaire. Ce qui entre en ligne de compte est peut-être dans les critiques formulées d’en haut, au nom de la philosophie du droit naturel ou au nom d’une nouvelle idée de la liberté et de la souveraineté politique qui rendent alors l’arbitraire policier devient de plus en plus insupportable avec l’expérience vécue par le bas peuple. Une bureaucratie tatillonne, des arrangements difficiles à comprendre avec certains malfrats pour mieux les contrôler par la suite, les indélicatesses et abus de pouvoir font que les lieutenants généraux ont préféré attribuer à quelques moutons noirs ces dysfonctionnements. 1789 aura raison de ce mode de gouvernance mais la structure sera conservée, quelques temps plus tard, par Fouché1759-1820.
Il s’agit d’un œuvre extrêmement dense, mais précieuse pour connaître précisément le peuple de Paris. L’auteur nous plonge au cœur de la mécanique policière patiemment rodée par les lieutenant généraux successifs afin d’améliorer le recrutement. Les prérogatives importantes de la police s’étendent désormais à des secteurs entiers de la vie économique parisienne et à la prévention de tous les périls d’ordre naturel ou humains. Un livre d’une très grande qualité historique.