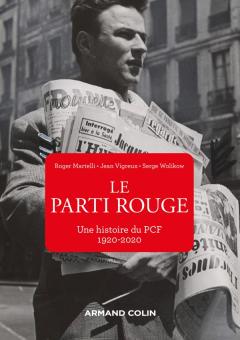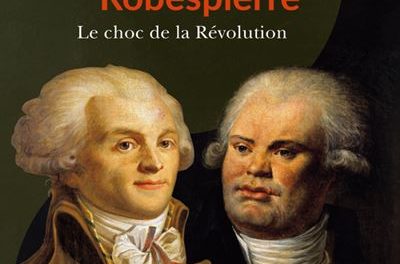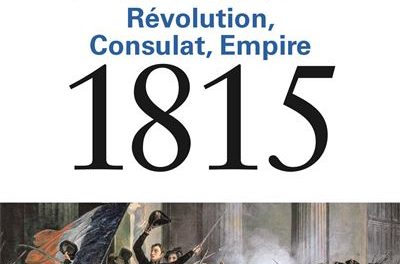Un trio d’historiens français spécialiste du PCF pour le centenaire de sa naissance
Dans le cadre du centenaire de la naissance du futur PCF (appellation officielle à partir du 1er janvier 1922), les éditions Armand Colin ont eu la volonté de sortir une synthèse sur l’histoire du Parti communiste français : Le Parti rouge. Une histoire du PCF (1920-2020), qui est l’avant-dernière parution (septembre 2020) de sa nouvelle collection Mnémosya (qui existe depuis août 2019), en faisant appel à trois chercheurs de générations différentes, spécialistes du PCF et de ses fonds d’archives : Roger Martelli (70 ans), Jean Vigreux (56 ans) et Serge Wolikow (75 ans).
Roger Martelli, né en 1950, est un historien et ancien membre de la direction du PCF (1968-2010). Normalien de l’ENS-Ulm (promotion 1969) et agrégé d’histoire, Roger Martelli a enseigné au début des années 1980 au collège Les Gâtines à Savigny-sur-Orge puis (jusqu’en 2008) au lycée Darius-Milhaud du Kremlin-Bicêtre (94), puis au lycée Édouard-Branly à Nogent-sur-Marne (94). Longtemps directeur des Cahiers d’histoire de l’Institut de recherches marxistes (IRM), Roger Martelli a contribué au renouvellement de l’histoire du communisme par une contribution à l’étude historiographique du sujet. Il a notamment interrogé la nature du régime soviétique issu de l’écologie communiste en n’hésitant pas à interroger sa dimension totalitaire. Bien que n’ayant pas eu de carrière universitaire — Roger Martelli n’a jamais écrit de thèse —, cet historien a participé pleinement aux mutations de l’historiographie du communisme français au travers de nombreux articles et ouvrages consacrés au communisme, au Parti communiste français et aux événements de mai 68. Actuellement, il est codirecteur de la rédaction du magazine Regards. Roger Martelli a enseigné toute sa carrière dans le secondaire.
Jean Vigreux, né en 1964, fut professeur certifié de 1987 à 1990, agrégé de 1990 à 2001 et maître de conférences de 2001 à 2008 puis professeur des universités, depuis 2008. Il est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne (Dijon), depuis 2012. Sa thèse sur Waldeck Rochet (Waldeck Rochet, du militant paysan au dirigeant ouvrier, sous la direction de Serge Berstein, à l’IEP Paris, soutenue en 1997 et l’obtention de son HDR en histoire contemporaine en 2007) l’a conduit à travailler sur l’histoire du communisme rural et sur la politisation des campagnes. Il mène également des recherches sur l’histoire des gauches européennes et l’histoire de la Résistance. Il est actuellement directeur de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Dijon, depuis avril 2017. La commémoration du centenaire du Congrès de Tours a été l’occasion pour l’historien de publier son dernier ouvrage, en novembre 2020 : Jean Vigreux, Le Congrès de Tours : 25 décembre-30 décembre 1920, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon (EUD), collection Essais, 2020, 240 p.
Serge Wolikow est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne. Né en 1945, licencié en philosophie en 1966, agrégé d’histoire en 1968, il est professeur dans le secondaire de 1968 à 1991. Docteur d’État, il enseigne l’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne, à partir de 1991. À la fin des années 1970, il mène des recherches sur l’histoire politique du mouvement ouvrier, en se focalisant sur l’histoire de la pensée économique et sur l’histoire des organisations politiques (socialistes et communistes) et syndicales dans la période de l’entre-deux-guerres. Il a également participé à des projets de recherche sur l’histoire de la Résistance et la prosopographie des militants du mouvement ouvrier. Il est un des experts français du Conseil international des archives, engagé dans un vaste programme de recherches sur les archives du XXe siècle (archives du communisme, des organisations politiques, du vin et du monde viticole et de la recherche en sciences humaines et sociales). Il a dirigé la Maison des sciences de l’homme (MSH) de Dijon, de 2002 à 2012, dont il a été l’un des initiateurs. Il a été également président du réseau national des MSH, de 2005 à 2010. Il a été décoré de la Légion d’honneur, le 7 décembre 2011, à la MSH de Dijon. Depuis 2012, il est le coordinateur scientifique du Consortium Archives des Mondes contemporains de la TGIR Huma-Num.
Le Parti rouge. Une histoire du PCF (1920-2020) : l’ouvrage de synthèse le plus récent sur le PCF
Cet ouvrage de 384 pages comprend une table des principaux sigles utilisés (p. 3-6), une introduction (p. 7-10), 12 chapitres (p. 11-270), une conclusion (p. 271-274), des annexes (p. 275-338), une bibliographie récente (p. 339-372), des crédits photographiques (p. 373-380) et, enfin, une table des matières (p. 381-384).
Dans l’introduction, les trois auteurs préviennent le lecteur de leur démarche : « Ce livre ne se veut ni une somme détaillée ni une théorie de l’objet « Parti communiste français ». Il n’est pas une histoire « des » communistes, mais celle de cette structure dans laquelle ils ont choisi d’insérer leur engagement politique. Nous avons choisi le regard global sur un objet particulier, à la charnière du politique et du social, parti politique par excellence et fait social global, avec ses cohérences et ses failles, ses structures et sa culture, sa rigidité et sa fluidité. » (p. 9). En bref, Roger Martelli, Jean Vigreux et Serge Wolikow s’insèrent dans le courant d’une histoire sociale du politique, porté entre autre par la SFHPo (Société Française de l’Histoire Politique), une association d’historiens créée en janvier 2019 dont les trois auteurs sont membres.
Partie I : Le PCF sous la Troisième République (1920-1940) :
Naissance et développement du PCF
Selon le découpage chronologique que nous avons établi, la partie I englobe le chapitre 1 « D’un parti à l’autre (1920-1921) » (p. 11-30), le chapitre 2 « Bolcheviks à la française ? (1921-1933 » (p. 31-50) et le chapitre 3 « Le temps du Front populaire (1933-1939) » (p. 51-74).
Avec le chapitre 1 « D’un parti à l’autre (1920-1921) » (p. 11-30), les auteurs montrent comment la majorité du Parti socialiste SFIO s’est transformée en un Parti socialiste SFIC. Ainsi, ce dernier s’est créé, le 30 décembre 1920, à Tours, dans la salle du Manège, aujourd’hui disparue. Le XVIIIe Congrès du Parti socialiste SFIO décide à une large majorité d’adhérer à l’Internationale communiste (IC), créée au printemps de 1919. Cette décision attendue (car voulue par les adhérents eux-mêmes) est le résultat de plusieurs années de vifs débats au sein de la SFIO. Le choix de 1920 est une rupture, mais qui s’inscrit en même temps dans une histoire longue du mouvement ouvrier français. La naissance du PC en France est le résultat d’une greffe du bolchevisme sur le mouvement ouvrier français, expliquait naguère l’historienne française Annie Kriegel (1926-1995). Les auteurs ajoutent que « L’effet d’une conjoncture liée à la guerre, avec sa somme l’approximations, d’illusions, de mensonges et de malentendus, suggèrent aujourd’hui d’autres travaux. En fait, aucune interprétation n’emporte à elle seule la conviction. Pour qu’une greffe réussisse, encore faut-il qu’il y ait compatibilité entre le greffon et le porte-greffe. Aucune donnée structurante, matérielle ou non, n’implique comme une fatalité l’expansion ou le déclin d’une force politique. Et si l’événement historique est structurant, il ne l’est que s’il s’inscrit dans l’épaisseur d’une histoire globale, qu’il oriente, mais qu’il ne détermine pas de toutes pièces. » (p. 11). Le temps du Congrès de Tours est indissociablement celui de la conjoncture courte des lendemains de guerre et du choc des révolutions russes, celui – plus étendu – de la crise ouverte dans le mouvement ouvrier européen par le cataclysme que représente la Première Guerre mondiale et celui des tensions qui travaillent en plus sur la longue durée le monde ouvrier français et ses composantes syndicales et politiques.
Avec le chapitre 2 « Bolcheviks à la française ? (1921-1933 » (p. 31-50), la tentative de bolchevisation du PCF par l’IC est victime des errances idéologiques de la Troisième Internationale, décidées à Moscou. Au début de 1921, la « SFIC » fait ses premiers pas. Le « Parti socialiste » (c’est toujours son nom officiel) se rattache désormais à une organisation qui se veut un « parti mondial » (IC), depuis juillet 1920. Le Ier Congrès de la SFIC de 1921, à Marseille, décide d’adopter le nom de « Parti communiste, SFIC » puis celui de « Parti communiste français (SFIC) », retenu au Ve congrès à Lille, en juin 1926. Entre-temps, dès 1922, l’IC interdit l’affiliation des membres du PCF à la franc-maçonnerie et à la LDH coupant ainsi la SFIC de la SFIO. Les conséquences sont désastreuses pour les effectifs communistes qui, en 1932, sont de 32 000, contre 25 000 en 1931, 56 000 en 1923, près de 80 000 recensés à l’été 1922 et 110 000, en octobre 1921. À l’issue des législatives de 1924, 1928 et 1932, le PCF compte respectivement 26, 12 et 10 députés. Les communistes récoltent 9,8 % (soit près de 900 000 voix), 11,3 % (1 million de voix) puis 8,3 (800 000 voix) des suffrages exprimés, avec comme zones de force : la région parisienne, le Nord, l’Est, le Massif central et la Dordogne ou le Lot-et-Garonne rurales.
Avec le chapitre 3 « Le temps du Front populaire (1933-1939) » (p. 51-74), au début de l’année 1934, le PCF est toujours ancré dans la stratégie « classe contre classe » prônée par l’Internationale communiste. Mais dès l’été 1934, le parti se glisse dans les infléchissements de ligne opérés à Moscou, puis invente à Paris la formule de « Front populaire ». Au-delà de la dimension stratégique, cette rupture installe pour longtemps un rapport nouveau du PCF à la société et à la politique françaises. La « section française de l’IC » est devenue un parti pleinement national. À l’issue des législatives de 1936, le PCF obtient 72 députés et 12,7 % (1,5 million de voix) des suffrages exprimés et devient un parti de masse en comptant 257 000 militants, en 1937.
Partie II : Le PCF sous l’Occupation et la Libération (1940-1945) :
Un PCF en guerre et premier parti de France
La partie II correspond au seul chapitre 4 « Le PCF dans la guerre (1939-1945) » (p. 75-96). Dans ce dernier, A la fin de l’été 1939, le PCF isolé est contraint à la clandestinité par le gouvernement de la République, à la suite de la signature du pacte germano-soviétique d’août 1939. Les communistes français sont sur le point de disparaître de la scène politique nationale mais ils parviennent pourtant à faire, de cette extrême fragilité, une force quand la scène démocratique tout entière disparaît avec l’Occupation et que le temps est venu de la Résistance, dans l’Hexagone. Quand celle-ci s’achève, le PCF est devenu le premier parti français.
Partie III : Le PCF sous la Quatrième République (1945-1958) :
Un PCF sous la Guerre froide et un parti incertain
La partie III comprend le chapitre 5 « Le premier parti de France (1945-1947) » (p. 97-116), le chapitre 6 « S’inscrire dans la guerre froide (1947-1953) » (p. 117-142) et le chapitre 7 « Un parti incertain (1953-1958) » (p. 143-160).
Avec le chapitre 5 « Le premier parti de France (1945-1947) » (p. 97-116), c’est la Libération de l’été 1944, où il faut non seulement poursuivre les combats face aux troupes allemandes, mais reconstruire le pays et les institutions. Commence alors la période euphorique des « jours heureux », celle qui doit mettre en œuvre le programme du Conseil National de la Résistance (CNR). C’est aussi une période de deuil, celle de la découverte des répressions opérées par l’armée allemande et les collaborateurs, tant dans la traque des Résistants que dans la déportation de milliers de civils, sans oublier le génocide juif. Dès octobre 1944, la construction mémorielle forge l’idée du « parti des fusillés », voire des « 75 000 fusillés » pour désigner le « magistère moral » du PCF, qui se veut « le » parti de la Résistance. Même s’il s’avère aujourd’hui que le nombre, largement surévalué, doit être ramené entre 4 500 et 15 000, il reste proportionnel à l’intensité de l’engagement des communistes dans la Résistance. Ce travail de mémoire nourrit, en tout cas, les campagnes électorales, entre 1945 et 1947. Dans la France débarrassée de la tutelle nazie, l’image du parti des fusillés se superpose alors positivement à celle de l’Armée rouge, de l’URSS et même du « maréchal Staline ». Sorti de cinq ans d’occupation et de mise au ban de la nation, le PCF participe activement à l’Assemblée consultative fondée par le général de Gaulle, véritable pouvoir législatif qui tend aussi à effacer les stigmates du régime de l’État français en jugeant les faits de collaboration par des tribunaux spéciaux. Le PCF a pour lui la continuité visible de sa clandestinité et de son engagement résistant. Parvenu à son apogée, il peut se réinstaller, le 25 août 1944, en pleine insurrection parisienne, au 44 rue Le Pelletier, siège du parti avant la guerre.
Avec le chapitre 6 « S’inscrire dans la guerre froide (1947-1953) » (p. 117-142), c’est à partir de 1946-1948, que la conjoncture change : les relations internationales, voire la politique étrangère ont un poids de plus en plus prégnant alors que les tensions s’intensifient. La guerre froide s’installe entre mars 1946 et 1947 et s’approfondit entre 1948 et 1950. Les mots et les actes s’incrustent dans les représentations : « rideau de fer » (mars 1946), « monde libre » (mars 1947), « plan Marshall » (juin 1947), « camp de la guerre », « camp de la paix » et « Kominform » (septembre 1947), « coup de Prague » (février 1948). La logique binaire structure les discours et les regroupements politiques. Il faut « choisir son camp » : du côté de Washington ou de Moscou, du « monde libre » ou du « camp de la paix ». Pour le PCF, qui n’est pas avec Moscou relève du « parti américain », que l’on soit gaulliste, socialiste ou démocrate-chrétien. Mais si l’on n’est pas du côté occidental, c’est que l’on est en face : les communistes « ne sont pas à gauche, mais à l’Est », affirme le socialiste SFIO Guy Mollet.
Avec le chapitre 7 « Un parti incertain (1953-1958) » (p. 143-160), si le PCF rassemble 26,9 % des voix aux législatives de 1951 et 25,9 % à celles de 1956, soulignant à la fois une certaine stabilité et une bonne implantation dans la nation malgré les effets induits de la guerre froide, il n’en demeure pas moins que la mort de Joseph Staline, le 5 mars 1953, et sa succession par Nikita Khrouchtchev ébranlent le parti. L’exclusion d’Auguste Lecœur, qui pourtant semblait être l’héritier de Maurice Thorez et qui avait piloté le procès précédent contre Marty et Tillon, marque aussi la période des mini-procès staliniens en Occident. L’éviction du secrétaire à l’organisation du PCF semble liée à son voyage à Moscou en juillet 1953. Selon l’intéressé lui-même, Mikhaïl Souslov l’aurait chargé de transmettre au Bureau Politique (BP) du PCF les critiques concernant Staline et la nécessité de directions collectives. De retour à Paris, il se serait heurté à un Thorez décidé, cette fois, à ne pas se plier aux directives qui remettent en cause son magistère. En fait, la mise à l’écart du dirigeant est parallèle à celle de son homologue, Pietro Secchia, à Rome. Tout se passe comme si les deux responsables servaient de victimes expiatoires dans une remise en ordre visant classiquement à entériner le tournant poststalinien sans remettre en cause de façon globale la responsabilité des PC. Mais, à la différence de Secchia, Lecœur se cabre quand « l’affaire » se déclenche en 1954. Après s’être rendu à la « commission d’enquête », au siège du Parti, le 25 novembre 1954, il indique qu’il démissionne de toutes les instances du parti. Il est ensuite exclu. Dans ce moment particulier de la guerre froide, la « troisième force » semble enterrée. Dès mars 1952, le Président de la République, Vincent Auriol, sollicite Antoine Pinay pour former un nouveau gouvernement. Ce dernier est investi, grâce au ralliement des droites (une trentaine de députés RPF transgresse les consignes du général de Gaulle), puis en 1953, René Coty remplace le socialiste Vincent Auriol à la présidence de la République. Le gouvernement Pinay ne dure que neuf mois. Face à ce glissement à droite du régime, le PCF fait quelques pas pour sortir du ghetto de la guerre froide. La crise de la IVe République s’affirme et, après deux brefs intermèdes ministériels, l’arrivée de Pierre Mendès France suscite des espoirs. Les députés communistes votent son investiture, mais le chef du gouvernement refuse de compter leur suffrage dans sa majorité.
Partie IV : Le PCF sous la Cinquième République (1958-2019) :
le PCF sous de Gaulle puis le lent déclin irrésistible
La partie IV contient le chapitre 8 « Le PCF face au gaullisme (1958-1968) » (p. 161-178), le chapitre 9 « Entre deux printemps (1968-1972) » (p. 179-200), le chapitre 10 « Du programme commun au départ du gouvernement (1972-1984) » (p. 201-226), le chapitre 11 « Un recul irrésistible (1984-2002) » (p. 227-246) et, enfin, le chapitre 12 « Conjurer le déclin (2002-2019) » (p. 247-270).
Avec le chapitre 8 « Le PCF face au gaullisme (1958-1968) » (p. 161-178), c’est, à partir de 1958, que le PCF est, comme l’ensemble de la classe politique, surpris par la poussée gaulliste et l’émergence d’une force politique dont il ne perçoit pas vraiment les contours, même si les conditions de cette arrivée au pouvoir laissent un goût amer. L’analyse d’un coup de force, du pouvoir personnel et d’une arrivée du fascisme marque durablement sa lecture des événements. Surtout, peu de temps avant le retour du général de Gaulle, le PCF est endeuillé avec le décès de son « père fondateur », directeur de L’Humanité, Marcel Cachin, le 12 février 1958. Le groupe parlementaire communiste déclare dans une motion d’hommage : « Saluons avec respect et émotion la mémoire du militant prodigieux qui fut, tout au long d’une activité de presque 70 années, une des plus belles figures du mouvement ouvrier français, l’exemple de la fidélité inflexible, du désintéressement et du dévouement absolu à la cause de la classe ouvrière et de son parti ». Le hall de L’Humanité accueille, dès le 14 février, le cercueil de Marcel Cachin où l’on vient saluer le fidèle militant et dirigeant. Des obsèques importantes, à l’image de celles du mouvement ouvrier, accompagnent Marcel Cachin, le 15 février 1958. Une foule immense, estimée à « plusieurs centaines de milliers de personnes » défile en suivant les grands boulevards, les lieux symboliques de l’histoire nationale (place de la République et de la Bastille) pour arriver au cimetière du Père-Lachaise. Étienne Fajon et Jacques Duclos rendent hommage à la figure du parti. Maurice Thorez note dans son journal : « s. 15 : Paris fait à Marcel Cachin des obsèques grandioses et émouvantes auxquelles j’assiste, de L’Humanité au Père-Lachaise. Le soir, je remercie les représentants des Partis frères dans une allocution qui souligne la fusion intime chez Cachin et son Parti du patriotisme et de l’internationalisme » (p. 161).
Avec le chapitre 9 « Entre deux printemps (1968-1972) » (p. 179-200), au début de 1968, le parti communiste a toutes les raisons d’être serein. Le choc du XXe Congrès soviétique n’a pas déchiré son corps militant et le séisme de 1958, s’il a ébranlé ses assises électorales, n’a pas remis en cause sa place de premier parti de gauche. Il est même devenu le principal bénéficiaire à gauche, de la logique de bipolarisation produite par les scrutins majoritaires de la Constitution de 1958. Le parti s’est plutôt bien sorti des turbulences de la guerre froide. Il compte 290 000 adhérents recensés – dont 110 000 ouvriers – et obtient plus de 20 % suffrages aux scrutins législatifs. Il s’appuie sur ses 1 100 maires et ses 16 à 20 000 conseillers municipaux, sans compter son impressionnante galaxie « d’organisations de masse » (plus de 200). Il est choisi par un tiers des ouvriers qui expriment un vote et s’adosse au premier syndicat français, la CGT, dont il suit l’activité et le fonctionnement avec une attention extrême. Forte de 1,4 à 1,9 million d’adhérents, recueillant la moitié des votes salariés aux élections professionnelles, la CGT présente l’originalité d’être tout aussi « intégrée » que « contestataire ».
Avec le chapitre 10 « Du programme commun au départ du gouvernement (1972-1984) » (p. 201-226), le 12 juillet 1972, le programme commun est officiellement ratifié par Georges Marchais, François Mitterrand et le radical de gauche Robert Fabre. « Nous nous engageons d’un pas décidé dans la voie de la constitution d’un gouvernement », écrit Marchais dans L’Humanité du lendemain. Dans l’esprit des communistes français, l’élan que ne manquera pas de créer l’accord historique profitera à leur parti : il a proposé le programme, imposé sa philosophie générale et il en diffuse plus d’un million d’exemplaires en six mois. De plus, après un recul en 1969 et 1970, la conflictualité sociale redémarre à partir de 1971, avec des grèves plus nombreuses, plus longues et plus violentes. Comment le parti de la classe ouvrière n’en tirerait-il pas avantage ? Dans les premiers mois de 1972, chacun joue à peu près le jeu, même si quelques accrocs viennent tempérer la fête, comme la colère qu’exprime le PCF quand, le 26 octobre 1972, son allié (le PS) participe à un meeting de solidarité avec les victimes de la répression en Tchécoslovaquie. Mais communistes et socialistes travaillent dans un comité de liaison, conjuguent leurs efforts au Parlement et manifestent ensemble à la porte de Versailles, le 1er décembre 1972 (100 000 participants).
Avec le chapitre 11 « Un recul irrésistible (1984-2002) » (p. 227-246), en 1984, le PCF a de beaux restes, mais il n’est plus le parti expansif de la Libération ou des années 1970. Sa direction s’est profondément renouvelée en moins d’une décennie. Au printemps 1984, 40 % des membres du Comité Central (CC) ont été élus entre 1976 et 1982 et un tiers l’a été depuis 1979, après la rupture de l’union de la gauche. Le noyau « post-thorézien » de 1964 est toujours aux manettes (Georges Marchais, Roland Leroy, Paul Laurent, Gaston Plissonnier, Madeleine Vincent) ; il a autour de lui une cohorte de jeunes cadres, affirmés après 1977, dans la concurrence avec le socialisme français.
Enfin, avec le chapitre 12 « Conjurer le déclin (2002-2019) » (p. 247-270), c’est à l’instar de la SFIO en 1969, que le PCF se trouve dans les zones de la marginalisation électorale. La mutation, chère à Robert Hue, voulait relancer la machine électorale mais elle n’a fait qu’accompagner le déclin.
Conclusion, annexes et bibliographie
Dans leur conclusion, les trois auteurs constate que le PCF est passé de « premier parti de France » en 1945 à la 10e place, aux élections européennes de 2019, en l’espace de 70 ans !!! Néanmoins, l’essentiel n’était-il pas que le poids de l’URSS a pesé sur les représentations qui « ont contribué à l’intégration, dans les citadelles mêmes du capital, des exigences sociales qui ont façonné « l’État-providence ». (p. 272) » ?
Les annexes de cet ouvrage méritent que nous nous y attardions et c’est la raison pour laquelle nous les nommons toutes car elles constituent l’un des intérêts de cette synthèse sur le centenaire du PCF. En effet, celles-ci sont nombreuses et relèvent d’une importance capitale pour l’histoire du PCF (comme, par exemple, le point sur les effectifs du PCF de 1920 à 2020) : Les effectifs (p. 276-278) ; Le vote communiste de 1924 à 2019 (p. 279-277) Les résultats électoraux (Les élections législatives (p. 282-283) , Les élections présidentielles (p. 284) , Les élections régionales (p. 284) , Les élections cantonales et départementales (p. 285) , Les élections européennes (p. 285) ; Les élus communistes (p. 286) ; La sociologie du vote (p. 287-289) (Le vote ouvrier depuis 1958 et Le vote communiste par catégorie d’électeurs depuis 1978 (pénétration en %) ; La sociologie des militants (p. 290-294) (Les adhérents et L’encadrement communiste) ; Le Comité central 1920-2018 (p. 295-297) ; Le communisme municipal (p. 298-303) ; L’organisation (p. 304-306) (Le centralisme démocratique et Le fonctionnement statutaire) ; Contre-société (p. 307-308) ; La fête de L’Humanité (p. 309-310) ; Les femmes (p. 311-313) ; Les « ex» du PCF (p. 314-315) ; Les archives du communisme (p. 316-318) ; Les secrétaires généraux et les congrès (p. 319-321) ; Biographies (p. 322-338) ; Bibliographie (Ouvrages ayant valeur de sources et témoignages, ouvrages et articles) (p. 339-372) ; Crédits photographiques (p. 373-380).
Quant à la bibliographie, elle est à la fois fort conséquente (33 pages !) et très récente.
Un ouvrage de référence appelé à faire date ?
En guise de conclusion, l’ouvrage Le Parti rouge. Une histoire du PCF (1920-2020), aux éditions Armand Colin, est une synthèse remarquable tant par la qualité scientifique et pédagogique de son contenu (textes et annexes) que par les problématiques retenues (culturelles, sociales, sociologiques…). . Il y a un siècle, naissait ce qui allait devenir le Parti communiste français. Ce parti fut longtemps l’un des plus populaires du champ politique français. Pendant plus de trois décennies, il fut aussi le premier parti de gauche, avant de connaître un recul continu qui l’a porté vers la marginalité.
Cet ouvrage, qui insère les approches thématiques dans une trame chronologique, cherche à comprendre ce qui fit la force du PCF et ce qui a nourri son déclin. Il s’emploie à décrire la manière dont le communisme du XXe siècle s’est enraciné, à la charnière d’un communisme mondial dominé par le PC soviétique, dans un mouvement social structuré autour du monde ouvrier et urbain ainsi qu’une gauche politique traversée par les souvenirs des révolutions du passé, comme par les événements traumatisants des guerres mondiales et coloniales.
Avec la fin de la guerre froide, l’ouverture des archives et la multiplication des angles de recherche, il est aujourd’hui possible d’observer le PCF de façon plus sereine et plus sûrement documentée. On prend désormais la mesure de ce que le communisme politique ne fut pas seulement un parti, voire un appareil très centralisé, mais aussi une galaxie associant du politique, du syndical, de l’associatif et du symbolique. C’est cet objet « total » qui est ici présenté, analysé et interrogé. Ce livre mérite donc sa place dans l’opulente historiographie du communisme français et dans la profusion éditoriale du centenaire du Congrès de Tours.
© Les Clionautes (Jean-François Bérel pour La Cliothèque)