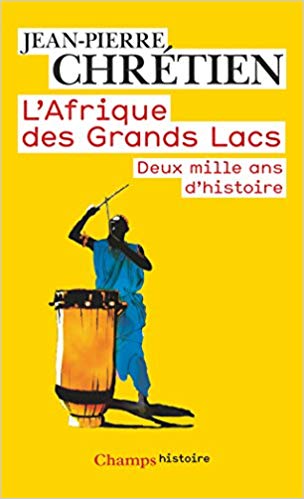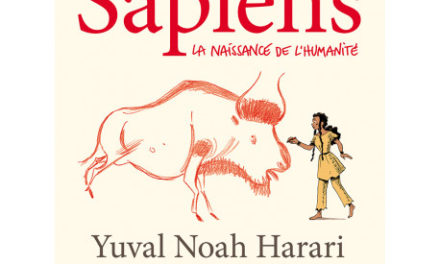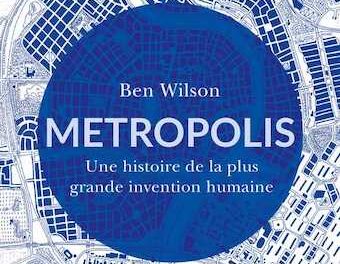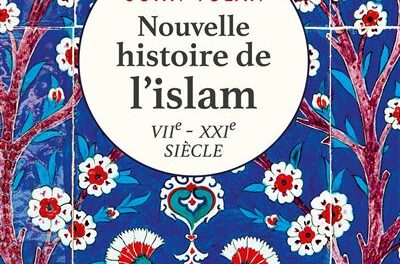Cet ouvrage est un essai d’histoire longue d’un territoire connu des Européens depuis 150 ans seulement puisque la première description de l’ Afrique « des Grands Lacs » date de 1858. Cette zone de l’Afrique fut longtemps peu connue du public français, elle s’est imposée douloureusement dans l’actualité des années 90. L’auteur actuellement directeur de recherche au CNRS est un bon connaisseur de la région depuis 1964.
L’intérêt majeur de ce livre se trouve dans son projet même : essayer de comprendre la crise récente en l’inscrivant dans une histoire scientifique des populations de la région dite des Grands Lacs et pour cela faire une analyse historiographique fine, remettant chaque discours dans le contexte idéologique de sa production. Pour chaque époque l’auteur décrit successivement les théories qui ont pu être développées avant de les resituer dans leur contexte idéologique. Sa grande question : l’explication d’affrontement inter-ethnique entre Tutsi et Hutu des années 90, que l’on trouve invoqués aussi bien par les observateurs étrangers que par les Africains comme la résultante d’une opposition historique entre ethnies, repose-t-elle sur une vérité historique ? Il va traquer cette théorie ethnique tout au long de l’histoire de la zone et ce depuis la préhistoire.
Il va montrer comment l’idéologie raciale du XIXe siècle a interprété une première fois les rares sources connues puis comment l’histoire a, en quelque sorte, été réécrite en se calquant sur l’historiographie européenne : idée de l’invasion civilisatrice comparable à la conquête romaine, féodalisme par référence au Moyen Age occidental ou système de caste « à la Dumézil », explication marxiste d’une opposition éco-socio-politique.
L’introduction nous offre une réflexion sur les sources orales et la méthodologie rigoureuse qu’elles imposent à l’historien : entre mythe et témoignages (p19-20). Elle souligne le rôle qu’ont pu jouer les pères Blancs dans l’historiographie y compris noire des années 20-40 en proposant la « lecture des légendes des origines » sur un modèle biblique, allant jusqu’à rattacher ces populations à telle ou telle lignée issue de Cham selon la Genèse. La difficulté pour l’historien tient à la « légitimation » de la crise récente par l’histoire ainsi instrumentalisée qui rend difficile toute remise en cause de la vulgate opposant Tutsi et Hutu. L’objectif de l’auteur consiste à tenter une histoire critique depuis les époques les plus anciennes.
Un antique peuplement et ses énigmes
En repartant des traces archéologiques, l’auteur évoque depuis la préhistoire un peuplement qui réfute la théorie ethnique. Vers l’an mille av J.C. les paysages seraient identiques aux paysages actuels avec un peuplement à maille large mais déjà relativement dense : peuple de pêcheurs sur le bord des lacs (rives du Lac Edouard) et traces d’une activité agro-pastorale. Comment concilier les résultats de l’archéologie avec la tradition des migrations bantoues ?
C’est à un géographe et philologue allemand que l’on doit ce qualificatif de « bantou » en 1851, le terme est utilisé pour désigner un groupe assez hétérogène : « bantous forestiers de la cuvette zaïroise, bantous des savanes au nord… » qui parle la même langue ou plutôt des langues proches. Les historiens ont longtemps évoqué un vaste mouvement Nord-Sud depuis la cuvette du Tchad. La théorie qui prédomine aujourd’hui est celle de micro migrations étalées dans le temps, du premier millénaire avant J.C. avec une métallurgie du fer au Rwanda. L’auteur, en analysant la « construction » même de ce « concept ethnique », met en lumière ses limites en particulier l’idée d’un métissage avec des peuples nilotiques qualifiés de plus évolués d’où découlerait l’idée du couple Hutu-agriculteur et Tutsi-éleveur [p38].
Ce qui ne résout pas la question des influences entre peuplement autochtone et bantou, que faire des Batwa (pygmées)? L’idée admise, à la suite des travaux de Jan Vansina : une migration bantoue qui « bantounise » le peuplement autochtone.
Dans une sous-partie intitulée : « Archéologie des paysages : des plantes, des vaches et des hommes », l’auteur montre comment les peuples en présence ont pu, depuis le premier siècle de notre ère, évoluer en fonction des réalités climatiques et des choix, des évolutions dans l’exploitation des plantes et du troupeau et il analyse, en les datant, les conséquences dans l’organisation socio-économique voire politique des différents secteurs de l’Afrique des Grands Lacs. On assiste à une double évolution : aux XIVe-XVe siècles, développement des bananiers qui libèrent de la main d’œuvre masculine, aux XVIIIe-XIXe siècles : arrivée de plantes américaines: patate douce, maïs, haricot qui sont absentes des légendes et des rituels ce qui confirme leur arrivée récente. Seul le manioc semble introduit au XIXe siècle par le colonisateur. Ces introductions et en particulier la banane permettent la mise en place d’un système d’appropriation du sol : exploitation lignagère restreinte avec une augmentation de la densité de population et une mobilisation du travail féminin. Les hommes sont alors libres pour le pastoralisme.
Cette évolution est ensuite confrontée à la théorie du clivage socio-ethnique , décrit en 1861 par Speke. Le groupe Tutsi est décrit sur trois bases : comparaison de traits avec les Somalis, présence dans l’entourage des souverains et descendants d’une invasion venue d’Abyssinie. En fait cette théorie est née dans le contexte idéologique et politique de cette anthropologie raciale : Tutsi = Hamite = Sémite = supérieur [citation du médecin belge Sasserath, 1948 – p58].
Aujourd’hui l’explication d’une différence biologique entre Hutu et Tutsi est attribuée à une adaptation à des niches écologiques différentes qui expliqueraient la « dérive » génétique.
Que dit l’histoire, la tradition orale ?
La culture orale parle de groupes à vocation socio-économique : Batutsi + vache / Bahutu + houe et Batwa + pêche et poterie. Selon la légende, des épreuves initiales entre les enfants d’un roi mythique auraient imposé une affectation socio-professionnelle à chacun de leur descendant. Le mythe fonde ainsi l’existence de « castes » comparables à celles des forgerons ou des griots de l’Afrique sahélienne, avec des interdits alimentaires et des gestes codifiés qui peuvent avoir eu une influence sur les caractères physiques des groupes.
Le rapport entre élevage et agriculture serait donc une marque de rationalité sociale prémices d’une inégalité politique. En fait les relations entre agriculture et élevage varient selon les régions.
Emergence de la royauté : pouvoir et religion
Durant la période du XVIe au XIXe siècle, se mettent en place de véritables Etats avec à leur tête le « MWAMI », roi. C’est une longue évolution à partir des réseaux claniques. Le clan est un groupe patrilinéaire à ancêtre commun, avec parfois un interdit totémique. Le clan s’appuie souvent sur la maîtrise du sol, gestionnaire du passé et du sacré, d’un réseau de lieux de mémoire inscrits dans le sol, et sur des légendes des origines comme celle de « l’empire des Bacwesi » au Nord. Elle décrit une manière de mythe grecque avec rivalités, vengeance et catastrophes où l’on voit apparaître tous les éléments de la culture bantoue : le gros bétail, la forge, la pêche et la poterie. Cette légende semble être plus religieuse qu’historique, ces héros sont d’ailleurs surnaturels. Il existe des légendes parallèles dans le Sud.
Aux XVe-XVIe siècles, la concurrence sur l’espace, la pression démographique entraînent une crise des relations politico-économiques et une multiplication d’entités politiques. Les mythes recouvrent sans doute une période de crise et légitime une autorité royale, réaffirmée dans des rites très codifiés et fortement religieux qui font du roi un médium entre nature et culture [p.109].
Au XVIIIe siècle, véritable apparition de formes de pouvoir royal, : pouvoir suprême d’un homme, règles de transmission dynastique, références religieuses, contrôle d’un territoire sur les plans militaire, fiscal et juridictionnel.
Constitution des États monarchiques
Évolution complexe des pouvoirs dans une région très vaste. L’auteur privilégie l’idée d’un roi- arbitre dans la concurrence agriculteurs/pasteurs et agriculteurs/forgerons dans un contexte de crise environnementale. La protection est fournie contre un tribut qui permet le développement d’une aristocratie. L’analyse s’appuie en particulier sur le royaume Bunyoro ou Kitara au Nord.
Un royaume, c’est une capitale royale, pas une ville, mais le » reflet et la récapitulation du paysage agro-pastoral » : greniers, enclos à bétail, cases royales, lieux de décision + lieu sacré avec son groupe de serviteurs/dignitaires. Dans certains royaumes, comme au Rwanda on a une mise en scène du partage des tâches entre Bahutu : dignitaires chargés des greniers et Batutsi : dignitaires gardiens des troupeaux. Le système repose sur des fidélités claniques, fidélités individuelles, fidélités des proches parents du roi. Il existe un système de taxation en nature au profit des chefs locaux, du roi (4 à 10%). L’auteur récuse pour qualifier ce système l’emploi du mot féodal que l’on trouve chez les auteurs de la fin du XIXe siècle.
Peut-on parler de domination du pastoralisme ?
C’est au XIXe siècle colonial que la domination des éleveurs se met en place avec l’institution du gikingi, attribution d’un domaine en réserve pastoral à un dignitaire. L’auteur évoque les autres denrées d’échange, le commerce renforce le pouvoir économique des souverains et de leur cour.
Tutelles coloniale et reconstructions de la tradition
L’auteur revient sur les rêves européens : quête des sources du Nil, mythe d’un lien avec le royaume du Prêtre Jean, appétit du roi des Belges et découpage colonial. Le tout dans un contexte de catastrophe écologique et démographique : 1891, peste bovine, 1892, variole, 1894 éruption du Nyragongo… véritables traumatismes qui déstabilisent le système économique, les rapports entre groupes, les repères au moment où se met en place la domination européenne. Le tableau des rapports entre autorités coloniales, missions et royautés en montre toute l’ambiguïté dans l’Ouganda anglais. L’auteur analyse ensuite l’influence allemande entre les lacs Victoria et Tanganyika et la domination belge avec la « fossilisation » des catégories née de l’immatriculation raciale Hutu-Tutsi. L’auteur cherche ici à comprendre pourquoi l’opposition entre les deux groupes a pu, au Rwanda et au Burundi devenir « obsessionnelle », nourrie des choix de l’administration belge utilisée une aristocratie comme relais , l’éduquée dans l’idée de sa « supériorité ». C’est ensuite le cas du Kivu qui est analysé.
Les indépendances
Les indépendances de l’Ouganda et du Rwanda se déroulent un climat général et durable de violence. Dans le contexte de l’indépendance très violente du Congo en 1960-61 surviennent les premiers heurs meurtriers entre les deux communautés. Les Tutsi vont devenir dans la région un groupe de réfugiés indésirables dont la présence occasionne divers massacres jusqu’aux événements de 1994. L’auteur analyse comment chaque camp a puisé dans les diverses versions de l’histoire les systèmes explicatifs qui pouvaient justifier sa politique : supériorité raciale contre refus du féodalisme. Il rappelle les événements de 94 puis montre que les causes en sont complexes, comparant avec le débat entre internationalistes et fonctionnalistes à propos de la Shoah. Pourquoi un tel poids du racisme alors que les héritages socio-anthropologiques sont identiques chez les voisins, ce qui revient à poser la question d’une spécificité de l’expérience coloniale au Rwanda-Urundi. Sont ensuite évoquées les suites au Kivu puis dans tout le Zaïre en 95 et 96.
On pourra conclure avec l’auteur sur la nécessité d’une histoire « qui , en ouvrant la réflexion sur la longue durée et sur les ruptures du passé, met en cause les fixations mémorielles. »