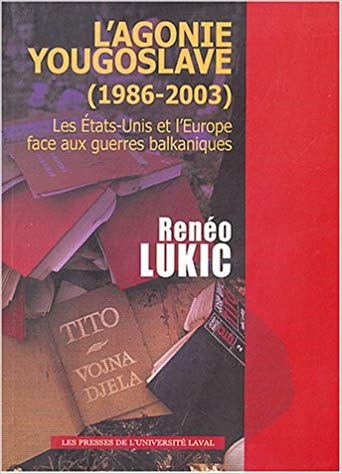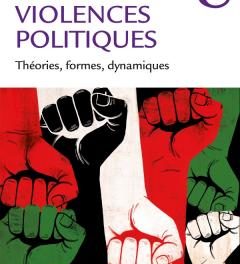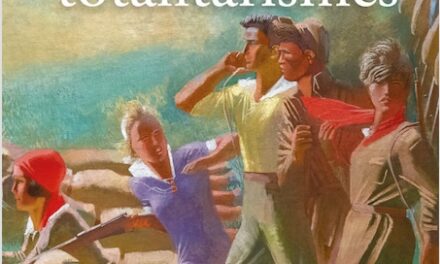Disons-le d’emblée, voici un ouvrage qui fera date. Comme le dit l’ancien ambassadeur de France en ex-Yougoslavie de 1991 à 1995 Georges-Marie Chenu dans la préface, c’est en effet la première fois que la « destruction-reconstruction » de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) est présentée dans sa continuité, de la réactivation du projet de « Grande Serbie » par l’Académie des arts et des sciences de Serbie en 1986, à la création de l’Union de Serbie-Monténégro en 2003. Ce travail complète avec bonheur les publications disponibles en français, partielles et déjà anciennes de Paul Garde, Vie et mort de la Yougoslavie, Fayard, 1992 et 2000 ; Jacques Rupnik, De Sarajevo à Sarajevo. L’échec yougoslave, Complexe, 1992, et Les Balkans. Paysage après la bataille, Complexe, 1996 ; Jean-Arnault Dérens, Balkans : la crise, Folio, 2000.
Renéo Lukic est actuellement professeur d’histoire des relations internationales à l’Université Laval de Québec. Il a quitté la Yougoslavie en 1980 et a préparé un doctorat à l’université de Genève, travail qui l’amené à séjourner à Belgrade dans les années 1980 pour dépouiller les archives de la Ligue des communistes de Yougoslavie, alors parti unique. Il a déjà publié plusieurs livres sur l’histoire de la Yougoslavie, dont Les relations soviéto-yougoslaves de 1935 à 1945. De l’indépendance à l’autonomie et à l’alignement à Berne en 1996 ; et Europe from the Balkans to the Urals : the desintegration of Yugoslavia and the Soviet Union à Oxford en 1996 en collaboration avec Allen Lynch. L’idée du présent ouvrage a pris forme lors de son séjour à Paris en 1998, lorsqu’il encadrait un séminaire à l’IEP sur « la construction et la déconstruction des Etats en Europe du Sud-Est au XXe siècle ».
Les archives officielles étant encore inaccessibles, l’auteur s’appuie sur différentes sources : ouvrages de spécialistes des Balkans, articles de presse, témoignages des principaux dirigeants occidentaux et de l’ex-Yougoslavie dans des livres de souvenirs, dépositions au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
Il est difficile de résumer l’ouvrage tant son contenu est dense, riche, et dépasse de loin l’intitulé du sous-titre. Il est composé de 11 chapitres regroupés en trois parties.
Une première sur « l’effondrement des régimes communistes en Europe et la prolifération des nouveaux Etats » traite des origines des crises yougoslaves.
L’auteur commence par analyser l’émergence de l’Etat-nation en Europe centre-orientale et dans les Balkans aux XIXe et XXe siècles comme un processus de longue durée (chap. 1 pp. 15-55). Les mouvements nationaux évoluent en fonction des mutations des systèmes internationaux successifs.
Ø Le premier d’entre eux, celui de Vienne (1815-1914), a pour objectif de tuer dans l’œuf les revendications nationales naissantes, mais le principe des nationalités – droit d’un peuple à l’indépendance sur un territoire – s’impose après 1848 au détriment des empires austro-hongrois et ottoman, six Etats-nations apparaissant dans les Balkans entre 1830 et 1912 : Grèce, Roumanie, Serbie, Bulgarie, Monténégro, Albanie.
Ø Le second système, celui de Versailles (1918-1938), voit les Etats-nations se multiplier sur les décombres des empires austro-hongrois et russe, mais les deux Etats multinationaux sont en difficulté car une nation en domine d’autres : les Tchèques en Tchécoslovaquie, les Serbes en Yougoslavie.
Ø Le troisième système, celui des nazis (1938-1945), entend supprimer les Etats multinationaux jugés contre nature : la Tchécoslovaquie est démembrée en 1939, la Yougoslavie en 1941.
Ø Le quatrième système, celui de Yalta (1945-1989), est tiraillé entre deux logiques contradictoires : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est réaffirmé, mais des Etats indépendants restaurés sont incorporés dans la sphère d’influence soviétique.
Ø Le cinquième système, post-communiste, sous l’effet de la décolonisation externe et interne de l’empire soviétique, débouche sur la création de nouveaux Etats-nations – Slovénie, Croatie, Macédoine, Slovaquie – et de deux Etats multinationaux : la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et la Bosnie-Herzégovine. Une des deux idéologies universalistes nées en 1848, le nationalisme, l’emporte sur l’autre, l’internationalisme prolétarien.
Dans un second chapitre (pp. 57-85), Renéo Lukic dresse un bilan sévère du fédéralisme en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et en URSS, régime qualifié de « total-fédéralisme » par Vaclav Havel. A la différence de la Belgique, de la Suisse, du Canada et des Etats-Unis, ces trois Etats ne sont pas des fédérations véritables parce qu’il n’y a ni Etat de droit, ni institutions supranationales démocratiques, ni espace économique unifié, ni société civile développée, et qu’une nation domine les autres (Tchèques, Serbes, Russes).
Du temps de Tito, le leader charismatique a arbitré avec poigne les conflits entre et dans les six Républiques : Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine. Après sa mort en 1980, les Républiques et provinces autonomes – Voïvodine, Kosovo- ont accéléré le processus d’autonomie politique par rapport à l’Etat fédéral institutionnalisé en 1974. Les nationalismes serbe, croate, slovène et albanais ne s’expriment pas simultanément et sont basés sur des objectifs différents : les Slovènes autour de Milan Kucan veulent une République indépendante et démocratique, alors que les Serbes avec Milosevic aspirent à un Fédération centralisée et socialiste.
Cependant, R. Lukic, contrairement à Stevan K. Pavlowitch (The improbable survivor : Yugoslavia and its problem 1918-1988), reconnaît que le fédéralisme titiste n’est pas un échec complet, plusieurs de ces composantes étant satisfaites : les Monténégrins ont retrouvé un statut d’Etat partiellement indépendant en 1946, les Macédoniens ont obtenu la reconnaissance nationale et territoriale la même année, les Musulmans bosniaques la reconnaissance nationale en 1968, les Albanais du Kosovo et les Hongrois de Voïvodine l’autonomie politique en 1974, les Serbes sont sur-représentés dans les instances fédérales et des Républiques, le pays est dans la première moitié des années 1980 un Etat aux frontières ouvertes, certes peu démocratique mais stable. Au lieu d’exploser, la Yougoslavie aurait pu connaître une évolution pacifique dans le cadre d’une fédération asymétrique, d’une confédération ou d’une sécession à l’amiable. Une telle évolution a été rendue impossible par l’absence de démocratisation simultanée dans les Républiques.
Dans un troisième chapitre, l’auteur étudie la désintégration de la RSFY de 1987 à 1991 (pp. 87-144). Milosevic s’impose à la direction de la Ligue des communistes de Serbie (LCS) en 1987. S’appuyant sur les nationalistes serbes (Dobrica Cosic, Vuk Draskovic, Vojislav Seselj, Vojislav Kostunica) et sur des manifestations de rue, il prend le contrôle de la Voïvodine en 1988, puis du Monténégro et du Kosovo en 1989, et dispose ainsi de 4 voix sur 8 à la présidence collective fédérale. Le nouveau système de gouvernement serbe, qualifié de « total-nationalisme » par Edgar Morin, de « sultanisme » par Robert Thomas, de « demokratura » par Timothy Garton Ash, repose sur un pouvoir autoritaire et populiste, un Etat corporatif et mafieux, un nationalisme ethnique. L’objectif de Milosevic est de rebâtir une fédération centralisée contrôlée par les Serbes et de bâtir une « Grande Serbie » incluant le Kosovo, la Voïvodine, la Macédoine, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Slavonie et la Dalmatie. Mais il se heurte à l’opposition des Slovènes et des Croates, qui optent pour une solution négociée au Kosovo, le pluralisme politique et une confédération yougoslave, et sont soutenus par les Macédoniens et les Bosniaques.
Au XIVe congrès de la LCY en janvier 1990, les délégations slovène et croate se retirent, et Milosevic prévoit la guerre dès le mois suivant. Milan Kucan en Slovénie et Franjo Tudjman en Croatie sont élus présidents et proposent un projet de confédération, que rejettent la Serbie et le Monténégro (Momir Bulatovic), le projet de compromis de la Macédoine (Kiro Gligorov) et de la Bosnie-Herzégovine (Alija Izetbegovic) échouant également. La Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance en juin 1991, ce qui provoque une réaction belliqueuse de la Serbie et du Monténégro.
La deuxième partie traite des « guerres yougoslaves de 1991 à 2001 » : l’intervention de l’Armée fédérale en Slovénie de juin à octobre 1991, puis en Croatie de juillet 1991 à janvier 1992 (chap. 4 pp. 148-195) ; la guerre en Bosnie-Herzégovine d’avril 1992 à octobre 1995 (chap. 5 et 6 pp.197-314) ; l’intervention de l’OTAN au Kosovo de mars à juin 1999 (chap. 7 pp. 315-375) ; la guerre en Macédoine de mars à juillet 2001 (chap. 8 pp. 377-439).
Le récit des différentes opérations militaires est très succinct, l’auteur privilégiant l’analyse des responsabilités des dirigeants des ex-Républiques yougoslaves, et des fluctuations des réactions de la communauté nationale.
Renéo Lukic rejette les thèses serbophiles selon lui erronées, qui ont aveuglé les décideurs occidentaux pendant des années :
Ø Les Serbes seraient victimes d’un complot, et d’une épuration ethnique de la part des Albanais au Kosovo (Branko Petranovic et Momcilo Zecevic 1985, Dobrica Cosic 1994).
Ø Les Slovènes seraient responsables de la désintégration yougoslave, les élites étant imprégnées de racisme à l’égard des Serbes (Milica Bakic-Hayden et Robert M. Hayden, 1992), et faisant preuve d’égoïsme national pour des motifs économiques, refusant de subventionner les régions moins développées du Sud (Pascal Boniface, 1998).
Ø La proclamation de l’indépendance par la Slovénie et la Croatie serait une provocation et non une réaction face aux menaces de Milosevic (François Mitterrand, John Major, Georges Bush)
Ø Tous les dirigeants seraient responsables de l’éclatement de la Yougoslavie (John R. Lampe 1996, Susan L. Woodward 1995, Steven L. Burg et Paul Shoup 1999, Régis Debray, Ignacio Ramonet).
Ø Alija Izetbegovic voulait créer un Etat islamique en Bosnie Herzégovine (Radovan Karadzic), et a mené une politique de ré-islamisation autoritaire (Xavier Bougarel 2001).
Ø Les conflits yougoslaves seraient des guerres civiles dues à des haines interethniques ancestrales impossibles à juguler (Robert D. Kaplan 1993), des guerres de religions entre catholiques, orthodoxes et musulmans (Samuel Huntington).
L’auteur souligne à maintes reprises la responsabilité écrasante de Milosevic, reprenant les analyses de Sabrina Ramet, Paul Garde, Branka Magas, Florence Hartmann, Vidosav Stevanovic et Noel Malcolm. Le dirigeant serbe a préparé dès 1988 une guerre de conquête sur quatre fronts (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo) qu’il a su enchaîner successivement, renonçant en 1992 à occuper militairement la fragile Macédoine du président Gligorov pour ne pas avoir à combattre sur deux fronts simultanément. Les guerres yougoslaves sont clausewitziennes, car elles sont le prolongement d’un projet politique, la « Grande Serbie », par des moyens militaires, Milosevic n’ayant pas réussi à obtenir une majorité des voix au sein de la présidence collective fédérale. L’attaque militaire de la RFY contre la Bosnie-Herzégovine est un conflit armé international, et les véritables guerres civiles y opposent Croates favorables et opposés à la partition (même chose entre Serbes), et troupes bosniaques rivales entre elles. Les atrocités commises par les Serbes dépassent largement en proportion celles des Croates et des Bosniaques.
Les responsabilités des autres acteurs sont cependant mises en évidence :
Ø Une fois l’indépendance acquise, les dirigeants slovènes ne sont pas impliqués dans les autres conflits yougoslaves, tournant leur regard vers l’Europe occidentale.
Ø Le président croate Tudjman n’a pas rassuré les Serbes de Croatie en se prononçant pour un Etat ethnique et en tenant des propos xénophobes, facilitant ainsi la radicalisation des Serbes nationalistes liés à Milosevic dont Milan Babic. Tudjman n’a pas soutenu la Slovénie en 1991 et a préféré négocier directement avec le dirigeant serbe pour le partage de la Bosnie-Herzégovine et la réalisation d’une « Grande Croatie ». Il a soutenu les nationalistes croates radicaux de Bosnie-Herzégovine favorables à la division de la République dont Mate Boban, qui se sont livrés à l’épuration ethnique dans les territoires qu’ils contrôlaient en Herzégovine.
Ø Le président bosniaque Izetbegovic a aussi laissé les mains libres aux Serbes en Slovénie et en Croatie, cherchant à ne pas provoquer Milosevic et à négocier avec lui. Pensant ainsi éviter la guerre, il n’a pas préparé son pays à celle-ci.
Ø Le président monténégrin Bulatovic a soutenu la politique de Milosevic jusqu’en 2000, et son premier ministre Milo Djukanovic jusqu’en 1996.
Ø Les nationalistes albanais de l’UCK ont renoncé à la politique de résistance passive menée par Ibrahim Rugova depuis 1989, et se sont lancés dans la lutte armée contre les Serbes au Kosovo à partir de 1996. Leurs homologues de l’UCPMB ont fait de même dans la vallée de Presevo en Serbie du Sud en 2000, et ceux de l’UCK (M) en Macédoine en 2001. Ils sont ainsi devenus le principal facteur de déstabilisation des Balkans en prônant une « Grande Albanie ».
L’impuissance de la communauté internationale à prévenir et stopper les guerres yougoslaves est également mise en valeur :
Ø La CEE avait pour mission principale l’intégration économique de l’Europe occidentale, et non la régulation des crises politiques sur le continent. Aussi est-elle intervenue d’abord pour empêcher la désintégration yougoslave – reconnaissance tardive de l’indépendance de la Slovénie et de la Croatie en janvier 1992 et de la Bosnie-Herzégovine en avril 1992-, puis pour limiter ses effets déstabilisateurs. Elle a mené une politique d’apaisement diplomatique envers la Serbie, d’aide humanitaire et d’endiguement, par un embargo sur les ventes d’armes sur tout le territoire de l’ex-Yougoslavie – favorisant ainsi la Serbie – et l’envoi de troupes à la frontière entre la Serbie et la Macédoine. La fameuse visite de François Mitterrand à Sarajevo le 28 juin 1992 a constitué une reconnaissance de facto de la partition de la Bosnie-Herzégovine, puisqu’il a rencontré Izetbegovic et les fauteurs de guerre serbes Karadzic et Mladic. Les plans Vance-Owen de 1992 puis Owen-Stoltenberg en 1993 n’ont fait qu’entériner la politique d’épuration ethnique menée par les Serbes en Bosnie-Herzégovine. Les dirigeants français et britanniques se sont longtemps opposés à une intervention militaire contre les Serbes, les hommes de la FORPRONU étant selon eux menacées sur le terrain.
Ø La Grèce a refusé de reconnaître la Macédoine comme une république indépendante, et a mené de concert avec la Serbie une politique de déstabilisation de ce territoire pour qu’il réintègre la RFY.
Finalement, c’est selon Renéo Lukic l’intervention des Etats-Unis qui a été déterminante pour mettre fin aux conflits en Bosnie-Herzégovine puis au Kosovo.
Les partisans d’une intervention armée ont longtemps été minoritaires à Washington : le futur assistant du Secrétaire d’Etat pour les affaires européennes et canadiennes Richard Holbrooke, l’ambassadrice à l’ONU Madeleine Albright, le membre de l’état-major Wesley Clarke. Une majorité redoutait en effet un enlisement des troupes américaines comme au Vietnam et en Somalie, dont le secrétaire à la Défense Dick Cheney et le chef de l’état-major inter-armé Colin Powell. Le président Bush a donc privilégié la démarche diplomatique et laissé à la CEE et à l’ONU le soin de gérer le dossier, considérant que les intérêts vitaux des Etats-Unis n’étaient pas en jeu, l’attention de l’administration américaine étant alors polarisée par le Proche et Moyen-Orient.
Pendant la campagne présidentielle de 1992, Bill Clinton s’est prononcé pour une intervention militaire, mais une fois élu, il suit la politique de son prédécesseur pour ne pas se couper de ses alliés européens. L’émotion suscitée par les exactions serbes l’amène à changer de politique : contournement de l’embargo permettant d’équiper les armées croates et bosniaques et ainsi de rééquilibrer l’état des forces en Krajina (partie de la Croatie sous contrôle serbe) et en Bosnie occidentale, menaces de frappes aériennes contre les positions serbes en Bosnie pour les forcer à négocier. La prise des enclaves protégées de Srebrenica et de Zepa et un nouveau bombardement du marché de Sarajevo par les Serbes en août 1995 poussent Jacques Chirac et John Major à accepter les frappes de l’OTAN. Les négociations qui débutent après la signature du cessez-le-feu en octobre débouchent sur les accords de Dayton, qui entérinent la partition de la Bosnie-Herzégovine en deux entités : la République serbe et la Fédération croato-musulmane.
Devenue Secrétaire d’Etat, Madeleine Albright a pesé de tout son poids pour que l’OTAN intervienne une seconde fois en 1999 pour forcer l’armée serbe à évacuer le Kosovo.
Lors de la campagne de 2000, Georges W. Bush s’est prononcé pour un retrait des forces américaines des Balkans, provoquant le mécontentement des Européens. La nécessité de préserver la cohésion de l’Alliance atlantique dans le contexte de « guerre contre le terrorisme » a poussé l’administration Bush à revenir sur sa position à partir de 2001 (chap. 9 pp. 441-466).
La troisième partie sur « l’espace politique post-yougoslave au lendemain des guerres » s’interroge sur les perspectives de paix durable dans la région. L’auteur ne pèche pas par optimisme, soulignant les nombreuses difficultés qui restent à surmonter, et la nécessité du maintien de la présence de la communauté internationale en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Macédoine.
La normalisation des relations entre Serbes et Croates est relative (chap. 10 pp. 469-506). Si une mission de l’ONU a favorisé l’intégration des Serbes de Croatie restés en Slavonie orientale, si la victoire de l’opposant à Tudjman Stipe Mesic et de l’opposant à Milosevic Vojislav Kostunica en 2000 ont permis une détente – baisse des budgets militaires, relance des relations économiques, accord sur le retour des réfugiés -, la méfiance reste réciproque, attisée par la force du mouvement rouge-brun en Serbie, qui a provoqué l’assassinat du premier ministre Zoran Djindjic en 2003 et protège de nombreux criminels de guerre dont Karadzic et Mladic.
La survie de la RFY créée en 1992 est menacée par la poussée du mouvement indépendantiste au Monténégro relayée par le président Djukanovic, élu en 1997 (chap. 11 pp. 509-558). Une intervention diplomatique de l’UE soutenue par les Etats-Unis a débouché sur la création de l’Union de Serbie-Monténégro, et différé le référendum sur l’indépendance jusqu’en 2006. Le processus de désintégration de l’ex-Yougoslavie n’est donc pas complètement achevé.
Certains lecteurs pourront parfois être irrités par des affirmations de Renéo Lukic ouvertement atlantistes : « l’intervention de l’OTAN au Kosovo a été une guerre humanitaire et juste ». On peut aussi discuter certaines appréciations sur la Yougoslavie titiste : « Etat totalitaire », pas d’espace économique unifié, pas de société civile développée, domination des Serbes.
Mais il est évident que son ouvrage est une référence incontournable sur le sujet, par la rigueur de sa démonstration, sa démarche comparative sur la longue durée, sa maîtrise de l’historiographie et des sources disponibles, la qualité des documents proposés – même s’il manque une carte du Kosovo et les tableaux des principaux partis politiques en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Slovénie -, les nombreux liens internet signalés dans les notes infrapaginales.
Etudiants, enseignants et chercheurs trouveront matière à réflexion sur les relations internationales du début du XIXe siècle jusqu’à nos jours, nations, nationalités et nationalismes, communismes et sorties du communismes, la singularité de l’espace balkanique.