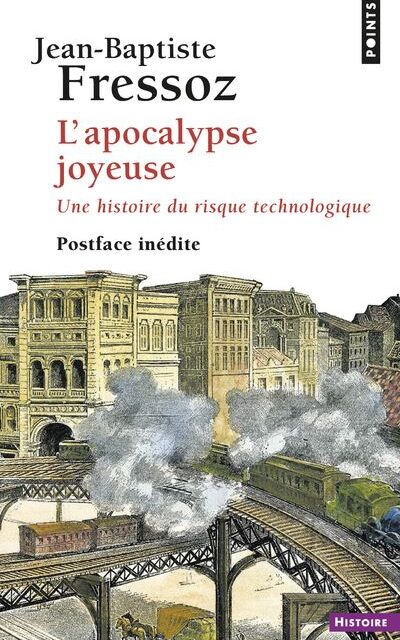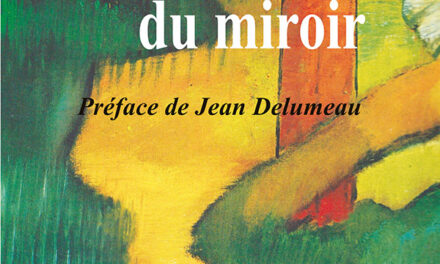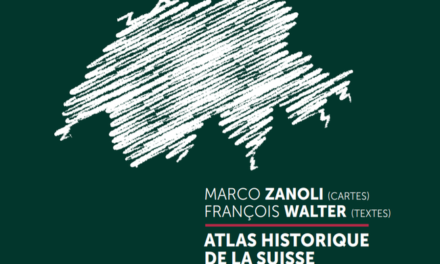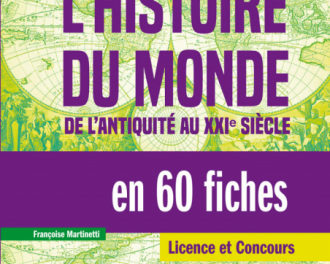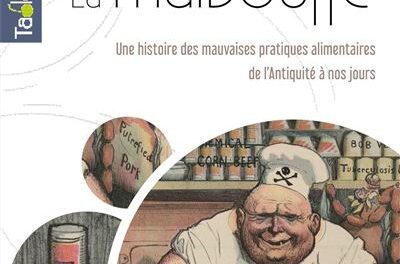Compte rendu réalisé par Eléonore Susini, étudiante en classe d’hypokhâgne (2024-2025) au lycée Claude Monet de Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Présentation
Né en 1977, Jean- Baptiste Fressoz, est un historien des sciences, des techniques et de l’environnement, chercheur au CNRS. Après une classe préparatoire lettres et sciences sociales (filière B/L), il intègre l’École normale supérieure Paris-Saclay, puis soutient en 2009 une thèse en histoire à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales intitulée La Fin du monde par la science. Maître de conférences à l’Imperial College London, il est actuellement chargé de recherche au CNRS et membre statutaire du Centre de recherches historiques de l’EHESS. Auteur d’ouvrages historiques portant sur l’histoire de l’environnement, du climat et de la notion « d’anthropocène », il publie L’Apocalypse joyeuse : une histoire du risque technologique (Éditions du Seuil, 2012), avec Christophe Bonneuil L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, (Editions du Seuil, 2013), et de nombreux autres publiés encore récemment. Il tient aussi une chronique mensuelle dans Le Monde.
L’apocalypse joyeuse : une histoire du risque technologique est le résultat de dix années de recherches. Un ouvrage dans lequel l’auteur s’adresse à tous, hommes et femmes du XXIe siècle, qui sommes conscients de la crise environnementale actuelle. L’ouvrage vise à déconstruire l’image de siècles « technophiles », qui donne à penser que nous sommes les premiers à prendre conscience des dangers du progrès. Au contraire, il démontre que les sociétés de l’époque étaient conscientes des risques liés aux innovations mais ont choisi de les ignorer. Ce livre retrace ainsi une histoire politique du risque technologique en montrant que la dégradation environnementale n’est pas le fruit d’une ignorance involontaire mais d’une ignorance calculée, et donc volontaire, ayant mené à la crise actuelle. Composé de six chapitres, eux-mêmes divisés en sept à onze sous-parties, l’ouvrage explore des controverses, telles que celles autour de l’inoculation, de la vaccination, de l’industrie chimique, du gaz d’éclairage, de la machine à vapeur et du chemin de fer. Ces controverses y sont comme des cas montrant comment des dispositifs politiques et scientifiques, qualifiées dès l’introduction de « désinhibitions modernes » par l’auteur, ont été mis en place pour rendre ces innovations acceptables et gérer les tensions entre conscience des risques et progrès technique. Les six chapitres sont suivis d’une postface portant sur le rôle de l’histoire face à l’anthropocène, chacune des parties de cet ouvrage est alimentée d’un grand nombre de sources diverses telles que des revues scientifiques, juridiques ou encore des archives.
Résumé
Le premier chapitre traite de la controverse autour de l’inoculation de la petite vérole et de l’émergence du risque comme application des probabilités à la vie des individus à partir des années 1720. L’inoculation représente une innovation majeure liée à la révolution démographique et au projet des Lumières d’auto-gouvernement rationnel. Elle consiste à injecter une forme atténuée de la maladie pour éviter une infection naturelle plus dangereuse, voire mortelle. Pourtant, cette nouvelle pratique divise : est-il légitime de courir un risque de mort et de le faire courir aux autres ? Deux visions s’opposent : la liberté individuelle de se protéger contre la discipline collective. Les premiers arguments probabilistes apparaissent à Boston en Nouvelle-Angleterre en 1721 lors d’une épidémie, portés par des pasteurs. Des médecins garants de l’autoconservation diffusent ensuite cette pratique sur tout le territoire anglais. L’auteur se concentre ensuite sur le cas de la France, en 1754, le discours de La Condamine à l’Académie des sciences lance un débat public qui oppose médecins, prêtres et philosophes. L’État tente de promouvoir l’inoculation par persuasion, y voyant un intérêt national et démographique dans un contexte de Guerre de Sept Ans. Mais la pratique reste marginale et mal acceptée tandis que l’inoculation est appliquée à grande échelle dans les colonies françaises dès 1756 sans scandale. En effet, en métropole, c’est un échec moral : en 1758, après quatre ans de propagande, moins de 100 inoculés à Paris. L’inoculation reste perçue comme égoïste et dangereuse, parfois interdite dans certaines villes par le parlement. Parallèlement, la solution de la quarantaine proposée par Jean-Jacques Paulet gagne alors en popularité. L’opinion publique, et en particulier l’aristocratie, influencée par la presse, les récits personnels et les réseaux mondains, alimente la réticence face à la pratique de l’inoculation. L’auteur montre ainsi que le risque, en tant qu’outil de gouvernement, ne suffit pas à guider les comportements : il faudra d’autres formes de preuve et de pouvoir pour faire advenir une société vaccinée, ce qu’il démontre dans le chapitre suivant.
Le deuxième chapitre traite du cas de la vaccination antivariolique. L’auteur y explique son succès là où, à contrario, l’inoculation avait échoué, grâce à des techniques efficaces de preuve et de pouvoir mises en place par l’administration napoléonienne, ayant entrepris de présenter le vaccin comme totalement bénin afin d’annuler les anciennes réticences. Cette stratégie relève d’une manipulation perceptive destinée à aligner les consciences avec la technique, renforçant ainsi le biopouvoir. L’auteur évoque la figure centrale du « médecin philanthrope » dans la société révolutionnaire incarnant la volonté de mettre en place une vaccination pour tous et surtout gratuite. La diffusion de représentations graphiques de la vaccine typique et le contrôle strict de l’information par des comités de médecins afin de dissimuler les accidents, notamment dans la presse, permettent de forger une perception positive du vaccin. En combinant sélection de l’information, mise en scène visuelle et usage de données statistiques, les autorités médicales et politiques parviennent à faire accepter largement la vaccination dans la société.
Les troisième et quatrième chapitres abordent un paradoxe : celui de l’altération des choses environnantes par l’industrialisation en dépit des théories médicales dominantes faisant de l’environnement le déterminant même de la santé et des formes du corps humain. L’auteur étudie le cas de la France et l’essor du capitalisme chimique dès les années 1780, qui transforme radicalement la régulation environnementale. Ce changement se traduit par le passage de la « police urbaine » d’Ancien Régime à un cadre libéral. L’ancien régime, à travers la police urbaine et les corporations, encadrait les activités polluantes au nom de la salubrité publique. La gestion coutumière de l’environnement, illustrée ici par le cas de la récolte du varech, connaît un tournant à cause de la centralisation administrative et de l’usage de savoirs naturalistes, laissant ainsi libre cours à l’exploitation intensive de cette ressource mais aussi à l’essor de l’industrie chimique. La nouvelle régulation environnementale libérale s’incarne par le décret de 1810 qui autorise les usines et exclut la pollution industrielle du domaine pénal. Cette libéralisation de l’environnement favorise les intérêts industriels tandis que l’hygiénisme des années 1850 minimise les effets sanitaires de la pollution, notamment sur la santé ouvrière en les attribuant à la misère, et non aux conditions de travail. En parallèle, un système de compensation monétaire des dégâts environnementaux se met en place pour les usines chimiques, avec pour finalité de favoriser leur prospérité plus que pour les inciter à dépolluer comme l’entend pourtant le gouvernement. L’auteur conclut que l’industrialisation du XIXe siècle a été rendue possible par un choix politique post-révolutionnaire mettant la prospérité nationale au-dessus des intérêts des citadins.
Le cinquième et sixième chapitres sont consacrés à la gestion des risques industriels, devenus très rapidement des questions politiques, à travers les cas du gaz d’éclairage à Paris, de la machine à vapeur et du chemin de fer. Des normes techniques sont imposées par le gouvernement dès 1823 aux gazomètres et machines à vapeur permettant un risque à la fois contrôlé et légalisé. De plus, ces normes apaisent les controverses liées à la crainte de potentielles explosions ou mauvaise gestion de la ressource que pouvait engendrer l’utilisation du gaz, ce qui témoigne déjà d’une certaine réflexivité. Finalement, la controverse a tenu un rôle de sécurisation : elle a poussé à une amélioration technique et une réglementation minimale. Dans le sixième chapitre, l’auteur aborde également la question juridique de la faute à la suite de cette normalisation qui a fait des innovations des objets « prévisibles ». J-B Fressoz montre comment cette nouvelle « prévisibilité » des objets a transféré la responsabilité juridique des accidents des patrons sur les ouvriers. Cette logique est contestée dès les années 1840 et, à la fin du XIXe siècle, la loi de 1898 sur les accidents du travail introduit une responsabilité sans faute. Les ouvriers sont indemnisés sans avoir à prouver la faute d’un tiers tandis que les patrons souscrivent une assurance collective, rendant les accidents calculables. Ainsi, loin d’être une régulation contraignante, le risque professionnel libère les industriels des normes de sécurité, intégrant même les corps ouvriers dans la logique capitaliste de compensation appliquée déjà aux « choses environnantes », où les dangers du progrès deviennent acceptables.
Appréciations
A travers L’Apocalypse joyeuse, Jean-Baptiste Fressoz nous plonge au cœur des débats intenses qui ont émergé autour des grandes innovations technologiques, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, et qui ont façonné l’avènement de la société industrielle. Contrairement aux discours actuels racontant une prise de conscience environnementale récente, l’auteur démontre que les sociétés passées avaient déjà consciences des risques de ces innovations mais que les critiques et contestations furent surmontées et réduites au silence par des dispositifs ayant rendu ces innovations « acceptables » que l’auteur analyse et révèle dans cet ouvrage. L’historien adopte alors une démarche originale qui, à travers l’étude de chacune des controverses, a le mérite de redonner une voix aux « perdants » de l’histoire qui s’étaient indignés très tôt de la dégradation de leur environnement afin de déconstruire le mythe ancré dans notre temps contemporain d’une société passée qui n’avait pas conscience des risques du progrès. Une démarche qui suscite la curiosité et le désir de savoir par quels moyens l’idée de réflexivité propre à la révolution industrielle a été enfouie. Une curiosité satisfaite avec succès par l’auteur qui s’efforce de faire réapparaitre et d’analyser de nombreux les dispositifs, stratégies et acteurs de cette ancienne société, qui constituent les rouages d’une « désinhibition moderne » qui ont été cachés. La période d’étude de l’ouvrage aurait mérité d’être prolongée vers le XXe siècle et d’inclure l’étude des processus de « désinhibitions » qui ont permis l’avènement de la société de consommation, évoquée brièvement en conclusion de l’ouvrage. L’intérêt actuel d’une telle étude historique et, par la même occasion, un éclaircissement concernant le choix du titre du livre sont bien explorés dans la postface. Après la lecture de l’ouvrage, nous sommes enclins à adopter un regard nouveau sur la gestion de la crise environnementale contemporaine et sur cet état « d’Apocalypse joyeuse » issu du sentiment rassurant que nous procure l’idée d’une société réflexive tournée vers l’avenir prenant maintenant en compte les risques liés à la modernité. L’ouvrage décrédibilise ce discours et nous invite à repérer les nouveaux processus de « désinhibitions » mis en place aujourd’hui.
Jean-Baptiste Fressoz signe un ouvrage accessible à tous, ne nécessitant pas de connaissances préalables malgré son aspect scientifique, qui s’équilibre parfaitement avec son aspect politique, dénonçant un pouvoir qui a passé sous silence les risques liés aux innovations au nom du progrès et de la prospérité économiques et qui, malgré les illusions, perpétue cette tradition.