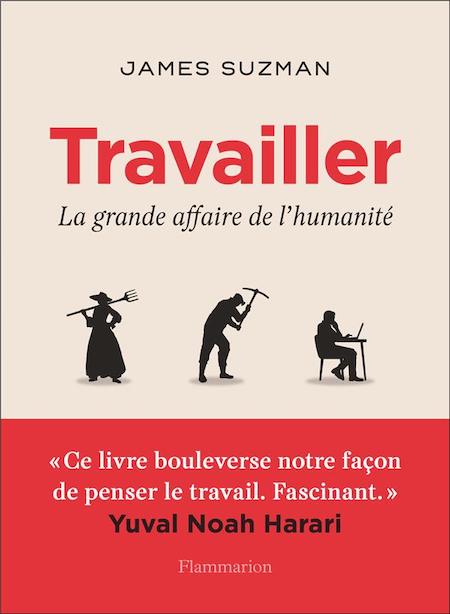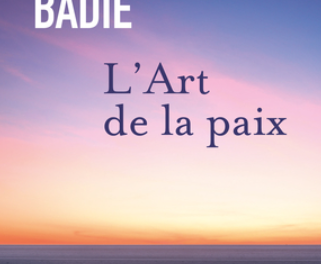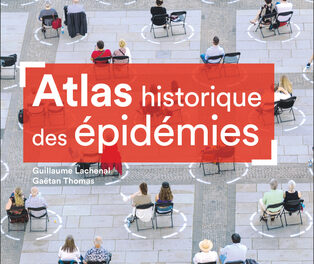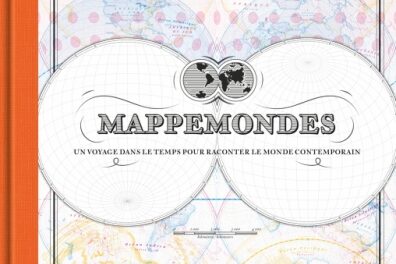Travailler est désormais un sujet omniprésent dans nos sociétés : prolongement de la durée de travail, sujet clivant entre les différentes couleurs politiques ou bien rapport à la société de consommation. A l’origine, tous ces questionnements nous renvoient à notre rapport à la rareté, que nous ne remettons que peu en cause. Pourtant, la rareté comme vecteur de valeur est loin d’être une conception universelle, même de nos jours. Chez les différents peuples de chasseurs-cueilleurs, le diamant n’a pas d’utilité.
Ce sont ces peuples, et surtout les Ju/’hoansi d’Afrique australe que James Suzman connaît très bien pour avoir analysé leur structure sociale et leur mode de vie pendant des années. Anthropologue au Robinson College de Cambridge et membre de la Royal Geographic Society, il est avant tout un homme de terrain très engagé en Namibie et au Botswana. Pourtant, pendant quelques années il a travaillé pour De Beers (extraction et exploitation de diamants), certainement avec les mêmes nobles intentions que Jared Diamond lorsque celui-ci a travaillé auprès de certaines multinationales.
Son travail de synthèse concernant l’objet conceptuel qu’est le travail, en tant que mécanismes biologiques, pratiques, statuts ou communautés, nous interroge tout d’abord sur sa définition. De quoi parle-t-on ? Du salariat ? De toutes activités créatrices ? Y intègre-t-on les loisirs ? Le travail est alors définit de façon large comme « le fait de dépenser intentionnellement de l’énergie ou des efforts sur une tâche afin de parvenir à un but, à une fin ». Deux dimensions entrent donc en jeu : d’une part notre rapport à l’énergie et à sa capitalisation (étymologiquement, terme renvoyant à la tête de bétail et donc à l’agriculture et à l’élevage) ; de l’autre, l’évolution biologique et culturelle de l’humain et des sociétés qui lui sont liées. Des moments de rupture se dessinent alors, de la maîtrise du feu à la révolution technologique et numérique en passant par la sédentarité, l’agriculture, l’urbanisation et la Révolution industrielle.
La vie organique et le travail : l’apport de la biologie
Le travail ne se limite pas au salariat. La définition du terme est avant tout établie en science par Gaspard-Gustave Coriollis qui s’intéresse aux mouvements des corps célestes. Il s’agit donc de l’énergie mobilisée pour effectuer un déplacement. Par cette première définition, le travail sépare la vie active d’une certaine forme de mort. On peut la comprendre comme une volonté d’ordonner l’entropie, qui, selon le second principe de la thermodynamique, est l’état final de notre univers, dans le but de diffuser l’énergie partout de façon égale. A ce titre, Erwin Schrodinger propose une interprétation de la vie comme étant cette force de dispersion de l’énergie, par son travail, et donc sa dépense énergétique. George A. Miller vient compléter cette analyse suite à la découverte des gènes, ces molécules qui viennent organiser toutes les autres. Il propose l’idée de cellules informavores, dont le seul but est d’organiser la dépense de l’énergie en trouvant les informations nécessaires à cette dépense. Au final, pour les sciences « dures », vivre c’est travailler.
Évidemment, la dépense d’énergie dans un but prédéfini, principalement celui de survivre, est une définition très large du travail. Il est donc possible d’y ajouter les caractéristiques de la technicité (compétences, outillage, perfectionnement), de l’intentionnalité (et de la projection) ainsi que, ensuite, de la recherche esthétique et de la virtuosité. L’humanité partage la première partie de ces conceptions avec quelques animaux. L’exemple le plus développé est celui des tisserins, oiseaux d’Afrique australe et orientale qui construisent et détruisent cycliquement leurs nids dont la constitution est pourtant extrêmement complexe. Ce qu’une analyse anthropomorphique pourrait prendre pour de l’entraînement n’est en réalité qu’une façon de dépenser l’énergie disponible. De même, le rapport à la collectivité de travail n’est pas propre à l’humain : les colonies de thermites sont socialement structurées en classes de travailleurs dont certaines n’ont pas un rôle de capteurs d’énergie et vivent grâce au travail des autres.
Pourtant, l’humain a le monopole de certaines formes de technicité : il est le seul à créer des outils dont le but est d’en produire d’autres plus complexes ; le seul aussi à esthétiser ses objets en passant du temps (et donc de l’énergie) à leur apporter une forme particulière. De même, ses rapports sociaux sont bien plus complexes, surtout pour un mammifère. L’eusociabilité qui nous définit, cette organisation intergénérationnelle où les individus collaborent pour combler leurs besoins énergétiques, au besoin via un sacrifice individuel, est le seul processus volontaire, complexifié par des normes sociales qui existe chez les mammifères.
Pour aller plus loin, il est la seule espèce à prendre en charge systématiquement ceux qui sont trop vieux ou faibles pour se nourrir seuls. Par ses pratiques – et donc son travail – l’humain s’est distingué progressivement du monde animal et a développé certaines parties de son cerveau comme l’aire de Broca qui est directement rattachée à la hiérarchisation des idées. Se projeter et penser par étape est un vecteur du développement et de la complexification croissants des outils (du biface acheuléen vers l’arc et ainsi de suite) mais aussi du langage en séparant le signifiant du signifié.
La rupture évolutionniste et culturelle de la maîtrise du feu
Le feu représente une véritable rupture dans le développement physique de l’humain, mais aussi dans son rapport au travail, au temps et à l’effort. Les paléoanthropologues ont mis en avant que les premières productions ont du avoir lieu de manière accidentelle vers 1,6 millions d’années. Les découvertes archéologiques laissent supposer que sa maîtrise systémique n’intervient que vers 400 000 ans avant notre ère. La dextérité nécessaire à sa réalisation laisse à penser que de longues expérimentations ont été nécessaires pour en arriver là.
D’un point de vue physique, l’anthropologue et primatologue Richard Wrangham est le premier à faire le lien entre la maîtrise complète du feu et le développement de notre cerveau et de son volume. Par le biais d’une alimentation renouvelée par la cuisson des aliments, aussi bien des viandes que des végétaux (tubercules notamment), les apports calorifiques augmentent significativement et permettent de faire fonctionner un organe cognitif plus performant. Le cerveau n’est pas le seul à se transformer avec le passage du cru au cuit : le tube digestif se rétrécit ; la puissance de la mâchoire se réduit. D’autres spécialistes mettent en valeur un rapport entre la cuisson/la bipédie et notre capacité à communiquer. En se redressant et ingurgitant des produits chauds, gorge, larynx et cordes vocales se développent et nous dotent de la possibilité d’échanger, de discuter, d’organiser le travail.
Au delà des apports nutritifs et de leurs conséquences sur le métabolisme, le feu est une révolution du mode de vie. Le temps passé à trouver son apport énergétique est considérable pour une majeure partie de la faune. En cuisant ses aliments, l’humain étend le panel des possibilités alimentaires. Il a accès à davantage de calories dans un temps record. De plus, en ingurgitant une masse alimentaire plus faible et en facilitant sa digestion par la même occasion, il n’est pas obligé de se reposer le reste du temps. La maîtrise du feu est donc la première avancée technique permettant d’économiser du travail.
La rupture est majeure et, par l’ennui salvateur qui en résulte, permet le développement des arts, du langage, de la culture tout en favorisant la conscience de soi. De plus, un cercle vertueux se met en place : l’humain, en dépensant moins de temps pour satisfaire ses besoins énergétiques, en profite pour utiliser son intelligence. La sélection naturelle n’est alors plus dépendante de la quantité de muscles produite mais par des capacités intellectuelles – parer à l’ennui en racontant des histoires par exemple. Cette période est propice au développement de l’esthétique des outils, à la création des premières formes d’art qui sont, finalement, des occupations autant qu’une certaine forme de travail.
La frontière entre travail et loisir commence déjà à se troubler. Enfin, cette évolution vers une intellectualité riche, une compréhension accrue du monde, nous entraîne petit à petit vers des sentiments plus fin tels que l’empathie ou l’introspection. Des preuves incontestables d’ensevelissements rituels ont été retrouvées et datées aux alentours de 300 000 ans avant notre ère.
Révolution conceptuelle du stockage : sédentarité puis apparition de l’agriculture
En 1966, Richard Borshay Lee organise la conférence « Man the hunter ». Cette rencontre vient confirmer les travaux de nombreux experts et anthropologues concernant le mode de vie des chasseurs-cueilleurs. Fruit des observations et de l’analyse directe de Lee en Afrique australe, une rupture se crée entre cette génération d’érudits et le consensus classique sur le sujet. Les chasseurs-cueilleurs ne sont pas des groupes de primitifs soumis aux caprices de la nature mais bien des groupes sociaux définis par une vie simple : pas de désirs artificiels, très peu soumis aux pénuries même en temps de sécheresse dans le Kalahari et nécessitant un effort de travail bien plus léger que les sociétés d’agriculteurs, au moins jusqu’à la Révolution industrielle. Évidemment, en synthétisant l’expertise de nombreux anthropologues, des différences notables peuvent être relevées. Par exemple, la prodigalité de l’environnement entraînera la sédentarité (communautés nord-américaines) alors que la rudesse du climat aura pour conséquence le nomadisme (communautés africaines).
Ces groupes ont en commun une certaine forme de confiance en l’avenir et l’environnement ce qui explique qu’ils ne voient pas de nécessité particulière au stockage. D’après les estimations, les individus de ces communautés doivent fournir un travail d’environ 36 heures par semaine, en comptant la recherche d’énergie et les tâches annexes. Il en ressort aussi des normes sociales fondamentalement différentes de l’individualisme matériel des sociétés agraires modernes. Les possessions sont communes et, par conséquent, ceux participant le plus à la captation des ressources nécessaires aux besoins sont régulièrement moqués afin de conserver la cohésion du groupe (et donc éviter qu’un individu prenne la tête du groupe). James Woodburn définissait ces groupe comme des sociétés à rendu immédiat, en opposition aux société agraires qui se basent sur des rendus différés.
Il est alors marquant de faire le constat que l’agriculture soit une détérioration des conditions de vie. Ce paradoxe relève de la mauvaise compréhension de l’articulation entre le passage à l’agriculture et le passage à la sédentarité. Pendant longtemps le milieu universitaire a formulé l’hypothèse que l’installation durable dans un même lieu a été une conséquence de l’apparition de l’agriculture. Or, il semblerait que ce ne soit pas le cas : les premiers groupes humains sédentaires sont des groupes de l’opulence, mais aussi des opportunistes face aux changements du climat. Un premier optimum climatique sur quelques millénaires a permis une hausse significative des températures et une modification de la nature des plantes accessibles.
L’humain a eu accès à une variété plus faible d’espèces végétales mais en plus grande quantité. Une énergie plus facile à acquérir ne nécessite plus forcément de grands déplacements, surtout si elle n’est plus réduite drastiquement durant les périodes d’hiver. Les chasseurs-cueilleurs s’installent mais ne stockent pas encore forcément. Avant le Mésolithique, une nouvelle période de refroidissement vient bouleverser l’équilibre créé : l’agriculture devient un besoin pour survivre, en remplissant de grands greniers à grains dont on a retrouvé des traces vers 12 000 ans avant notre ère. La plupart des hypothèses pointent la production de bière comme étant la première responsable de l’agriculture. L’alcool conserve les calories pendant l’hiver mais nécessite une abondance de matière première.
La rupture est majeure : il faut intégrer la compréhension de ses moyens de survie sur plusieurs saisons et se projeter. Conceptuellement, l’agriculture voit une frontière ontologique entre l’humain et l’environnement s’ériger. Il transforme la nature pour en faire sa débitrice par tous les efforts qu’il a fourni pour en obtenir sa subsistance. Les temporalités changent ainsi que les contraintes leur étant liées : les jours de repos, selon le moment dans la saison, ne peuvent être pris sans risques de voir sa récolte grandement diminuer. L’agriculture est dépendante des cycles saisonniers et des cycles de reproduction. Tout n’est plus qu’une potentialité à mettre en œuvre.
De plus, après l’adoption de la sédentarité, le retour à un mode de vie nomade n’est plus possible puisque l’outillage lourd ne peut pas être déplacé et la création des foyers a pu créer un attachement. Les recherches génomiques de plus en plus poussées permettent de tirer un bilan très négatif du passage à l’agriculture. L’espérance de vie à la naissance ne progresse pas et oscille entre 30 et 40 ans. Les communautés sont touchées par de lourdes carences alimentaires imputées à la faible diversité des productions. Les monocultures entraînent la proliférations de certains parasites qu’il faut éradiquer, rajoutant une charge de travail. La proximité mutuelle des bêtes au sein des troupeaux multiplient les maladies qui les touchent. La transmission à l’humain est fréquente.
La stérilisation des sols par le manque de connaissance des techniques de renouvellement des sols (assolement triennal maîtrisé tardivement) est créatrice de disettes. Sans compter que les progrès en terme de production et d’apport d’énergie sont, jusqu’à la Révolution industrielle, constamment compensés par la croissance démographique. Le travail n’est pas synonyme de prospérité.
L’urbanisation : communautés, statuts sociaux et inégalités
La formation des premières villes et leur développement ont impactés grandement notre façon d’organiser le travail. Bien qu’il soit difficile d’expliquer précisément le passage des villages aux villes, il semblerait que des lieux cérémoniels dans lesquels les gens se regroupaient pour des réunions saisonnières se soient fixés dans le temps. Quoiqu’il en soit, le constat est sans appel. Au début du Ier siècle, au moins un million d’habitants vit à Rome. La sédentarité et l’agriculture ont rapidement développé un besoin simple et constant : étendre le territoire occupé et l’aménager. Les progrès dans la captation et la production d’énergie ont permis une croissance démographique, et donc une croissance des besoins. Mettre en culture de nouveaux territoires devient alors un enjeu de survie, pour lequel la violence peut être requise. La réduction de la taille des territoires des chasseurs-cueilleurs et leur appropriation constante et volontaire ont réduit drastiquement les groupes non-sédentarisés : une forme différente d’organisation du travail s’est donc vue mettre en marge.
Une ville est avant tout un agglomérat d’individus partageant l’occupation d’un lieu. Il en résulte forcément l’existence de rapports sociaux qui se basent rapidement sur la répartition des tâches à effectuer pour faire fonctionner la communauté, qui n’est d’ailleurs plus tenu à la simple subsistance. De nouveaux emplois prolifèrent donc dans ce contexte spatial et social. Chacun se spécialise et propose ses services et productions aux autres. La nouveauté de la ville demeure dans la taille de la communauté qu’elle produit et va alors permettre la prolifération d’emplois qui ne sont plus du tout liés à la production des moyens de subsistance.
Dans le prolongement de ce constat, les emplois non-manuels se multiplient eux aussi et permettent la création d’une première forme d’aristocratie, dégagée de l’obligation de production et d’efforts physiques. En spectre à cette idée se créent par conséquent les premières classes laborieuses. Au delà de la maîtrise de l’écriture, ce sont surtout sur les emplois liés à la gestion et à la distribution des denrées qui favorisent cette aristocratie et renforcent ce rapport de domination. Le préfet de l’annone dans la Rome antique est un personnage puissant qui doit son statut social à la maîtrise de l’approvisionnement du blé dans la capitale.
Contrairement aux sociétés agricoles primitives pour qui la coopération est vectrice de survie, la ville est avant tout un espace de création d’inégalités matérielles liées directement à l’écriture et à l’apparition de bureaucraties complexes. On en retrouve la trace dès les premières citées, notamment à Uruk, en Mésopotamie. D’après les récits rattachés aux rois Gilgamesh et Urukagima, la vie sociale s’organise autour de cinq classes sociales hiérarchisées. La première correspond à la famille royale et à la noblesse ; puis leur succède le clergé ; suivi des militaires ; complété par les métiers non manuels (enseignants, magistrat, courtisane …) ; enfin les classes laborieuses complètent et clôturent la pyramide sociale. Cette dernière catégorie est inférieure à cause de l’effort physique qu’il déploie et de l’enseignement qu’il faut bénéficier pour y échapper.
Autre conséquence manifeste de la formation de communautés d’individus immenses, les liens de solidarité ont tendance à se désagréger en ville à cause de l’anonymat dans lequel chacun tombe. Les communautés se reforment en trouvant du liant au sein des différentes professions. Être artisans dans le même domaine signifie avoir des pratiques communes, des intérêts communs et, indirectement, permet de former des valeurs collectives. On se reconnaît et, contrairement à notre conception moderne de la concurrence économique, on coopère. Se renforcer passe par l’identification et la mise en commun des ressources. Des communautés de travail se forment à travers des groupes de compagnonnage. En ville, des quartiers ou des rues se spécialisent dans une profession, les communautés de pratiques se rassemblent et s’entretiennent par l’endogamie. Au final, l’identité sociale devient une identité professionnelle et corporatiste.
De la Révolution industrielle aux bullshit jobs : les besoins artificiels
La Révolution industrielle, permise par la création puis la mise au point de la machine à vapeur de Thomas Savery à James Watt, a entraîné une nette augmentation de la productivité et, par conséquent, a profondément et durablement transformé le rapport au travail. Ce rendement amélioré n’a pourtant pas tout de suite profité aux travailleurs, du moins pas avant la seconde moitié du XIXème siècle : travail des enfants, peu de limites du temps de travail masculin (pas avant 1998 au Royaume Uni), exposition aux polluants de toutes sortes, accidents de travail régulier … La vie à la campagne est, pour la première fois depuis la création des villes, plus simple que dans les grandes cités devenues le berceau des usines. De plus, l’industrialisation croissante est vectrice de destruction créatrice : les artisans qualifiés deviennent des ouvriers au travail aliéné pour le profit d’une petite élite de techniciens et d’ingénieurs.
Le déclassement social se fait ressentir. Les modifications profondes et rapides de la perception du travail poussent Émile Durkheim à analyser la période à l’aune d’une notion qu’il crée pour l’occasion : l’anomie, correspondant aux sentiments d’intense dislocation, d’anxiété voir de colère créés par ces mutations et entraînant des comportements antisociaux pouvant aller jusqu’au suicide. Le luddisme, cette volonté de réduire le progrès technique par la destruction, représente bien ces comportements. Face à ce double constat – pas d’amélioration des conditions de vie et anomie générale – les patrons d’industrie créent l’idée de responsabilité sociale de l’entreprise et prennent des mesures paternalistes. Au delà d’une certaine volonté charitable, ils sont aussi conscients qu’un ouvrier qui vit mieux est un ouvrier qui produit plus et fait gagner de la productivité à l’entreprise.
Les conditions de travail s’améliorent réellement avec l’association de l’organisation scientifique du travail de Frederick Taylor et la volonté industrielle de Henry Ford. Taylor profite de son analyse minutieuse du processus de production pour le décomposer et en optimiser chaque parcelle. Ils transforment la vision du travail en proposant des salaires élevés et un temps de travail réduit à leurs ouvriers. Malheureusement, cela se fait au détriment des compétences individuelles : le travail à la chaîne fait de chaque ouvrier un simple rouage interchangeable du processus. Ils y perdent leur autonomie et leur maîtrise du travail. Le seul objectif de l’entreprise est d’améliorer le rendement.
Les chefs d’entreprise sont pourtant gagnants sur tous les tableaux : ils ont des ouvriers plus productifs qui possèdent le temps et l’argent de consommer les biens qu’ils ont eux-même produit. Le consommateur vient de naître et va être l’objet de toutes les attentions possibles. On lui propose des objets à collectionner ou bien des modes vestimentaires à suivre, calquées sur celles de l’aristocratie. Les biens de consommation sont alors des objets-symboles, vecteurs de la conquête d’un statut social. Il faut posséder pour exister socialement.
Dans un monde où la productivité suit une croissance exponentielle et les technologies se perfectionnent, une diminution voir une disparition du travail salarié serait envisageable sur le long terme. Des penseurs comme Oscar Wilde ou John Maynard Keynes ont pensé une société vidée des contraintes de l’effort. Pourtant, malgré un cheminement positif au début du XXème siècle, cette utopie marque le pas. Après des semaines de 40h dans les usines Ford, le temps de travail moyen aux États Unis se stabilise aux alentours de 36/38h.
Le président Roosvelt est même prêt à valider un texte de loi formalisant la semaine de 30h en 1932, en compensation de la crise. C’est finalement le fils Kellogg qui, reprenant l’entreprise paternelle, met en place la semaine de 5 jours à 6h de travail quotidien. Jusqu’en 1950 l’entreprise fonctionne sur ce modèle jusqu’à ce que les salariés réclament un retour à des semaines plus importantes pour deux raisons : fuir le foyer et travailler plus pour gagner en pouvoir de consommation. Durkheim décrivait cela comme un mal de l’infini, lié à notre inépuisable désir de possession.
A partir des années 1980, un processus de creusement des inégalités est observé. On appelle cela le « grand découplage », entre la croissance de la productivité et du PIB et celle, moins rapide, des salaires. Le constat est claire : entre 1978 et 2016, les salaires réels des PDG ont augmenté en moyenne de 937 % contre seulement 11,7 % pour les salariés. Par conséquent, le rapport entre le travail, l’effort et la récompense matérielle ne semble plus être une réalité, surtout dans un monde où la spéculation rapporte de gros bénéfices. A l’origine de ce « grand découplage », ce sont de grandes sociétés de conseil, McKinsey and Compagny la première, qui ont lancé une guerre des talents.
Elles ont fait de certains postes traditionnellement secondaires comme le marketing, le conseil ou les ressources humaines, des organes indispensables des entreprises tout en faisant croire que ces compétences allaient s’épuiser progressivement, incitant ainsi à une surenchère des salaires. Victorieuses sur le court terme grâce à un contexte économique favorable – l’émergence des marchés de consommations asiatiques – et épisodique, elles sont en partie responsables des mauvaises décisions économiques ayant entraîné la crise de 2007. Pire encore, ces sociétés et emplois n’ont pas subis de réduction significative de la part de profit à l’origine de leur salaire. Le manque de confiance dans les expertises économiques actuellement y trouve une explication.
Ces nouvelles organisations du travail ont des conséquences sociales claires. Les travailleurs sont aujourd’hui touchés par de nombreuses formes de surmenage. En Asie notamment, un des rares espaces où le sujet n’est pas tabou, les salariés réalisent un nombre annuel d’heures de travail nettement supérieur. La Chine connaît d’ailleurs en moyenne 500 000 morts par an liées à cette problématique. Ailleurs, le problème semble s’inscrire davantage dans le sens qui est donné au travail par les salariés.
Seulement 16 % de la population se considère investie dans son travail et autant s’y sent totalement désinvestie. Pourtant, au-delà de l’activité en elle-même, le travail est un lieu nécessaire de recomposition des liens de compagnonnage. Ces échanges permettent une convergence sociale autour de réseaux constitués par le travail puisque, actuellement, nombre d’entre nous passons plus de temps avec nos collègues qu’avec notre famille. De même, les conversations se lancent souvent autour de la question du travail lorsque l’on rencontre de nouvelles personnes. Cela permet de situer le contexte social – de l’ensemble de normes et valeurs attachées à sa fonction – d’un inconnu pour se faire une première idée de lui. Les recherches actuelles sur la capacité cognitive d’entretien des relations d’un individu fixent à 150 le groupe de personnes que chacun est capable d’intégrer à son quotidien.
Pourtant, la plupart des remarques faîtes jusqu’ici sont désormais bousculées par la complexité croissante de notre société arrivée à l’âge de la post-modernité. L’entrée dans une société de service définie par la nécessité plus fréquente de changer de branches (par choix ou destruction créatrice) ou par la mise en place d’organisation dématérialisée de l’activité (comme le télétravail) modifie en profondeur le rapport à autrui et aux besoins. Une de explications de l’émergence des services comme secteur en expansion réside dans notre besoin de canaliser notre culture du travail, d’une façon finalement assez proche des tisserins, ces oiseaux précédemment cités qui construisent et détruisent leur nid en permanence.
Émergent alors ce que David Graeber nomme des bullshit jobs : des emplois inutiles, parfois nuisibles, dont les travailleurs ne peuvent eux-mêmes justifier l’existence. Repris par Cyril Parkinson, cette idée explique l’augmentation affolante du poids des bureaucraties qui extériorisent leurs occupations de tous les instants pour se rendre indispensable. La « loi » qui en découle stipule que le travail appelle le travail et que des postes doivent être créés pour satisfaire à cette culture du travail. L’exemple illustrant le propos concerne une université californienne qui, de 1975 à 2008, est passée de 3800 postes administratifs à 12183. Parallèlement les postes d’enseignants ont stagné et ces derniers ont même ressenti une hausse des tâches de ce type.
Pour terminer, le questionnement se tourne vers l’impact des hautes technologies, formant une quatrième Révolution industrielle. L’émergence de l’IA ou bien de l’automatisation risquent d’entraîner une hausse massive du « chômage technologique ». Il s’avère que nous avons trouvé le moyen d’économiser de la main d’œuvre plus rapidement que de nouvelles façons de l’utiliser. A l’heure actuelle, selon une étude menée par Oxford, 47 % des emplois globaux est menacé. La proportion est plus faible dans le domaine des arts, des relations publiques, de ceux nécessitant de l’empathie, de la créativité ou de la dextérité. Pourtant, les dernières IA progressent dans ces domaines et devraient finir par rattraper leur retard.
Pour les grandes entreprises les gains sont énormes car les seuls frais fixes deviennent les frais d’entretien des installations : plus d’accident de travail, de salaires fixes, de luttes sociales, de mauvaise presse en cas de licenciement … Les gains reviennent une nouvelle fois aux actionnaires qui poussent déjà à la destruction des emplois les moins qualifiés : les inégalités se creusent encore, le travail perd sa position morale de récompense de l’effort.