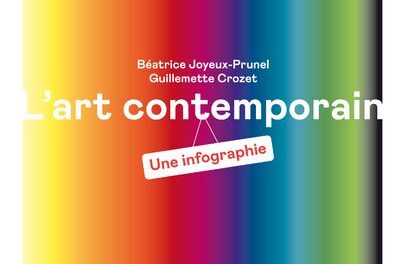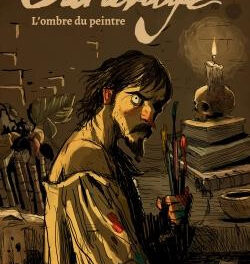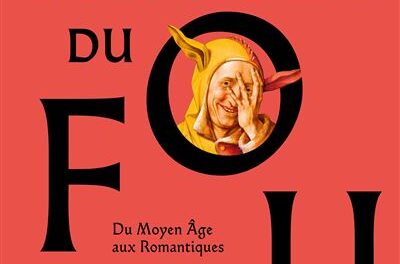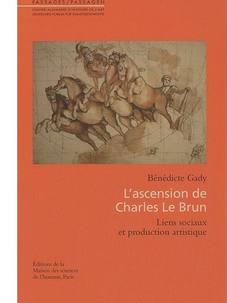
Bénédicte Gady est une historienne de l’art, diplômée de l’IEP de Paris. Elle travaille sur les relations artistiques entre la France et l’Italie au XVIIe siècle à partir du cas de Pierre de Cortone et des graveurs français grâce à un séjour à la villa Médicis à Rome. Elle fut commissaire de l’exposition du département des Arts graphiques au Musée du Louvre sur « Pietro da Cortona et Ciro Ferri » au printemps 2011.
Elle est l’auteur d’une base de données de 1655 à 1724 des graveurs français d’estampes d’après les peintres italiens contemporains, reposant sur un travail d’inventaire du fonds du Département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France. C’est ainsi la mise à disposition d’un beau recensement utile pour l’histoire de l’art.
Elle publie ici sa thèse de doctorat sur Charles Le Brun et ses collaborateurs, soutenue à l’université de Paris IV-Sorbonne.
S’inscrivant dans le nouveau courant d’histoire sociale de l’art, Bénédicte Gady montre les liens sociaux, les réseaux qui ont permis à Charles Lebrun de devenir le premier peintre de Louis XIV. Revenant à l’artiste comme sujet, elle veut comprendre les raisons de l’extraordinaire ascension sociale d’un homme d’une famille modeste autrement que par la seule qualité de ses œuvres et de son génie. Ce qui est tout à fait nouveau dans l’histoire de l’art, et qui tient sans doute à la fréquentation d’historiens, c’est l’analyse qu’elle mène sur les protections dont Lebrun bénéfice avant de devenir lui-même un « patron », à la tête d’un atelier où se forment apprentis et nouveaux talents, s’associant pour les grands chantiers à d’autres spécialistes : sculpteurs, doreurs, dessinateurs d’ornement évoluant au centre d’un vaste réseau de clients.
Le plan de l’ouvrage suit la chronologie de la vie de Lebrun que se forme, s’établit et produit. Elle constate l’imbrication des liens sociaux, professionnels et familiaux notamment à partir d’une source inédite, l’originale biographie de Lebrun écrite par Nivelon (1690-1691) à la bibliothèque Laurentienne de Florence.
Pas un héritier
Né dans une famille illustres des maîtres d’écriture, Lebrun est formé par son grand père qui joua un rôle essentiel dans la formation de l’écriture nationale en établissant un type de calligraphie que la cour adopte, l’écriture à l’italienne, face à l’écriture des gens de justice, l’écriture ronde dite financière. Pour autant, Charles Lebrun maîtrisa difficilement l’art de l’écriture manuelle, peut-être à cause de difficultés d’apprentissage (p 26) qui ne l’empêchèrent pas de maîtriser la mobilité de sa main.
Il évolua dès son enfance dans le monde de la gravure et de la culture. Par son père maitre-sculpteur, il consolide des relations avec les corporations des maîtres peintres et sculpteurs tout en faisant naître des liens familiaux. Charles Le Brun commence à dessiner et à graver à la feuille vers 1630, à l’âge de 15 à 20 ans. Ses pièces souvent des gravures religieuses, dédicace au dauphin, portraits ou séries allégoriques conservées dans la collection Wildenstein, à la BN et à l’Albertina de Vienne longtemps sous estimées, donnent une indication des dédicataires en même temps que des influences stylistiques diverses.
« C’est chère denrée qu’un protecteur » La Fontaine
Sa famille plutôt du coté maternel lui permit de fréquenter le chancelier Séguier qui décida de sa carrière. C’est grâce au marché des peintures que Simon Vouet signe avec Pierre Séguier en novembre 1635 pour le château de Saint Germain en Laye, que Bénédicte Gady estime la date de la rencontre avec Le Brun. Cette rencontre est décisive car Le Brun va recevoir les leçons du plus grand peintre de l’époque Simon Vouet. Il accompagne l’ascension de Séguier à la dignité de chancelier que Le Brun confirma dans le spectaculaire Portrait équestre du chancelier Séguier mais aussi par ses premiers décors d’appartements de l’hôtel Séguier où si Le Brun ne participe pas encore, il retiendra le contenu des discussions sur les choix iconographiques. Cette période est celle de la formation auprès de Simon Vouet et dans les cercles de Richelieu, auprès de Cureau de La Chambre pour sa connaissance des caractères des passions, vertus et vices.
Vers 1637, Le Brun aborde la peinture de chevalet avec des tableaux qui lui servent de recommandation auprès du cardinal Richelieu. En attendant qu’arrivent les premières commandes, Le Brun se consacre aux gravures volantes, aux planches et aux frontispices pour les ouvrages de Georges de Scudéry notamment, élargissant graduellement sa clientèle dans les cercles politiques et culturels autour de Séguier. Progressivement se mettent en place des interactions entre graveurs, aquafortistes, fabricants d’estampes, graveurs comme Rousselet, Mariette, Daret, Couvay, Le Blond, Langlois…Entre hommage et sollicitations de Le Brun au chancelier et au cardinal, Bénédicte Gady s’interroge sur son statut social : se prévaut-il du titre de peintre du roi ? en a t-il obtenu un brevet ? est-il maître de la corporation ? difficile de trancher, car son brevet n’est pas enregistré à cette date (1640-1641).
Le séjour à Rome comme révélateur, à lui-même surtout
Séguier l’incite à se rendre à Rome. Plus, il intervient même en le finançant directement (en l’absence de pension académique), tout en assignant la durée du séjour, ses objectifs : compléter la formation du jeune Le Brun au contact de l’Antique. Ils s’avéreront être proches de ceux que décrétera l’Académie plus tard.
Rejoignant Poussin à Lyon en septembre 1642, il obtient la protection de cardinal Antoine Barberini, neveu du pape Urbain VIII. Il copie bras, main, corps, visages, expression à partir des œuvres de la Farnésine, du palais Farnèse, du palais Mazarin, des loges de Raphaël, de la villa Médicis… Les grandes collections romaines lui servent de modèles de façon à assimiler les principes de la composition, la notion de la proportion antique. Mais Bénédicte Gady montre avec force de détails érudits comment il ne se contraint pas à une exactitude scrupuleuse. Il choisit le détail qui l’intéresse, le copie et infléchit à sa manière d’autres parties. Elle analyse très finement ces infimes différences avec une connaissance parfaite des modèles. Au delà de l’assimilation de l’antique, il interprète. Suivant l’influence de Poussin, il se conforme aux principes de composition du maître mais en surchargeant la couleur et saturant l’espace, en modifiant le rapport à la lumière. Se soumettant aux exercices requis «à la manière de », il travaille déjà son style en s’autorisant de légères modulations.
Tout en assurant son protecteur de ses liens de déférence, il quitte Rome sans son autorisation, à la fin de l’année 1645, il rentre à Paris en séjournant à Lyon et Dijon.
Toujours Créature de Séguier
Bénédicte Gady met nettement en évidence la protection continue de Séguier qui dépasse le cadre du séjour romain. Il apparaît nettement que Séguier reste son protecteur pendant les quinze années de son ascension (1646-1661). Le rôle prépondérant de Séguier en politique met Le Brun au contact de la haute noblesse et multiplie de ce fait les commanditaires que Bénédicte Gady identifie clairement et notamment Nicolas Fouquet dès 1657, sans que cela pose de problème de concurrence de clientèle. C’est l’époque des premiers chantiers d’envergure, celui de l’hôtel Séguier au premier titre avec des propositions originales de deux jardins avec perspective et la chambre d’alcôve. C’est l’époque de libéralité de Séguier envers les couvents et les congrégations religieuses auxquels Le Brun fournit des petits tableaux, des projets de maître d’autel. Sa production s’adapte à ses commanditaires, il module son style d’exécution aux types de commande mais étonne par la hardiesse de son style dans les nombreux domaines où il intervient. Ainsi, peut-on lire le portrait équestre spectaculaire de son protecteur, le premier magistrat du royaume immortalisé en homme d’Etat au moment où la monarchie multiplie les grandes entrées incarnant tout comme elle, les valeurs de justice et de continuité monarchique.
Peintre introduit à la cour
Le Brun sait saisir les occasions que lui offrent son mérite et sa réputation naissante. Dès 1653, il entre au Louvre au gré des réaménagements conduits par l’architecte Lemercier, en fournissant un décor pour la constitution d’un appartement fixe du Conseil du roi, que propose Séguier. Puis il élabore un projet de plafond pour la grande salle du Conseil (p 196) dans un chantier qui prend fin en 1654. Déjà, il travaille pour l’hôtel du frère du surintendant des bâtiments du roi. Et à l’été 1654, après le sacre, sont entrepris des travaux pour l’appartement du roi avec l’architecte Le Vau, l’ornemaniste Cotelle. Au plafond, Le Brun peint déjà un étonnant Louis XIV dirigeant le char de l’Etat couronné d’étoiles par Minerve (1656) soit une vingtaine d’années avant celui de Versailles (p 200). Confirmé dans son talent, persuadé de sa capacité à produire un art pour le roi, avec un nouvel ordre hiérarchique mêlant directement les allégories et le portrait du roi, il peut se permettre de se heurter au peintre Charles Errard soutenu par Antoine Rabaton, le surintendant des bâtiments du roi et de se froisser avec les Messieurs de l’Académie de peinture.
Le tableau Les reines des Perses aux pieds d’Alexandre est une nouvelle transition dans la carrière de Le Brun. Suscitant des lectures multiples, comme celle des amours contrariés de Louis XIV avec Marie Mancini, ou encore une lecture politique de la demande de parler à Alexandre après l’avoir confondu avec son favori, ce tableau est peint au moment de l’arrestation de Fouquet. Mais Le Brun après avoir travaillé pour Fouquet, a déjà fait allégeance à Colbert tandis qu’il se conforme avec l’identification iconographique du roi à Alexandre. Parfait courtisan, connaissant les réseaux et les convenances, il évolue sans difficultés dans la société de cour, bientôt au service du pouvoir.
La partie suivante donne des descriptions passionnantes sur les activités professionnelles de Le Brun, sur l’opposition des corporations à la création de l’Académie de peinture, en montrant nettement le rôle de Le Brun en faveur de la protection des artistes, académie qu’il a contribué à créer mais à laquelle il a su rapidement s’opposer également. Il œuvra à changer le statut du peintre, du graveur en les faisant passer de l’artisanat au monde intellectuel, au contact des gens de lettres. Il œuvra parallèlement à changer le statut de la peinture et du dessin en montrant sa capacité à témoigner d’un évènement, d’une vertu, d’un acte symbolique et évidemment à la fonction éminente de glorification royale.
Le désir de gloire
Rapidement Le Brun reçoit les honneurs du roi, un logement au Louvre, le privilège d’imprimer et de diffuser son œuvre et un brevet de peintre ordinaire du roi, ce que seul avait obtenu Rubens en 1619. Ainsi il peut contrôler les copies de ses œuvres, éviter les contre-façons, diffuser pour accroître sa gloire et sa renommée. Les stratégies financières et mercantiles, déjà évoquées dans sa jeunesse à Rome resurgissent (prête-nom, achats et ventes d’œuvres d’art, constitution de rentes sur des chantiers…). Au début de la décennie 1660, ses ambitions, son désir d’ascension professionnelle, sociale, mondaine et intellectuelle sont comblés, d’autant que Charles Le Brun est désormais le chef d’une famille élargie dont il prend l’avenir en main. Son ascension en fait un exemple pour ses pairs. « Tout bourgeois veut bâtir comme un grand seigneur »
La dernière partie du livre traite des modalités de la production. L’étude s’oriente vers l’atelier, moins sur les bases d’une étude de style que sur les formes sociales et historiques de la production concrètes des œuvres, forme d’analyse qui fait l’originalité de ce livre. Très jeune en 1640, à 21 ans, Le Brun avait embauché son premier apprenti. Il passa dans sa carrière sans doute plus que 167 contrats avec des apprentis dont une quinzaine seulement laissèrent un nom d’artistes. Bénédicte Gady étudie la subordination artistique autant que la subordination juridique qui rend complexe et évolutive la notion d’atelier, défini par des brevets d’apprentissage aux statuts juridiques variés, soit sous les formes requises par la corporation, soit financés par le trésorier des bâtiments du roi, soit par la sous-traitance des marchés affermés.
Elle analyse avec clarté, ce qui fait d’elle un précurseur dans ce domaine, les rapports entre la fourniture de dessins, la réalisation des ouvrages de plus en plus complexes (décor, lambris, voussure, figures, tableaux, dorure, tapisserie, mobilier…) donc les degrés de la maîtrise d’œuvre dans les chantiers. L’analyse de ces structures de production artistique rend encore plus complexe la notion d’œuvre d’art, entre la collaboration, le conseil, l’intervention, les retouches, l’achèvement des figures ou du paysage, autant de travaux réalisés en commun selon les liens de l’atelier, de l’amitié, les capacités, l’intérêt pour un type de décor et l’urgence des travaux. Une « multiplexité » de liens qui contribuent à faire naître une œuvre d’art sans pour autant que ces hommes travaillent en atelier. Cette « multiplexité » est matérialisée par un schéma (p 358-359) est une tentative fascinante de reconstitution où sont décrites les tâches des collaborateurs en fonction des chantiers en cours vers 1660. L’atelier n’est donc pas ce lieu topographique mais plutôt une réalité socioprofessionnelle mouvante.
Les professeurs pourront s’aider du chapitre (VIII) sur le chantier de Vaux (le Vicomte) en s’appuyant sur la chronologie proposée, pour donner un récit plus exact de l’importance artistique et politique de Nicolas Fouquet en même temps qu’un exemple de fonctionnement des équipes, de répartition des tâches, d’ordonnancement et de financement d’un grand chantier « global » au XVIIe siècle. Ce chapitre offre des nuances à saisir pour conjurer la position historiographique qui a longtemps prévalu : Le Brun ne fut pas l’ordonnateur de Vaux, qui ne fut pas la répétition de Versailles ! Il a fourni des modèles et des collaborateurs, il a conseillé, orienté, amélioré certains aspects visuels.
Ainsi le livre se clôt sur le chantier de Vaux, au milieu de la carrière de Charles Le Brun, couronnant ses ambitions mais au début des honneurs royaux qui allaient s’amplifier avec la place prépondérante qui tiendront les arts dans la politique royale. Cette carrière n’est pas l’application d’un plan préétabli, elle n’est pas linéaire car l’ouvrage le montre progressant au gré des commanditaires, toujours dans un fort désir d’ascension sociale mais aussi d’ennoblissement de son art.
Ce livre propose une nouvelle lecture de l’homme Le Brun en parallèle de son œuvre. Il rétablit la chronologie, émet des hypothèses, identifie des œuvres, documente des collections. Sa lecture en est très aisée. Une belle disposition de photos et dessins en noir et blanc, se répondant sur les pages de droite et de gauche, font dialoguer les œuvres en rendant visible leur correspondance.
L’analyse d’un parcours personnel, la mise en perspective grâce à la prosopographie montre que l’interdisciplinarité entre histoire et histoire de l’art ne peut être qu’une nouvelle voie féconde qu’ouvre Bénédicte Gady, tout en donnant dans les derniers termes de sa conclusion, matière à la suite de la carrière de Charles Le Brun à Versailles.
Pascale Mormiche ©