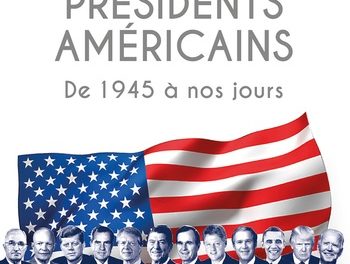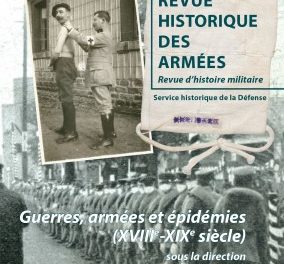C’est une plongée rétrospective dans une époque pas si lointaine mais où une partie des clionautes et abonnés de la liste n’étaient pas encore sur cette planète que propose Jean-Charles Scagnetti, qu’on ne peut accuser en raison de sa jeunesse de se complaire dans une époque révolue, celle des yés-yés et des juke-box dont le Scopitone est une version proposant musique et image.

Loin d’une vision nostalgique, il s’agit d’un très solide ouvrage d’histoire qui se situe au carrefour de l’histoire culturelle et de ce que l’évolution technique peut fournir comme support à l’expression culturelle prise au sens large du terme.
Jean-Charles Scagnetti présente toute l’aventure de ce juke-box à images, depuis les premières expérimentations et les différentes prises de brevets, car plusieurs systèmes concurrents se succédèrent et coexistèrent, parfois de façon conflictuelle, jusqu’au ré-emploi tardif de cet appareil dans les pays du Maghreb et au Moyen Orient .L’idée de coupler son et image conduisit en effet au développement de systèmes sophistiqués qui utilisaient en général des films 16mm d’une durée de trois minutes environ. Les recours au 35mm, format trop encombrant et au 8mm plus fragile ont également été tentés et petit à petit, cette technologie complexe puisqu’il s’agissait de faire démarrer en parfaite synchronisation son/image a entraîné réalisateurs et orchestrateurs, tout comme les artistes, à utiliser des séquences d’un format qui préfigurait celui des vidéoclips. Les codes de présentation telles que la fréquente présence de danseuses autour de l’artiste, une certaine originalité des décors, de l’inventivité dans les cadrages et les montages font déjà partie des codes des vidéoclips.
Un mode d’expression qui s’affirme progressivement
Excellente publicité pour des artistes à une époque à laquelle la télévision faisait encore de la résistance et ne montrait que peu les artistes préférés des jeunes, le tournage de séquences pour le « vrai » Scopitone ou pour tous les systèmes concurrents devint peu à peu un passage obligé pour les chanteurs à la mode.
A côté de séquences plus classiques présentant simplement l’artiste en représentation, le tournage de ces séquences a également permis à de futurs cinéastes (Gérard Sire, André Brunet, Claude Lelouch pour ne citer qu’eux) ou à des réalisateurs de télévision tel Alexandre Tarta de se familiariser avec des histoires courtes à concevoir pour le temps d’une chanson. Le langage cinématographique nécessité par le tournage de ces petits films devait montrer la vedette en gros plan, proposer pour les trois minutes et demi disponibles au maximum un montage rapide et suggestif. Enfin, les contraintes financières ont fait rapidement préférer le tournage en extérieur, moins coûteux même si les grandes vedettes de l’époque ont parfois tourné en studios. Filmés en 35 mm, les séquences étaient, après montage, copiées en 16 mm pour être diffusées auprès des établissements qui disposaient d’un appareil.
Au fil des pages, Jean-Charles Scagnetti évoque les évolutions successives, le public adolescent ayant les vedettes à la mode, les bars plutôt fréquentés par une clientèle masculine proposant des films sonores qui utilisaient l’élément féminin, si possible peu vêtu « en dépit de la censure et de la moralité ambiante, les films français exploitèrent cet aspect plastique, alléchant, voyeur et novateur ». Même si cette tendance s’est affirmée au milieu des années 1960, il n’en reste pas moins que l’essentiel des succès du Scopitone reposait sur les vedettes de la chanson dont l’auteur dresse un tableau à partir d’un classement de 1966. Les plus demandés étaient alors Henri Salvador, Antoine, Enrico Macias, Frank Alamo mais certains artistes restaient très sur-représentés dans les catalogues du Scopitone.
De l’autre côté de l’Atlantique, l’aventure de cet appareil et de ses clones reposait techniquement sur les mêmes principes, mais Jean-Charles Scagnetti pointe les différences culturelles qui conduisent « à l’instar du Vieux Continent, le but poursuivi était de toucher, d’émouvoir ou d’émoustiller les spectateurs grâce à l’animation, aux girls et aux couleurs. L’instant Scopitone devait incarner un moment de pur loisir récréatif » ; les résultats produits « donnèrent des films plus iréels et teintés de magie » grâce à une technique plus lourde et plus coûteuse que des sociétés comme celle fondée par l’actrice et chanteuse Debbie Reynolds, ont utilisée en n’hésitant pas à recourir à des décors de studios, proches de ceux auxquels la réalisation de films faisaient appel. La rentabilisation des investissements conduisit, note l’auteur, à moins d’originalité qu’en Europe, des valeurs sûres du music-hall figurant plutôt au catalogue.
Face aux autres médias, une place qui diminue progressivement
A la fois techniquement et culturellement , avec le lancement de radios, des festivals tels Woodstock, une démocratisation encore beaucoup plus large de la télévision, la carrière du Scopitone s’achevait à la fin des années 60 « la rupture était consommée entre la production de films et le public susceptible de payer pour les visionner ».
Néanmoins, le Scopitone connut encore un prolongement de carrière grâce au catalogues maghrébins et moyen-orientaux, autant parce que « pour les immigrés des cafés, ils offraient un espace récréatif tant visuel que sonore ». Le catalogue s’enrichit donc rapidement de titres interprétés par des artistes de la rive sud de la Méditerranée alors que les nouveautés européennes étaient en déclin. Le Scopitone, d’accessoire attractif dans les cafés accueillant les jeunes aisés des quartiers bourgeois, migra vers les cafés fréquentés par les immigrés. Mais ce ne fut pas la seule conséquence car l’existence même de ce catalogue fit espérer une diffusion de l’appareil et du catalogue en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ce qui resta finalement assez limité, la crainte de l’occidentalisation excessive de la jeunesse constituant un frein important.
Il n‘en reste pas moins que cette invention originale a tenu une place non négligeable dans l’histoire musicale, l’histoire des représentations visuelles et pour l’auteur qui plaide avant de conclure pour « la collecte, la conservation et la valorisation ». Il souligne ensuite que l’histoire de cet appareil et de ce qu’il projetait « permet de comprendre des pratiques sociales » pendant la période de mutations profondes qui va de la fin des années 50 au milieu des années 80 et même au-delà si on prend en compte la création de codes visuels et musicaux qui perdurent de nos jours.
Ce livre qui traite d’un sujet inhabituel est donc particulièrement intéressant, autant par les exemples fournis, la qualité de sa documentation que par le contenu même de cette histoire presque oubliée.