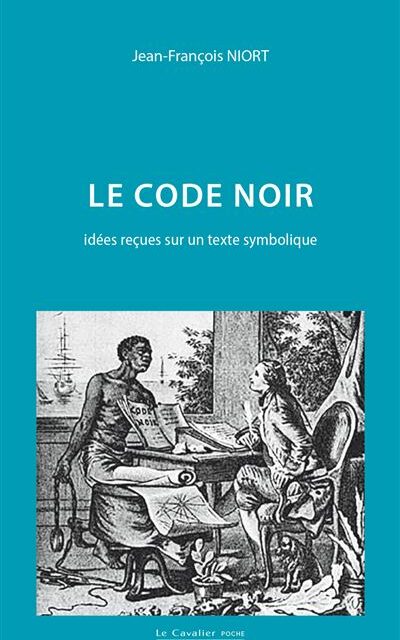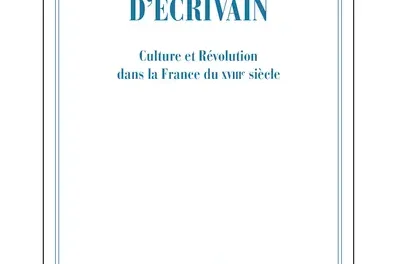Cette deuxième édition signale l’importance de ce texte patrimonial qui revit dans l’espace public, promu par les renaissances mémorielles. C’est aussi et surtout une salutaire mise au point d’un expert.
“L’hybridité, dans tous les sens du terme, est au centre du Code Noir”, c’est par ces mots que débute l’avant-propos signé Myriam Cottias. En effet, et pour se départir des manipulations dont il est régulièrement l’objet depuis le rebond mémoriel des années 2000, le Code noir, resté trop longtemps en vigueur de 1685 à 1848, mérite l’exégèse de l’historien du droit. C’est chose faite avec l’acuité de la lecture de Jean-François Niort, maître de conférence HDR à l’Université des Antilles, qui scrute méticuleusement cet objet depuis près de vingt ans.
Huit contrevérités touchant à la présentation du Code noir scandent la relecture du spécialiste. Celles-ci introduisent de courts chapitres où l’historien rappelle le contexte, les évolutions du texte et des notions juridiques sans lesquelles il est déraisonnable de commenter ce texte, “symbole même de l’esclavage colonial français, ainsi que de la monstruosité du système esclavagiste en général” (p69). Ces contrevérités émanent d’historiens oubliés comme Lucien Peytraud, de personnalités contemporaines, telles Christiane Taubira, Louis Sala-Molins, Régine Detambel et de rapports officiels.
Vecteur de souveraineté de l’Etat royal
Comme le souligne l’historien Marcel Dorigny (1948-2021) dans la préface, “l’existence du Code noir est l’incarnation de la souveraineté de l’Etat dans la société esclavagiste : désormais la loi, c’est-à-dire le roi, s’interpose entre l’esclave et le maître, limitant le pouvoir arbitraire de ce dernier en lui imposant des règles en matière de travail et de nourriture des esclaves, des obligations en matière religieuse et surtout en contrôlant le pouvoir de répression que s’étaient attribués les propriétaires” (p14). En somme, avec cet Edit de mars 1685, “l’Etat monarchique entérine la création du droit colonial français” (p43), acte fondateur d’un droit dérogatoire.
Un corpus de police religieuse coloniale
Et, Ancien régime oblige, cette souveraineté est forcément indissociable de sa dimension religieuse et brandit en conséquence l’adage “un roi, une foi, une loi” (p39), l’année même où est signé l’Edit de Fontainebleau interdisant le protestantisme. C’est pour cette raison que le Code noir est avant tout un texte de police religieuse coloniale. Il interdit tout autre mariage que celui catholique (art.8). Il autorise dans son article 13 le mariage mixte, jusqu’à la version de 1723. Ces dispositions juridiques ne doivent toutefois pas occulter, l’auteur le rappelle souvent, leur ineffectivité dûe aux juridictions locales entre autres.
Une négation des libertés
Vient ensuite le point nodal des polémiques et lectures décontextualisées du Code noir : l’article 44, celui où l’on lit “Déclarons les esclaves êtres meubles” (p87). L’auteur rappelle que “le rapport théorique entre humanité et personnalité juridique en vigueur à l’époque du Code noir n’est pas celui du droit contemporain” (p43). L’esclave serait-il (-elle) une chose ? On retrouve dans le Code noir des articles faisant état de l’humanité des esclaves : gérer un négoce au nom du maître, vendre des produits au marché, écoper de sanctions judiciaires, accéder au mariage légitime, être affranchi(-e), autant d’éléments mis en exergue dans les travaux de l’anthropologue Claude Meillassoux (Anthropologie et esclavage, 1986). Il n’y a donc de réification de l’esclave que partielle, processus qui permet de faire primer la valeur économique de l’homme, corrélée à la privation de trop nombreuses libertés, dans un système de production esclavagiste. Ainsi, l’esclavage et le Code noir déshumanisent l’être humain mais ne lui ôtent pas toute humanité. C’est toutefois cette “soustraction”, mise à l’index dans la pensée des Lumières et singulièrement dans celle de J-J Rousseau, qui fonde notre perception contemporaine du Code noir.
Le droit de tuer ?
Le Code noir est souvent présenté comme la privatisation par les maîtres du droit de vie ou de mort sur leurs esclaves. Si l’on se fie aux articles de l’Edit de mars 1685 – autre nom du Code noir – , nous lisons plutôt dans l’article 42 que les maîtres peuvent enchaîner leurs esclaves mais qu’il est interdit “de leur donner la torture” (p86). Dans le suivant, il est stipulé que les maîtres ou commandeurs qui auront tué un esclave doivent être poursuivis criminellement, interdisant de jure le droit des maîtres de donner la mort à leurs esclaves.
Enfin, la postface de Jacques Gillot, ancien président du Conseil général de la Guadeloupe (2001-15), habilement intitulée “Revisiter nos certitudes” pointe une nouvelle fois combien il est important de tenir compte de la parole historienne dans le débat public, non pas pour donner les bons et les mauvais points, mais tout simplement afin de commenter, de contextualiser des faits et d’éclairer les polémiques. Au final, ce livre peut tout à fait être sollicité pour les classes de seconde en histoire, afin de mettre en perspective par exemple le poids des mémoires et le travail des historiens.
La présentation de l’éditeur :