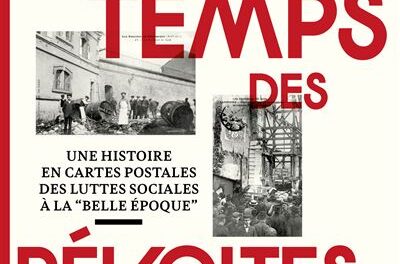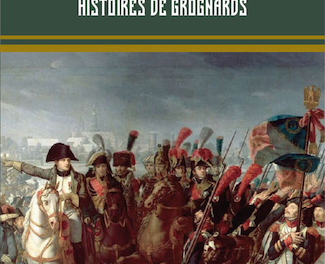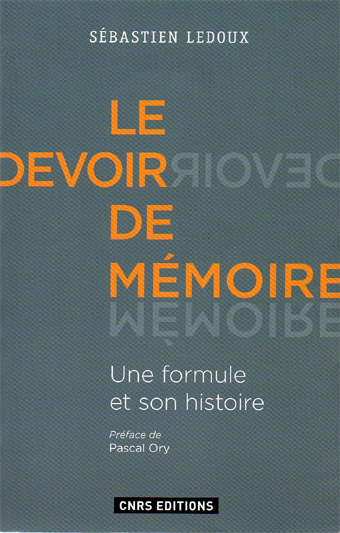
Cet ouvrageune recension de ce même titre par Laurent Bensaïd, plus bas est la version éditoriale d’une thèse de doctorat dirigée par Denis Peschanski, soutenue en Sorbonne à l’automne 2014, sous le titre Le temps du « devoir de mémoire », des années 1970 à nos jours. Sébastien Ledoux est actuellement chercheur en histoire contemporaine au Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris 1/CNRS) et enseignant à Sciences Po Paris.Dans sa préface, Pascal Ory définit cette entreprise comme « un exercice d’histoire conceptuelle, autrement dit un exemple achevé de cette analyse d’un imaginaire social qui reste l’enjeu ultime de toute l’histoire culturelle« . Il s’agit bien d’une thèse d’histoire contemporaine, mais l’objet d’étude est un concept et les sources sont constituées par un immense corpus de livres, d’articles de revues, et de documents audiovisuels issus des archives de l’INA. Les méthodes sont celles de l’historien, mais celui-ci a également recours à celles de la linguistique (analyse du discours par l’utilisation de logiciels de logométrie), ainsi qu’à ses concepts. Dans la mesure où les notes de fin d’ouvrage sont essentiellement des références et qu’elles n’explicitent pas ces concepts linguistiques, certains passages sont d’un accès que le rédacteur de ce compte-rendu a trouvé difficile.Sébastien Ledoux définit ainsi son projet : « Retracer non seulement l’invention lexicale mais également l’invention sociale et l’invention politique liées à l’émergence puis à l’omniprésence du terme devoir de mémoire au sein de la société française, un fait qui nous paraît suffisamment prégnant pour caractériser la période concernée comme » le temps du devoir de mémoire« . Un temps qui commence dans les années 1970 et dans lequel nous trouvons sont encore aujourd’hui. »L’ouvrage comprend 12 chapitres regroupés en quatre parties : Archéologie du « devoir de mémoire », Naissance d’une formule (1992-1993), La grammaire du « devoir de mémoire » (1995-2005), Entre défiance et dissémination. Le « devoir de mémoire » des années 2000 à nos jours. Le texte est complété par une soixantaine de pages de notes, une trentaine de pages de bibliographie, et un index des noms.
Mise au point sur une fausse étymologie
Plusieurs historiens, dont Henri Rousso et Olivier Wieviorka ont validé l’hypothèse selon laquelle l’origine de la formule du « devoir de mémoire » serait la parution en janvier 1995 d’un petit livre intitulé Le devoir de mémoire et dont Primo Levi serait l’auteur. La formule aurait donc pour origine l’obligation des rescapés de témoigner de l’expérience des camps de la mort et serait apparue dans les années 1980-1990. Ce petit livre est en fait la publication d’un entretien avec Primo Levi enregistré sur magnétophone en 1983, par deux historiens, et le terme de « devoir de mémoire » est absent de l’entretien. Il constitue le titre de l’ouvrage et a été choisi par les éditeurs. L’expression stricto sensu n’a pas été utilisée par Primo Lévi.
L’auteur démontre ensuite que la formule n’appartient pas au vocabulaire employé par les associations d’anciens déportés du lendemain de la guerre jusqu’aux années 1980. Les premières occurrences qu’il retrouve de cette expression remontent à 1972 et sont le fait d’un écrivain et professeur de littérature d’une part, d’un psychanalyste d’autre part ; les deux occurrences non pas de référent commun et l’expression ne se rattache à aucun événement historique. L’expression est ensuite utilisée en 1980 par le philosophe Philippe Némo et en 1983 par l’historien Pierre Nora. Il relie ce phénomène à un » désir d’enracinement mental dans le passé, liée à une expérience du déracinement que connaît la France industrielle contemporaine coupée de ses sources en cherchant retrouver ses propres racines« . Cet usage du « devoir de mémoire » par Pierre Nora au début des années 1980 s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large qui voit depuis plusieurs années apparaître de nouveaux usages du mot mémoire, qui servent à formuler un nouveau rapport au passé. Le terme s’est enrichi dans les années 1970 d’un nouveau sens dans lequel se conjuguent les notions d’identité et de patrimoine. De nombreux livres, la création de musées des arts et traditions populaires et de nouvelles émissions de télévision reflètent alors l’attrait du public pour l’histoire de la vie quotidienne a travers les récits de vie de simples gens.La mémoire devient un objet d’étude a la fin des années 1970, dans la génération des chercheurs la Nouvelle histoire. La publication en 1978 de l’article » Mémoire collective » par Pierre Nora, marque officiellement cette entrée. Le renouvellement historiographique a la fin des années 1970, posant la mémoire comme objet d’étude, concerne également la naissance de nouveaux courants historiographiques qui se structurent autour de l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS). La mémoire collective est un des objets de recherche de cet institut qui lance une grande enquête sur « Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale dans la conscience collective des Français« .
Le génocide des Juifs : une référence de plus en plus prépondérante du devoir de mémoire
Les occurrences de « devoir de mémoire » relatives au génocide des Juifs apparaissent à partir du milieu des années 1980. A la charnière des décennies 1980-1990, ce fait historique devient la référence principale du « devoir de mémoire ». Dans cette référence on distingue plusieurs sens :
– Référence à un impératif moral, dimension incarnée par le philosophe Jankélévitch.
– Référence à la lutte contre l’impunité des criminels nazis et leurs complices. « Devoir de mémoire » est employé dans l’article « Shoah » qui fait son entrée pour la première fois dans l’Encyclopaedia Universalis en 1989, apparition directement liée au titre du film de Claude Lanzmann sorti en avril 1985, terme qui s’impose par la suite rapidement en France pour désigner le génocide des Juifs.
– Référence à la construction d’une identité juive post-génocidaire.
– Référence au combat politique contre le négationnisme porté par l’extrême droite en France
« Ces nouveaux usages de l’expression s’inscrivent dans une évolution du vocabulaire de la mémoire qui intègre alors de nouveaux sens et de nouveaux référents historiques. (…) L’affirmation d’une identité spécifiquement juive, corrélée à l’évocation du génocide, se trouve médiatisée à l’occasion d’une série de controverses autour du négationnisme et d’actes antisémites. » Le combat contre le négationnisme passe chez plusieurs auteurs par la revendication de la mémoire : tenant lieu de vérité, elle représente la réponse à la négation du génocide. Des études quantitatives permettent de montrer la généralisation du vocabulaire de la mémoire dans un laps de temps relativement court, durant les années 1980. Au milieu de cette décennie la formule est introduite dans le vocabulaire politique ; elle est employée dans des discours, principalement à l’occasion des commémorations officielles concernant les deux guerres mondiales.
L’institutionnalisation officielle du mot « mémoire » au sein de l’Etat français
L’expression fait son entrée en 1984-1985 dans le vocabulaire des politiques officielles du passé, essentiellement par l’intermédiaire d’un homme, Jean Laurain, ministre des Anciens combattants, professeur de philosophie nourri de la pensée de Kant et de Bergson, qui voit dans le rappel des deux guerres mondiales « une propédeutique pour la construction de la paix en France et en Europe« . Le terme « mémoire » remplace le terme « souvenir » jusqu’au cœur des structures administratives du ministère des Anciens combattants. Avec la création de la Commission nationale de l’information historique pour la paix, l’Etat se dote de d’un instrument des politiques publiques du passé. Son secrétaire général, Serge Barcellini, est l’artisan de cette mutation sémantique. C’est lui qui développe l’utilisation institutionnelle des expressions « lieu de mémoire » et « politique de la mémoire ». Au sein du ministère des Anciens combattants est ensuite créée une Délégation à la mémoire des conflits contemporains qui devient la Délégation à la mémoire et à l’information historique.
L’année 1992 marque l’entrée du « devoir de mémoire » sur la scène publique
» Lorsque l’on suit l’évolution quantitative et qualitative du terme, la trajectoire du devoir de mémoire connaît un tournant en 1992-1993. Le terme apparaît alors pour la première fois simultanément dans les quotidiens nationaux de la presse écrite, à la télévision, à la radio ainsi qu’en titre d’une association. Son introduction dans l’actualité peut également être mesurée par l’augmentation du nombre des occurrences signalées dans les dépêches de l’AFP« .
Les analyses de l’auteur montrent très clairement que la généralisation de la formule s’effectue dans le cadre de la prise de conscience et de la dénonciation croissante de la responsabilité de l’Etat français dans le génocide des Juifs. L’émission de Jean-Marie Cavada, La marche du siècle, suivie en moyenne par quatre à cinq millions de téléspectateurs, a été à plusieurs reprises un vecteur fondamental de cette généralisation. Le 10 juin 1992, l’émission est consacré à la rafle du Vel d’Hiv. Les magazines de télévision relaient l’émission présentée elle-même comme un événement. Le discours scientifique vient parallèlement légitimer cette lecture avec notamment, la parution en 1987 du Syndrome de Vichy d’ Henri Rousso.
» Devoir de mémoire est alors inscrit dans une rhétorique de la dénonciation d’une injustice, l’occultation de la vérité sur la complicité de Vichy dans la déportation des juifs, son dévoilement au nom des « droits de l’homme du citoyen » contribuant à l’ « instruction civique » auprès des jeunes générations, à l’exercice de la justice et la lutte contre le Front national« .
L’expression se retrouve dans l’exposé des motifs de la proposition de loi de Jean Le Garrec, le 23 novembre 1992, « tendant à reconnaître le 16 juillet journée nationale de commémoration des persécutions et des crimes racistes, antisémites et xénophobes perpétrés par le régime de Vichy« . L’expression fait son entrée dans un texte législatif présenté comme une réponse politique au problème posé non seulement par le négationnisme mais aussi par le silence que l’Etat mitterrandien entend maintenir sur la responsabilité de la France dans le génocide des juifs.
Michel Noir, maire de Lyon, créée en 1992 dans sa ville le Centre d’histoire de la résistance de la déportation. Ayant assisté au procès de Klaus Barbie à titre personnel, il souhaite utiliser des images du procès pour cette institution et à son initiative, une loi est votée en 1990, qui autorise une dérogation exceptionnelle dans un cadre pédagogique. Michel Noir demande à un journaliste de faire un montage de 45 minutes à partir des 350 heures d’enregistrement. Le jour de l’inauguration du CHRD, le film est projeté sur les lieux dans une version courte. C’est donc ainsi que le journal télévisé de France 2 fait son ouverture sur les images inédites de Barbie au moment de sa condamnation. La médiatisation du « devoir de mémoire » pour la première fois à la télévision est directement le fait de Michel Noir. Dans sa communication auprès des médias, il emploie systématiquement l’expression, qu’il estime novatrice et porteuse d’une valeur éthique au fondement de la civilisation. Politiquement il est un adversaires irréductible du Front national, déclarant qu’il préfère perdre une élection que « perdre son âme » en pactisant avec lui.
L’expression atteint son apogée durant l’année 1993
Sébastien Ledoux observe que du point de vue quantitatif la formule renforce sa présence dans le discours public, et que du point de vue qualitatif son utilisation par l’institution scolaire et par les médias vont l’officialiser.
A la session du baccalauréat de juin 1993, le ministère de l’Education nationale propose aux élèves de terminale des séries littéraires de plusieurs académies le sujet de philosophie suivant » Pourquoi y a-t-il un devoir de mémoire ? » Ce sujet croise plusieurs thèmes du programme officiel de philosophie de la série littéraire : la mémoire, l’histoire, la vérité, le temps, la mort. Trois semaines après le sujet du baccalauréat, « Devoir de mémoire » est choisi en titre de l’émission télévisée La marche du siècle, le 30 juin 1993. Jean-Marie Cavada reçoit le philosophe Paul Ricoeur, le juge Pierre Truche et l’historien Pierre Nora. Il demande à chacun de répondre a la question posée par le sujet du baccalauréat. » Dans le cadre d’une émission télévisée populaire, l’expression fait alors l’objet d’un consensus par les discours d’autorités réunis : le journaliste avec Jean-Marie Cavada, l’historien par la voix de Pierre Nora, le philosophe par celle de Paul Ricoeur, et le juge avec Pierre Truche, légitiment l’existence d’une telle formule en lui donnant un sens propre à chacun« .
Une émission spéciale de La marche du siècle est diffusée le 8 septembre 1993. Intitulée » Justice, Histoire, Mémoire », elle est consacrée au film du procès Barbie, qui a bénéficié d’une autorisation exceptionnelle pour être diffusé à la télévision dans le cadre de cette émission. Le caractère pédagogique de la diffusion du film est mis en scène dans l’émission avec la présence sur le plateau de jeunes Français et européens de 18 à 25 ans interrogeant les différents témoins présents au procès Barbie. La soirée est annoncée comme un événement dans de très nombreux médias et l’émission réalise une audience considérable avec près de six millions de téléspectateurs. « Devoir de mémoire » est désormais référé à l’acte de témoigner de l’expérience génocidaire.
Dans les années 1992-1993, la formule « devoir de mémoire « a donc pris un quadruple sens : la reconnaissance officielle d’un fait historique (la complicité du régime de Vichy dans le génocide des Juifs) par la voie commémorative, la transmission de ce fait historique aux jeunes générations, la réparation due aux victimes et à leurs descendants, la nécessité de témoigner de ce fait dans l’espace public. A partir du milieu des années 1990, les usages de la formule « devoir de mémoire » s’inscrivent dans différentes formes d’institutionnalisation de la mémoire de la Shoah.
Les usages multiples de la formule
« Devoir de mémoire » devient le nom de pratiques commémoratives. Le terme continue à être employé pour dénommer des pratiques commémoratives relatives à la Shoah, inscrit désormais dans l’agenda officiel de l’Etat français.
« Devoir de mémoire » devient le nom d’une éducation citoyenne. La transmission du génocide des Juifs aux élèves de l’école de la République est perçu comme une priorité par différents acteurs de l’Education nationale.
« Devoir de mémoire » devient le cadre référentiel de l’acte de témoigner de l’expérience de l’holocauste. Au cours des trois procès pour crime contre l’humanité qui ont eu lieu en France (Barbie, Touvier, Papon), le témoin n’est pas forcément un témoin historique au sens de témoin oculaire. Sa caractéristique est qu’il apparaît à la fois comme un témoin juridique qui dépose, en tant que partie civile une parole, à charge devant le tribunal, pour obtenir réparation des préjudices publics pour lui de sa famille, et comme un témoin social porteur d’une expérience historique à partager et à transmettre à l’ensemble de la population. En dehors des témoins des procès pour crimes contre l’humanité la formule « devoir de mémoire » est également mobilisée pour évoquer la littérature testimoniale consacrée à l’expérience génocidaire.
« Devoir de mémoire » devient le nom d’une politique de réparation, qu’il s’agisse de la réparation judiciaire, de la réparation financière ou des déclaration de repentance.
« Devoir de mémoire » devient le nom de la conversion de l’Etat français un nouveau régime mémoriel. Jacques Chirac, par son discours du 20 juin 1986 quand il inaugure la » place des martyrs du Vélodrome d’hiver-Grande rafle des 16 et 17 juillet 1942″, et par celui du 16 juillet 1995 au cours duquel la France reconnaît enfin sa responsabilité, propose aux Français un nouveau récit national de réconciliation. La dette de l’Etat français à l’égard du groupe historique des résistants est remplacée par une dette à l’égard de deux nouveaux groupes : la communauté juive pour la collaboration active de Vichy dans l’extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et l’ensemble des Justes, qui ont en aidant les Juifs et en en souvent les 3/4, limité cette politique d’extermination
« Devoir de mémoire » devient un outil de mobilisation pour les autres mémoires
Alors que le « devoir de mémoire » se référait majoritairement à la Shoah jusqu’en 1997, cette association devient ensuite minoritaire dans les usages du terme qui sont associés à d’autres faits historiques. L’expression est utilisée pour la déportation de répression touchant les résistants. Un atelier « devoir de mémoire » est créé lors de la Journée d’appel de préparation à la Défense. La nouvelle historiographie de la Première Guerre mondiale conduit à utiliser la formule « devoir de mémoire » pour évoquer les combattants de la Grande Guerre, de plus en plus considérés comme des victimes. La formule est mobilisée pour dénoncer le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Elle devient un outil privilégié dans la lutte pour la reconnaissance des mémoires post-coloniales : mémoire de la guerre d’Algérie, mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leur abolition. L’expression entre dans le dictionnaire Larousse pour la première fois en 2003.
Le vote des lois dites « mémorielles »
» La séquence qui s’ouvre à la fin des années 1990, du vote par les parlementaires de lois relatives au passé pour qualifier des faits historiques, illustre cette dimension du langage à travers les usages systématiques de la formule « devoir de mémoire ». Ces lois interviennent dans un contexte plus large de modification du mode de régulation du passé par le politique que l’on nommera par la notion de » gouvernance du passé » (…) Les actions alors menées au nom de la formule « devoir de mémoire » s’inscrivent dans le contexte de transformation du rôle de l’Etat, de ses prérogatives, de son autorité et de sa prétention à diriger la société au nom de l’intérêt général. Ces transformations voient apparaître une pluralité d’acteurs, publics ou privés, qui prennent part à la définition et à la mise en œuvre des actions publiques relatives au passé. Ces actions sont menées par ailleurs dans un contexte d’européanisation et de mondialisation de la mémoire. »
L’auteur étudie alors la place et la fonction que la formule du « devoir de mémoire » a prise lors des débats parlementaires qui accompagnent le vote de ces lois : reconnaissance de la « guerre d’Algérie » (1998-1999), reconnaissance du génocide des Arméniens (1998-2001), reconnaissance des Justes de France (1997-2000), reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crimes contre l’humanité (1998-2001), reconnaissance des Français rapatriés d’Algérie (2004-2005).
Les usages du « devoir de mémoire » connaissent une véritable explosion au cours des années 2000. De cette profusion, deux évolutions se dégagent. D’une part la formule est de plus en plus vivement critiquée par les historiens et, de ce fait, elle est moins reprise par les médias nationaux et par les acteurs institutionnels. D’autre part elle est utilisée avec les références les plus diverses et les plus inattendues, qui la diffusent dans toute la société.
Les critiques du discours scientifique à l’égard de la formule du « devoir de mémoire »
En 1996, Antoine Prost, spécialiste de l’histoire de l’éducation et de la Première Guerre mondiale, fait paraître ses Douze leçons sur l’histoire, qui proviennent de ses cours adressés aux étudiants en histoire de premier cycle à l’université Paris 1. En conclusion de ces leçons, l’auteur se livre à une critique du « devoir de mémoire » et plaide pour un « devoir d’histoire » dans la dernière phrase de son ouvrage : » Rappeler un événement ne sert à rien, même pas éviter qu’ils ne se reproduise, si on ne l’explique pas (…) Si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d’abord un devoir d’histoire« . Plusieurs historiens se positionnent alors pour le « devoir d’histoire » et contre le « devoir de mémoire » ce qui entraîne des processus de victimisation préjudiciables à la compréhension du passé et source d’instrumentalisations multiples. Un autre front de contestation s’ouvre du côté des chercheurs en éducation. Le « devoir de mémoire » est l’objet de critiques qui concernent la transmission scolaire du génocide des Juifs.
Les critiques envers le « devoir de mémoire » se cristallisent en 2000 autour du philosophe Paul Ricoeur. Il fait alors prévaloir une autre notion, celle de « travail de mémoire », empruntée à Freud dans le cadre de la relation analytique. Ce travail de mémoire difficile permet aux victimes de se détacher progressivement de leurs souffrances et permet conjointement à la collectivité de « briser la dette » envers elles par le pardon. On sort ainsi du « trop de mémoire » pour réconcilier le présent avec le passé. Cette notion de « travail de mémoire » est reprise par des historiens, comme Henri Rouso ou les auteurs du rapport de la mission Mattéoli, mais également par le président Chirac.
Critique des lois mémorielles et mise à distance de la formule
L’historien Olivier Pétré-Grenouilleau fait paraître en 2004 un travail de synthèse sur les traites négrières. Il montre qu’elles ne sont pas des génocides et qu’elle n’avaient pas pour but d’exterminer un peuple. Une association dépose une plainte contre lui pour contestation de crime contre l’humanité en se fondant sur l’article 1 de la loi Taubira qui reconnaît la traite et l’esclavage comme des crimes contre l’humanité.
La plainte est finalement retirée en février 2006 mais cette action de l’association entraîne dans les milieux universitaires une mobilisation qui part d’un noyau composé de Françoise Chandernagor, René Rémond et Pierre Nora. Ils élargissent à la question soulevée par la loi du 23 février 2005 des rapports entre l’écriture de l’histoire et la politique, en lançant une pétition dans le journal Libération, demandant l’abrogation des lois qualifiées quelques jours plus tard par Pierre Nora de « lois mémorielles ». La mobilisation de ces historiens aboutit en juin à la création du « Comité de vigilance des usages publics de l’histoire » qui dénonce l’intervention croissante du pouvoir politique et des médias sur les questions d’histoire. A la suite de la pétition « Liberté pour l’histoire », 31 personnalités, dont Serge Klarsfeld et Claude Lanzmann écrivent une lettre ouverte, dans laquelle ils défendent les trois lois attaquées (« loi Gayssot », « loi Taubira, loi sur le génocide des Arméniens) pour lesquels « le législateur ne sest pas immiscé sur le territoire de l’historien« .
Le président de « Liberté pour l’histoire », René Rémond, présente en 2006 le « devoir de mémoire » comme le fondement des lois mémorielles. L’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 qui prétendait obliger l’enseignement de l’histoire à reconnaître les aspects positifs de la colonisation française en Algérie, est finalement abrogé par décret du premier ministre le 15 février 2006. Le « devoir de mémoire » est ainsi de plus en plus activement associé à une instrumentalisation qui conduit à une fragmentation de la nation et à un renforcement du communautarisme.
Dissémination de la formule
Des indicateurs quantitatifs (nombre des occurrences de l’expression dans les quotidiens nationaux, les questions parlementaires, les dépêches AFP, les émissions de télévision) et des indicateurs qualitatifs (étude du vocabulaire des prescriptions officielles du ministère de l’Education nationale) montrent une diminution de l’emploi de la formule qui suscite une réelle défiance dans les milieux scientifiques et institutionnels. Mais parallèlement et paradoxalement, la formule se propage et » ses usages échappent à toute tentative normative« . La formule est omniprésente dans les journaux de la presse régionale ; elle sert de nom à de très nombreuses associations, elle se diffuse sur Internet et dans les réseaux sociaux.
On aura donc tout intérêt à faire l’effort d’entrer dans cet ouvrage remarquablement bien construit et très intelligent, afin d’éviter l’usage abusif de cette formule ; plus particulièrement encore si l’on est professeur d’histoire. On ne manquera pas d’être impressionné par l’immensité des connaissances acquises par l’auteur et nécessaires à sa réflexion. On comprendra beaucoup mieux les débats encore récents sur les lois mémorielles et les critiques de nombreux historiens sur cette formule et cette injonction.
© Joël Drogland
______________________________
Recension de Laurent Bensaïd
A l’image des philosophes des sciences qui étudient l’évolution d’un concept , Sébastien Ledoux montre comment la notion de devoir de mémoire d’abord limitée au domaine de la psychanalyse et de la littérature, devient le symbole d’un nouveau rapport de la société à son passé, ainsi qu’un enjeu politique essentiel. A une lecture «glorieuse» du passé se substitue une lecture « morale » du passé qui met l’accent sur les « fautes » de l’ Etat et sur la nécessité de les reconnaître pour s’en libérer. On reprendra la définition du Petit Larousse illustré où le terme est apparu en 2003 :« l’obligation morale de témoigner, individuellement ou collectivement, d’événements dont la connaissance et la transmission sont jugées nécessaires pour tirer les leçons du passé ( la Résistance ou la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple)».
Archéologie du devoir de mémoire
Le terme de devoir de mémoire apparaît au début des années 1970. Il appartient d’abord au champ psychanalytique et littéraire. Au milieu des années 1970 et au début des années 1980, l gagne le champ social, historiographique et politique. La crise économique des années 1970, l’épuisement des dynamiques des Trente Glorieuses, ce que Pascal Ory nomme « la Révolution de 1975 », s’accompagnent d’une réflexion sur le patrimoine et l’identité. Loin d’être conservatrice, cette mémoire peut être celle d’une mémoire populaire ou régionale ( on songe au « Cheval d’orgueil » de Pierre Jakez-Hélias ) que l’on accuse l’histoire officielle d’avoir occultée. Dès cette époque, les ouvrages ou les émissions de télévision accordent une large place aux témoins situés à la charnière du passé et du présent. C’est aussi l’époque où le contexte intellectuel change. La critique des régimes communistes après la publication en France de « l’ Archipel du Goulag » conduit à une remise en cause de l’eschatologie révolutionnaire et à une vision morale de l’histoire et de la politique. La crise des « grands récits » ( le « roman national », le projet communiste) s’accompagne d’une nouvelle réflexion historique symbolisée par « Les lieux de mémoire » dirigés par Pierre Nora. Celui ci dresse le constat d’une société hantée par le risque de perdre son histoire ,ce « qui fait de chacun l’historien de soi (et) nous soumet tous au devoir de mémoire ». Nora est également soucieux de la perte d’une certaine identité de la France, inquiétude qui le conduisit à la mise en oeuvre de l’ouvrage. La fin des années 1970 et le début des années 1980 marquent le début de l’utilisation de la notion de devoir de mémoire pour évoquer le génocide des Juifs. Les survivants, les enfants des victimes accordent une grande importance à la transmission du passé. Il s’agit à la fois d’un impératif moral, d’une reconstruction identitaire et d’une lutte contre le négationnisme dont on a oublié la violence au début des années 1980. Enfin, la décennie 1980 est marquée par l’introduction de la notion de devoir de mémoire dans le domaine politique et institutionnel. Le souci du devoir de mémoire est porté par des hommes comme Jean Laurain , ministre des Anciens combattants de François Mitterrand, Louis Mexandeau, Jean Le Garrec ou Michel Noir qui sont souvent d’anciens Résistants ou des enfants de Résistants/Déportés et de ce fait très sensibles à la transmission du souvenir de la Résistance.
Sébastien Ledoux utilise à leur propos le terme original de « pollinisateurs » de la notion de devoir de mémoire. Au delà des hommes, Sébastien Ledoux souligne une évolution de la politique mémorielle de l’ Etat à partir de l’élection de François Mitterrand en 1981. Après Giscard d’ Estaing, accusé d’avoir été oublieux du passé, le nouveau pouvoir entend reconstruire une mémoire nationale afin de donner aux concitoyens une image de la nation qui soit cohérente et gratifiante. Cette politique se traduit par une valorisation de l’enseignement de l’histoire ( « un engourdissement de notre mémoire serait un véritable danger national « déclare Pierre Mauroy en 1984), mais aussi par une politique menée au sein du ministère des Anciens combattants. Au vocabulaire traditionnel du « souvenir » en usage depuis la fin de la première guerre mondiale, le Ministère substitue celui de mémoire, moyen de préserver la « conservation de la mémoire collective de la France combattante », mémoire incarnée par les souvenirs des combattants, par des monuments, des lieux ou des archives, et de la transmettre aux jeunes générations avec un objectif éducatif et moral.
A titre d’exemple, les nécropoles, les cimetières militaires ne sont plus présentés comme des « lieux de mort exigeant un travail d’entretien », mais comme des « témoins de l’histoire ».
La cristallisation de la notion de devoir de mémoire
La fin des années 1980 et le début des années 1990 voient la cristallisation de la notion de devoir de mémoire qui occupe alors une place importante dans l’espace public .Plusieurs éléments se conjuguent pour l’expliquer : le développement du négationnisme, la montée du Front national et les déclarations provocatrices de son président sur les chambrez à gaz « point de détail de la Seconde guerre mondiale «, les procès pour crimes contre l’humanité de Barbie et de Touvier, enfin l’attitude ambiguë de François Mitterrand lors de la commémoration du cinquantenaire de la rafle du Vel d’ Hiv en 1992, qui refuse de reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des juifs, mais qui, l’année suivante, instaure une journée de commémoration de la rafle. Plusieurs éléments témoignent de l’importance prise par la notion. En juin 1993 ,l’un des sujets de philosophie proposés aux candidats au baccalauréat de la série littéraire était : « Pourquoi y a-t-il un devoir de mémoire ? », signe que le terme est légitimé par l’institution scolaire comme « une notion commune de notre horizon temporel tendu entre l’expérience ( le passé) et l’attente (futur) ».
Autre signe, ce sont les émissions télévisées « La marche du siècle » ,crée par le journaliste Jean-Marie Cavada (lui-même enfant à l’histoire complexe pendant la deuxième guerre mondiale) et qui connaissaient un grand succès. En juin 1992 l’une des émissions était consacrée à la rafle du Vel d’ Hiv , et en juin 1993 l’émission était intitulée « Le devoir de mémoire ». Sébastien Ledoux considère que ces émissions contiennent les principaux éléments qui constituent le devoir de mémoire : dénonciation de l’occultation de la complicité de Vichy dans la déportation des Juifs , critique d’un silence qui « rend malade « la société française ( en 1987, Henry Rousso avait publié « Le syndrome de Vichy » qui empruntait de façon métaphorique à la psychanalyse les termes de « refoulement » ou de « névrose »), mise en valeur du témoignage et de la souffrance des témoins, indignation morale . Lors de l’émission de 1993 sont invités le philosophe Paul Ricoeur, le procureur Pierre Truche ( procureur lors du procès Barbie) et l’historien Pierre Nora. Ainsi, à partir du début des années 1990, la notion de devoir de mémoire est-elle devenue un « référent social » « un projet collectif dans l’espace public »(au sens où l’entend le philosophe Habermas). L’importance du devoir de mémoire va se cristalliser autour d’une « crise de mémoire », celle de la responsabilité de l’ Etat français dans le génocide des Juifs. L »amnésie », l’attitude ambiguë de François Mitterrand apparaissent comme un scandale, c’est à dire comme un moment de transformation où la société affirme son attachement à des nouvelles normes telles que la défense des droits de l’homme ou de soupçon à l’égard de la parole officielle de l’Etat. Les années 1990 marquent l’apogée de la notion de devoir de mémoire liée à la responsabilité de Vichy dans le génocide : émissions télévisées, commémorations, discours d’hommes politiques, politiques éducatives, telles que les voyages scolaires à Auschwitz, actions éducatives à l’échelle européenne, prise de position de l’ Eglise. Le discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995 s’inscrit dans ce courant et en constitue l’événement le plus emblématique. Sébastien Ledoux y voit « la conversion de l’ Etat français à un nouveau régime mémoriel ». On le sait, la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide juif marque une rupture de Jacques Chirac par rapport à l’attitude adoptée par ses prédécesseurs. Le discours marque un relatif effacement du rôle des Résistants, une préoccupation pour les droits de l’ Homme à travers l’évocation du génocide et de l’hommage rendu aux Justes, mais aussi hommage « rendus aux morts à cause de la France » et non plus aux « morts pour la France ». La mise en cause de la France suscita du reste l’opposition de Républicains et de gaullistes comme Jean-Pierre Chevènement ou Pierre Juillet, mais aussi de Robert Badinter.
A partir de cette période, la notion de devoir de mémoire devient un outil de mobilisation pour les autres mémoires. Les Résistants comme Madeleine Riffaud ou Lucie Aubrac plaident pour le maintien du souvenir de la Résistance. Le devoir de mémoire devient un outil privilégié dans la lutte pour la reconnaissance des mémoires postcoloniales. Deux faits historiques sont « évoqués : la traite transatlantique et l’esclavage, et la guerre d’ Algérie. Il s’agit à la fois de pointer les crimes commis par la France envers des populations, mais aussi de signaler le traitement discriminant que connaissent leurs descendants ultramarins et nord-africains dans un contexte de ségrégation socio-ethnique. La mémoire de la période coloniale et de la décolonisation présente des points communs avec celle de la mémoire de la Shoah. Les commémorations jouent un rôle pour dénoncer le silence et l’amnésie de la France sur la période coloniale et la guerre d’ Algérie, tels que les massacres de Sétif ou du 17 octobre 1961 ou la pratique de la torture dans l’armée française. L’année 1998 qui marque le 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage est marquée par la référence au devoir de mémoire. Les autorités officielles souhaitent avant tout mettre en valeur le rôle des abolitionnistes et célébrer l’unité républicaine , mais des écrivains antillais comme Edouard Glissant élaborent un discours alternatif qui dénonce l’amnésie
collective du passé esclavagiste et évoque l’affirmation d’une nouvelle identité créole à travers la remémoration du passé douloureux de l’esclavage. Christiane Taubira évoque une « souffrance muette, enfouie ». La valeur thérapeutique de la reconnaissance de la souffrance passée par la parole publique est ainsi soulignée. Ces nouveaux enjeux se traduisent par l’adoption par le Parlement de ce que l’on nomme souvent des lois mémorielles, mais que Sébastien Ledoux préfère nommer « lois de reconnaissance » c’est à dire reconnaissance du préjudice subi dans le passé par un groupe historique dont les descendants souffrent eux aussi de ce préjudice ouvrant droit à des réparations matérielles et/ou symboliques. « Dire l’histoire « n’est plus réservé au Président de la République, mais échoit parfois au Parlement. Plusieurs lois illustrent cette politique. La loi de 1998-1999 sur la reconnaissance de la « guerre d’ Algérie » ( jusqu’alors on parlait d » opérations effectuées en Afrique du Nord »), la reconnaissance du génocide des Arméniens, reconnaissance des Justes de France reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crimes contre l’humanité , et reconnaissance des Français rapatriés d’ Algérie.
Ces lois provoquent parfois de vifs débats, en particulier la loi de 2004-2005 qui prévoyait que les programmes scolaires devaient reconnaître le rôle positif de la présence française Outre-mer. Ces lois provoquent par réaction la création en 2005 de l’ association « Liberté pour l’histoire » qui demande l‘abrogation des lois mémorielles. De son côté l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau, mis en cause pour avoir déclaré que les traites négrières étaient un crime contre l’humanité mais non un génocide, rappelle que l’historien n’est pas un juge « et qu’il « n’appartient pas à l’Etat de dire l’histoire au risque de confondre histoire, mémoire et morale. Plus que d’un devoir de mémoire, on a besoin d’un souci de vérité et d’analyse critique ». De fait, à partir de la fin des années 2000, on assiste à un diminution de l’évocation du devoir de mémoire de la part des dirigeants politiques et des journalistes. De leur côté, les « cercles dirigeants » au sein du ministère de l’Education nationale privilégient la notion de « devoir d’histoire essentielle pour pacifier les conflits de mémoire et prônent la mise en application d’une « juste mémoire ». Ce recul institutionnel n’empêche nullement la présence de nombreuses associations évoquant le devoir de mémoire. Avec humour l’auteur signale qu’un cheval de course fut même nommé « Devoir de mémoire »……
Un bilan critique nuancé
Le bilan est nécessairement nuancé. Le devoir de mémoire a permis à des groupes dont l’histoire n’avait pas été suffisamment prise en compte de faire entendre leur voix et de voir leur histoire mieux reconnue. En même temps l’histoire du devoir de mémoire montre une inflexion de la politique commémorative de l’Etat. Face à la crise économique et faute de pouvoir proposer un projet d’avenir identifiable, l‘Etat a parfois tendance à faire de la mémoire un élément majeur de la cohésion nationale.
Surtout, la formule du devoir de mémoire favorise un régime mémoriel inédit dans l’histoire qui voit les représentants de la nation célébrer au nom des droits de l’homme « des morts à cause de la France ». Enfin le devoir de mémoire suscite les critiques d’historiens comme Annette Wieviorka , Henry Rousso, Antoine Prost ou Olivier Lalieu qui critiquent les «dérives» d’un devoir de mémoire qui privilégie une référence obsessionnelle au passé au détriment de l’analyse historique. L’auteur accorde un place importante à la réflexion du philosophe Paul Ricoeur qui tout en soulignant la nécessité de se souvenir du passé, privilégie le terme, emprunté à Freud de « travail de mémoire » pour « ouvrir un futur au passé ». Toutefois, malgré ces critiques, à la fin de sa conclusion Sébastien Ledoux met l’accent sur les mérites du devoir de mémoire.
Le devoir de mémoire apparaît comme un moyen de « rester en lien avec. Avec ses souvenirs individuels, avec la communauté des siens disparus, avec un passé recomposé collectivement selon les sensibilités du présent, avec un présent privé de promesses d’avenir pour le rendre supportable ».
Laurent Bensaïd