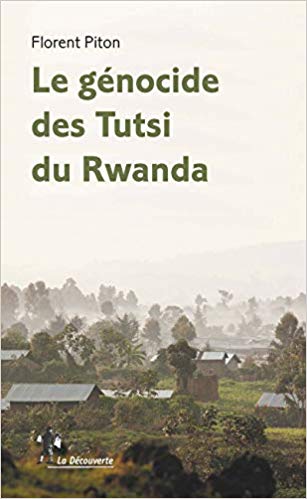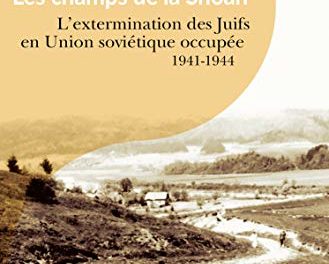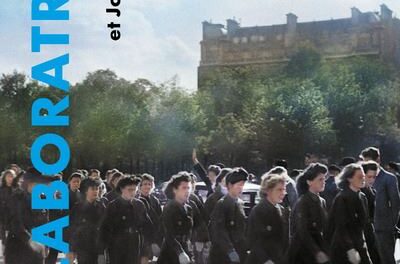Depuis longtemps, nous autres, professeurs d’histoire, devons enseigner à nos élèves le génocide de 1994 au Rwanda. Avouons-le, chers et estimés collègues, nos manuels scolaires ne sont pas sur ce point d’un grand secours. Souvent résumé en une à deux lignes dans les manuels de classe de Troisième, le plus souvent absent des manuels de Terminale, en raison d’un programme curieusement bâti, le génocide rwandais fait partie des angles morts de nos enseignements. Cela fait donc longtemps que je recherche un ouvrage de référence, qui fasse objectivement la synthèse de ce point d’Histoire.
Le sujet est très actuel. Disons même d’une actualité brûlante. Nous commémorons en cette année le vingt-cinquième anniversaire de ce génocide. Le temps devrait être celui de la réflexion, et — osons le mot — du recueillement devant cette abjection, nouvel avatar de la monstruosité du siècle précédent. A l’instar des Juifs, Tziganes, Arméniens, et aussi des Hereros, des Cambodgiens, voire des Ukrainiens, les Tutsi et Hutu modérés en furent les victimes. Même s’il existe aujourd’hui un négationnisme de ce génocide — comme pour les autres — les faits sont avérés.
Or, l’actualité de ce sujet n’invite guère au recueillement. Et nous ne pouvons que le déplorer. Depuis sa prise de pouvoir, en 1994, le président rwandais, Paul Kagame, nouvel homme fort de l’Afrique contemporaine, a exploité la mémoire du génocide pour pousser ses pions sur l’échiquier politique international. En miroir, un négationnisme s’est largement développé. La France, dont le rôle est encore relativement mal connu (cf. infra), a récemment décidé d’ouvrir la totalité des archives militaires — ou plus exactement d’habiliter « secret défense » une commission d’historiens, dont Hélène Dumas et Stéphane Audoin-Rouzeau, pourtant fins connaisseurs du sujet, ont été écartés sans que la raison nous apparaisse très clairement. Il faut dire que le flou qui entoure les motivations et interventions françaises a déchaîné, depuis vingt-cinq ans, les déclarations anti-françaises, les jugements de valeur, les procès d’intention des thuriféraires de la repentance de tous poils. Les grandes manœuvres des présidents Macron et Kagame autour de la désignation comme secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, alors que depuis 2010 l’anglais a remplacé le français comme langue d’enseignement public rwandais, plantent un décor d’une géopolitique complexe, où les aspects mémoriels font partie des pièces en place sur l’échiquier.
Bref, on l’aura compris, les enjeux autour du génocide de 1994 sont toujours bien présents et le sujet est encore l’otage de la situation. La guerre mémorielle fait rage. Et nous avons besoin d’un ouvrage de référence, suffisamment précis, scientifiquement irréprochable, capable d’établir les faits, d’indiquer les hypothèses, mais aussi d’avouer les ignorances sur un sujet qui, âgé seulement d’un quart de siècle, n’est pas encore, à notre sens, un objet d’Histoire, tout au plus d’histoire du temps présent. C’est là qu’intervient le livre de Florent Piton.
*
Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon, Florent Piton est chercheur en Histoire à l’université Paris Diderot et au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA). Ses travaux portent sur l’histoire des mobilisations sociales et politiques au Rwanda des années 1950 au génocide des Tutsi. Il est, depuis 2017, ATER à Sciences Po Paris. Jeune chercheur et enseignant, il s’agit là, à notre connaissance, de son premier ouvrage publié.
On peut toutefois mentionner ses deux articles :
- « Cultures obligatoires, monétarisation et mobilisations sociopolitiques dans le monde rural à la fin de la colonisation. L’arrachage des caféiers du Mulera au Rwanda en octobre 1958 », Cahiers d’études africaines, n° 224, déc. 2016, pages 799-819. (à lire sur CAIRN)
- « Des criminels sur la toile. Le négationnisme du génocide des Tutsi sur internet », Dialogue. Revue d’information et de réflexion, n° 205, mai 2014, pages 3-21 (revue spécialisée sur les problèmes « qui intéressent surtout le Rwanda »).
Voici la quatrième de couverture :
« D’avril à juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de Tutsi sont exterminés au Rwanda. Le dernier génocide du XXe siècle ne s’inscrit pourtant pas dans une histoire séculaire d’antagonisme ethnique. Il est le produit d’un racisme importé des sciences coloniales et réapproprié par une partie des acteurs politiques rwandais et de la population. Cet ouvrage analyse l’émergence et les évolutions de ce racisme, et la manière dont il conduisit au génocide et fut mis en actes par les pratiques de violence.
Il montre ainsi que l’extermination des Tutsi, quoique n’étant pas inéluctable, ne fut ni un accident ni une réaction spontanée. En évoquant aussi bien les tueries au plus près de leurs conditions d’exécution que le rôle des acteurs de l’État et de la communauté internationale, tout particulièrement l’ONU et la France, l’auteur inscrit cet événement au cœur de notre XXe siècle et des enjeux contemporains. L’analyse des questions mémorielles et judiciaires, et de la sortie du génocide, permet enfin de comprendre que ses conséquences se font ressentir aujourd’hui encore dans tous les aspects de la vie sociale ».
Et la table des matières :
I / Le Rwanda colonial (1894‑1959)
Le Rwanda à la veille de la colonisation
Une monarchie solide, mais en crise dynastique – Les rapports sociaux avant la colonisation
La situation coloniale
De la colonisation allemande à la colonisation belge – Les modifications du cadre monarchique et administratif – L’évangélisation de la société
La racialisation des rapports sociaux
Mythe hamitique et mythe bantou – Anthropométrie et anthropologie sociale au service d’un racisme colonial – La féodalisation de la société
II / Le Rwanda indépendant (1959‑1990)
De la révolution à la « République hutu » (1959‑1962)
La politisation de la question Hutu-Tutsi – De la « monarchie tutsi » à la « République hutu » ? La geste révolutionnaire – L’indépendance au risque du génocide ?
De la Ire à la IIe République (1962‑1990)
Finir la révolution – L’encadrement de la société : une dictature développementaliste – De la réussite à la crise économique et sociale – La persistance de la question ethnique
La question des réfugiés
La vie en diaspora(s) pour les réfugiés tutsi – Le refus du droit au retour – La création du Front patriotique rwandais (FPR)
III / Guerre, multipartisme et « violence génocide » (1990 ‑ avril 1994)
La guerre
Les étapes de la guerre, de l’attaque du 1er octobre aux accords d’Arusha – Un enjeu des relations internationales dans le monde post-guerre froide – L’engagement français pendant la guerre – La militarisation de la société dans un contexte de crise
Le multipartisme
De l’ouverture démocratique au Hutu Power – De nouveaux registres de mobilisation – Violence politique, « violence génocide »
L’émergence de médias extrémistes
Les mutations du paysage médiatique – Les contenus des médias extrémistes – Réception et circulation de la propagande antitutsi
La systématisation des violences antitutsi
La question des déplacés – La définition de l’ennemi – Pogroms et logique génocidaire
IV – Icyo gihe, « ce temps‑là » du génocide (avril‑juillet 1994)
Lieux et chronologie des massacres
De l’attentat à l’élimination des opposants politiques – Le déclenchement des massacres et leur extension dans le pays – Bandes, barrières, massacres : le déroulement du génocide à l’échelle locale
La multiplicité des transgressions
Tuer dans les églises – Les femmes et les enfants dans les bandes de tueurs – Tuer au cœur de la famille – Le viol comme acte de génocide
L’expérience tutsi pendant le génocide
Les armes et les pratiques de cruauté – Pillage et destruction des biens – Survivre et résister au génocide
V / Les acteurs du génocide
Les autorités politiques
De l’akazu au « réseau zéro » : le clan présidentiel –
Le gouvernement intérimaire des abatabazi et les responsables des partis – La mobilisation de l’administration locale
L’armée et les milices
Le rôle de l’armée – L’autodéfense civile : armer le « peuple » hutu – La constitution des milices
L’ampleur de la participation populaire
Quand les voisins deviennent génocidaires – Ibitero : les bandes de tueurs – Le rôle des réfugiés burundais dans les communes du Sud
La communauté internationale
De l’abandon à la reconnaissance du génocide – L’évacuation des ressortissants étrangers, 163
La question française : l’opération Turquoise
VI / Sortir du génocide (juillet 1994‑2018)
Mettre fin au génocide
La guerre et l’exode – La poursuite des massacres après juillet 1994 – Les accusations contre le FPR – Les guerres du Congo – Faire face au négationnisme
La justice transitionnelle
Identifier et classer les crimes – Économie des peines et politique carcérale – Le génocide des Tutsi devant la justice internationale
Mémoire et réconciliation
Compter, enterrer, montrer les morts – La politique mémorielle – Avouer, pardonner, réconcilier –
Être rescapé
*
On le constatera à la simple lecture de cette table des matières détaillée : le plan est classique, d’une chronologie qui se resserre autour du génocide lui-même et aborde — seul chapitre réellement thématique — les acteurs du génocide.
Le livre de Florent Piton est par ailleurs riche d’annexes fort utiles : citons une chronologie, la liste des acronymes, un très intéressant glossaire des termes en kinyarwanda, une bibliographie et un index des noms de personnes.
*
Florent Piton met plusieurs fois en garde contre la présence d’un négationnisme. Or, le danger est réel. Certains groupes travaillent en ce sens (une simple recherche internet livrera des références souvent nauséabondes). Une des formes de ce négationnisme consiste à opposer le génocide des Tutsi aux massacres, eux aussi bien réels, perpétrés au long de l’histoire récente contre les populations hutu, renvoyant ainsi les deux groupes dos à dos et donc niant la spécificité du génocide de 1994. Or, si des massacres croisés dans ces années 1990 sont bien attestés, et démontrent une violence mutuelle, ils ne peuvent en aucun cas être comparés au génocide de 1994. Ainsi, toute mise en balance nous semble, à l’instar de l’auteur, une tentative de négationnisme.
D’un autre côté, l’instrumentalisation du génocide par le président Kagame et son parti nous semble bien évacuée par l’auteur. Si l’on peut naturellement comprendre et admettre la nécessité du souvenir du génocide — une politique bien décrite par l’auteur — il ne faut pas faire preuve de naïveté. Le président Kagame — c’est son droit et son intérêt — instrumentalise le génocide au service d’un pouvoir dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est bien en place. À notre sens, la permanence du pouvoir de l’homme fort du Rwanda et l’utilisation qu’il fait du génocide, notamment au travers des accusations portées contre la France, alimentent en retour un négationnisme dont il faut redire le caractère inacceptable.
Cependant, l’histoire de la région des Grands Lacs ne se limite pas aux années 1990. Et, si l’objet de l’auteur n’est pas l’Histoire de toute la région, l’appréciation historique du génocide de 1994 ne peut pas se réaliser hors-sol, c’est-à-dire sans faire l’histoire de ce qui s’est passé entre ces deux ethnies en d’autres temps, voire d’autres lieux. Or, l’histoire de violence entre ces deux groupes est ancienne. On consultera avec projet à ce sujet l’article de René Lemarchand, paru dans les Cahiers d’études africaines : René Lemarchand, « Le génocide de 1972 au Burundi », Cahiers d’études africaines [En ligne], 167 | 2002, mis en ligne le 22 juin 2005, consulté le 09 juin 2019.
Voici le résumé de l’article, qui permettra d’en comprendre tout l’intérêt pour notre sujet :
« Vingt-deux ans avant l’hécatombe du Rwanda, qui fit environ 600 000 victimes, la plupart tutsi, un autre génocide ensanglantait la région des Grands Lacs : entre 200 000 et 300 000 Hutu furent massacrés par l’armée du Burundi à la suite d’une rébellion hutu qui fit des milliers de victimes chez les Tutsi. Au Rwanda comme au Burundi le meurtre de masse porte tous les signes distinctifs du génocide : le ciblage ethnique des victimes, l’intentionnalité exterminatrice, l’ampleur des tueries. À la différence du Rwanda, où l’ethnie des génocidaires fut écartée du pouvoir, au Burundi c’est la minorité tutsi qui devait régner sans partage sur les destinées du pays, jusqu’en 1993. Ceci explique le silence officiel qui, jusqu’à aujourd’hui, entoure le génocide de 1972. Cette mise entre parenthèses des atrocités commises en 1972 a non seulement contribué à obscurcir leurs relations avec celles de 1994 au Rwanda voisin, mais a créé un non-dit officiel qui aggrave les tensions entre les communautés hutu et tutsi. Au Burundi comme au Rwanda le moment est venu de procéder à de véritables « retrouvailles de la mémoire », et, ce faisant, de reconnaître que la culpabilité n’est pas une voie à sens unique. Le plus grand danger qui menace la région des Grands Lacs est celui d’une mémoire ethnicisée, où chaque groupe se dispute le privilège de détenir la vérité, et où l’histoire départage les bons des mauvais suivant l’appartenance ethnique. »
J’invite nos collègues à lire l’article en ligne, très riche bien que rapide. On pourra également se reporter aux travaux de René Lemarchand, PhD à UCLA, professeur émérite à l’université de Floride et professeur invité dans de nombreuses universités européennes et africaines. Il n’est évidemment pas question de nier l’un ou l’autre des génocides, ni d’imaginer que l’un compense l’autre. Mais la grande différence — outre le nombre de victimes — tient à la permanence au pouvoir des Tutsi : dans le cas du génocide de 1972, les Tutsi — génocidaires — conservent un pouvoir qui tente avec succès de minimiser les faits — avec à ce point de réussite que je n’en étais pas moi-même informé avant d’avoir un peu travaillé la question ; dans le cas du génocide de 1994, les Tutsi — victimes — arrivent au pouvoir et exploitent la mémoire du génocide dont ils font une arme mémorielle particulièrement efficace. Il est dommage que l’ouvrage de Florent Piton n’aborde pas ces questions.
Finalement, trois reproches principaux peuvent ainsi être faits au discours véhiculé par l’ouvrage.
Le premier tient à ce que l’auteur appelle la « racialisation importée ». Sans nier la permanence de structures mentales coloniales ou précoloniales, il nous semble cependant que l’auteur va un peu vite en besogne lorsqu’il fait de la racialisation importée la ligne directrice des génocidaires. On a l’impression, à la lecture de certains passages, que le génocide a en fait été téléguidé depuis le passé par la racialisation coloniale. Or, il y a bien eu « réappropriation » récente par les populations rwandaises de cette « racialisation importée ». Ce que ne dit pas l’auteur, c’est que, à la différence des sciences coloniales du XIXe siècle, cette réappropriation s’est produite post-indépendance, et surtout post-Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, après 1945, plus encore après 1960, on sait ce que les dérives racistes peuvent produire. Cela ne justifie pas la « racialisation importée » : cela la replace simplement dans son contexte. Et il faut aussi remettre dans son contexte une « réappropriation » qui, elle, avait tous les éléments nécessaires pour en estimer la dimension maléfique.
Le deuxième reproche tient au rôle de la France, un rôle peu clair, de toute évidence. Pourtant, le procès qui est fait à la France, tant par le pouvoir rwandais que par des auteurs français, nous semble injuste, partiel, et pour tout dire partial. Il paraît admissible de dire que, comme tous les autres acteurs, la France a des intérêts géopolitiques en jeu dans la région au début des années 1990. Notons dès à présent que, pour ce qui nous concerne, la défense de ces intérêts ne justifie pas la complicité de génocide. Encore faudrait-il l’établir scientifiquement : or, ce n’est pas le cas. Trop d’auteurs — et malheureusement Florent Piton — se contentent de témoignages oraux, partiaux ou de troisième main. Il ne suffit pas d’utiliser un conditionnel récurrent. Il ne suffit pas de « suspecter ». Il ne suffit pas de dire que « les associations de lutte contre les réseaux de la « Françafrique » évoquent également des livraisons d’armes » (page 164)… Car, dans l’autre sens, il paraît également clair que beaucoup ont intérêt à engluer la France dans une culpabilité très à la mode depuis les années Chirac. Or, ce débat ressort d’une guerre mémorielle dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est bien peu scientifique. Il appartiendra aux historiens, dans quelques décennies, d’établir ce qui s’est réellement passé. À ce titre, les polémiques qui entourent d’ores et déjà la création de la commission d’historiens pour l’examen des archives de l’Élysée démontrent à l’envi qu’il sera difficile d’y faire œuvre d’historien. Il est même probable que les travaux de la commission seront critiqués de tous côtés une fois publiés, et ce quel qu’en soit le résultat.
Le président Mitterrand avait une conscience très aiguë des intérêts géopolitiques de la France et il a certainement agi dans l’intérêt bien compris de son pays — ce qui est le cas de tous les acteurs quels qu’ils soient. Finissons-en avec l’angélisme en géopolitique ! Mais la France est la seule à être intervenue et personne ne conteste, à ce que j’ai lu, que son action ait sauvé des vies (Florent Piton lui-même donne le chiffre de 15 000 personnes page 170), y compris parfois celles de génocidaires (leur crime était donc indiqué sur leur front pour qu’il soit si facile de les arrêter ?). Mais ni les Américains ni les Belges ni qui que ce soit d’autre n’ont agi, de quelque manière que ce soit, en dehors de gesticulations médiatico-diplomatiques sans intérêt ni effet sur le terrain. Les choses auraient-elles été pires sans intervention française ? On peut raisonnablement le penser. De même qu’on peut raisonnablement penser que le président Mitterrand avait plusieurs fers au feu dans cette intervention. Soyons très précis. Si l’Élysée s’est consciemment rendu complice d’un génocide, c’est une politique que bien peu de Français — votre serviteur compris — défendront. Il reste cependant à l’établir, et rien ne permet aujourd’hui de le faire.
Le procès ainsi fait ne peut déboucher que sur des conséquences très claires : les responsables politiques français (et occidentaux d’une manière générale) y regarderont à deux fois désormais avant de déclencher une quelconque intervention, laissant ainsi le champ libre aux massacreurs et assassins de tous poils, probablement financés, soutenus, armés par une Chine qui se moque comme d’une guigne de toute morale en politique internationale. Quelle terrible responsabilité sera alors celle des censeurs, à leur tour complices de tous les génocides à venir ! Ne vaudrait-il pas mieux cesser ces procès d’intention, qui se parent parfois des oripeaux à la mode des post-colonial studies ?
Enfin — c’est le troisième et ultime reproche — l’auteur semble parfois tomber dans une reconstruction a posteriori de la logique génocidaire. C’est naturellement le travail de l’historien de savoir discerner, dès leur origine, les éléments qui vont concourir au génocide. Et Florent Piton a réalisé sur ce point un travail qu’il faut saluer. Mais son livre prend parfois des allures de pamphlet à charge contre la colonisation, contre la France, contre l’homme blanc. C’est dommage, car cela discrédite en partie un ouvrage par ailleurs souvent remarquable. Comment, par exemple, porter des jugements de valeur (et est-ce bien là le travail de l’historien ?) sur la racialisation de l’opposition Hutus/Tutsis par la Belgique, alors que ces hommes-là ne sont que le produit de leur époque ? Autant faire un procès aux Athéniens d’aujourd’hui pour la présence d’esclaves au temps de Périclès ! Cela ne veut pas dire, naturellement, que nous trouvions cela moralement acceptable. Cela veut simplement dire que l’Histoire n’est pas la morale. Et qu’un historien se doit de ne pas juger les errements du passé à l’aune de catégories mentales présentes. Surtout quand ce jugement va être récupéré par tel ou tel acteur de la géopolitique actuelle.