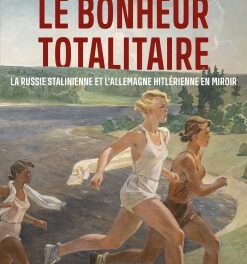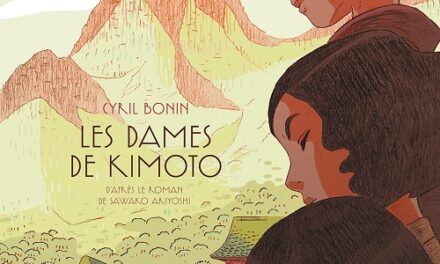La crise de 1929 est une sémillante octogénaire, que l’histoire très récente est venue remettre au goût du jour. L’originalité de l’ouvrage de Maury Klein est d’accorder une très large place aux années qui ont précédé la crise, au point qu’il serait peut-être plus juste de l’intituler « L’Euphorie des années 1920 » ou « La nouvelle Ère », la crise à proprement parler étant abordée seulement dans les deux derniers chapitres (sur onze) et l’épilogue.

Les héritages de la Première Guerre mondiale
L’auteur remonte à la Première Guerre mondiale, et même avant, à la création en 1913 de la Réserve fédérale (« Fed »), une institution jeune et aux attributions contestées : il suit ses tâtonnements tout au long des années 1920, ainsi que les luttes de pouvoir qui l’empêchèrent de jouer un rôle réellement efficace dans la tempête.
L’émission d’emprunts obligataires auprès du grand public pour financer la participation américaine à la Première Guerre mondiale a contribué à familiariser les Américains avec le marché boursier. L’habitude perdura durant les années 1920, puis le public se tourna vers les actions.
Pour mener cette guerre, nombre de comités avaient été mis en place, comme la Food Administration présidée par l’efficace Herbert Hoover : ils poussèrent dans nombre de domaines à une standardisation des productions qui permit d’accroître les profits et devint un modèle par la suite.
La prospérité des années 1920
Après la crise de la reconversion, à la fin de la guerre, l’économie américaine connut un essor qui s’accéléra par la suite, grâce au recours généralisé à l’électricité, qui permit une hausse impressionnante de la productivité des ouvriers, et à la diffusion de l’automobile. De nombreux exemples, en particulier des histoires d’entrepreneurs, permettent de mieux sentir l’esprit du temps et de percevoir les différentes couches impliquées dans cet essor et dans la hausse de la bourse, des très aristocratiques associés de Morgan jusqu’aux banquiers chargés de placer auprès d’une clientèle de plus en plus large les produits financiers « pour gogos ». On assiste ainsi à la transformation de Wall Street, autrefois club de gentlemen, en une industrie de masse, à grand renfort de publicité.
La confiance et l’optimisme étaient les traits dominants de l’esprit du temps, mais il est faux de dire que les crises avaient été oubliées, puisque la Floride était venue rappeler la versatilité des marchés : cet État était l’objet d’une spéculation immobilière intense qui culmina au milieu des années 1920. C’est à cette époque que la bourgade reculée de Miami devint un symbole de réussite facile, il suffisait, selon la rumeur, d’acheter n’importe quel terrain pour faire des gains mirifiques au bout de quelques mois. L’effondrement de ce marché en 1926 montra les dangers de la spéculation, mais il ne semble pas avoir été pris comme un avertissement. Au contraire, des produits toujours plus complexes, sous forme de fonds d’investissements, furent mis sur le marché avec un recours massif au crédit qui ruina ensuite les petits actionnaires.
L’escroc, le puritain, l’administrateur malheureux
Les présidents successifs incarnent chacun à leur manière les différentes facettes de ce phénomène. Warren Harding (1920-1923) n’était pas à proprement parler un escroc, mais fut victime d’un entourage composé d’aigrefins amateurs de poker, et plusieurs de ses proches se suicidèrent pour éviter aux enquêtes lancées contre eux. Lui-même mourut juste à temps pour échapper aux poursuites. Son successeur, Calvin Coolidge, se signala surtout par son silence et, selon Walter Lippman, par « un génie pour l’inactivité qui [atteignait] des sommets ». Il associa zèle religieux, non-intervention de l’État et développement des affaires dans des formules devenues des devises de l’époque comme « l’affaire de l’Amérique, ce sont des affaires », ou « l’homme qui construit une usine construit un temple » (un pasteur, incarnation des nouveaux évangélistes qui drainaient les foules, faisait inversement sa publicité en qualifiant la Trinité de « pétrole trois en un »).
On redécouvre en revanche les qualités réelles de Herbert Hoover, qui à toute autre époque aurait sans doute été considéré comme un grand homme d’État : ingénieur à l’origine, il se tourna vers la politique et l’administration à l’occasion de la Première Guerre mondiale, fut loué par Keynes pour son implication dans la reconstruction de l’Europe, défendit la SDN contre ses amis républicains, puis passa sept ans comme ministre du Commerce. Il y fit preuve d’un volontarisme sans faille et fut l’un des seuls à se méfier de l’expansion du crédit qui nourrissait la spéculation.
Le krach
L’auteur suit par le menu, jour par jour et même heure par heure, le déroulement des événements qu’on ne saurait réduire à un « jeudi noir » (le 24 octobre, du reste précédé par une première panique la veille), puisqu’ils durèrent plusieurs semaines. On voit ainsi les employés de bourse ou des maisons de courtage travailler plusieurs jours d’affilée, se faire livrer des sandwiches ou s’effondrer de fatigue. On perçoit l’incompréhension de tous ces gens face aux ventes massives et aux retraits de fonds de tous ceux, entreprises, banques, particuliers, qui avaient prêté l’argent avec lequel les investisseurs avaient acheté leurs actions à crédit et se trouvèrent ruinés. Très tôt, soit par stratégie de communication, soit par conviction réelle, les responsables économiques et politiques annoncèrent que le pire était passé et que l’économie « réelle » se portait bien. Hoover, qui avait pourtant rapidement réagi au travers d’un plan de baisse d’impôt, perdit dans les mois qui suivirent toute crédibilité, alors même que d’autres n’auraient pas fait mieux à sa place : il se trouva au mauvais endroit au mauvais moment. À sa décharge, il faut dire que l’absence de statistiques fiables empêcha longtemps de prendre conscience de la gravité de la situation du chômage.
L’ouvrage est parfois difficile à lire pour un Français, dans la mesure où il multiplie les exemples d’entrepreneurs et entreprises qui n’évoquent pas grand-chose. Il aurait aussi été utile de donner plus d’informations dans le cadre de la traduction: seuls les spécialistes de base-ball, a priori assez rares de ce côté de l’Atlantique, sauront ce que signifie le début de « l’âge de la frappe » ; d’autres allusions mériteraient d’être expliquées, quitte à raccourcir d’autres passages. On se perd en effet parfois dans les explications des montages financiers, et on finit par se demander à quoi bon suivre d’aussi près l’évolution des divers indices boursiers, qui finissent par donner le tournis ; l’impression est renforcée par la structure assez lâche de l’ensemble.
S’il ne s’agit donc pas de l’ouvrage de référence sur le sujet (d’autant que très curieusement il ne répond pas du tout à la question posée dans l’introduction et reprise en quatrième de couverture, celle du découplage entre le krach boursier et la Grande Dépression, apparue fin 1930) il s’avérera cependant utile pour qui souhaite ressentir l’atmosphère des années 1920.