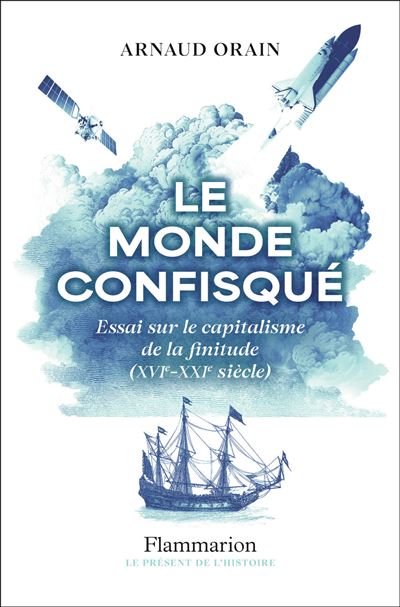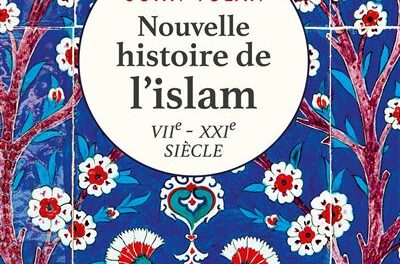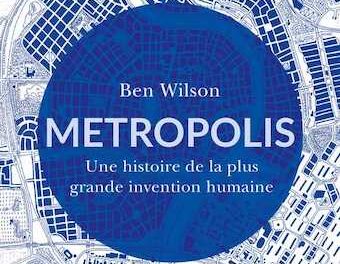Le dernier ouvrage d’Arnaud OrainIl est l’auteur de La politique du merveilleux. Une autre histoire du système de Law (1695-1795) en 2018 et de Les savoirs perdus de l’économie : contribution à l’équilibre du vivant en 2023) Le monde confisqué – Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle) est un essai personnel qui traduit sa vision des orientations actuelles du monde et de sa prise de possession par quelques Etats et quelques FTN. La thèse principale de l’auteur est très accessible.
Selon lui, depuis la naissance du capitalisme au XVIe siècle, celui-ci n’a connu que deux formes ont rythmé l’histoire du globe en se succédant l’un et l’autre à différentes reprises : le capitalisme « libéral » et le capitalisme « mercantiliste ».
Le premier est le mieux connu : c’est la forme smithienne du libre-échange et de la libre-concurrence, permettant le développement d’un commerce mondialisé et prétendument harmonieux (c’est la « mondialisation heureuse » défendue par les héraults de l’américanisation du monde en deux temps : après 1945 et après 1991).
Le second a été mal interprété au cours de l’histoire et Arnaud Orain prend le temps de le redéfinir en introduction. Le mercantilisme a souvent été réduit au seul protectionnisme, et cantonné à l’époque moderne. Or, le mercantilisme est avant tout un capitalisme prédateur et destructeur qui se fonde sur l’idée selon laquelle la richesse étant limitée, bornée, finie, pour qu’un État ou une entreprise s’enrichisse, elle doit s’emparer d’un maximum de richesses le plus rapidement possible. Arnaud Orain en donne cette définition : « le capitalisme de la finitude est une vaste entreprise navale et territoriale de monopolisation d’actifs – terres, mines, zones maritimes, personnes esclavagisées, entrepôts, câbles sous-marins, satellites, données numériques – menée par des États-nations et des compagnies privées afin de générer un revenu rentier hors du principe concurrentiel ».
Comment expliquer cette alternance quasi-cyclique entre les deux formes de capitalisme ? C’est que, comme l’écrivait l’économiste Karl Polanyi, le libéralisme économique ne peut que générer son anti-thèse : un capitalisme illibéral et autoritaire.
Dans son ouvrage, l’auteur cherche donc à décrire l’alternance entre ces deux formes de capitalisme, qui se succèdent sans jamais se reproduire exactement. A l’échelle de 5 siècles d’histoire, le capitalisme est donc vu comme un mécanisme dominateur dont la puissance repose précisément sur sa capacité à évoluer et à adapter les représentations du monde à ses besoins.
L’attrait principal du livre est sa capacité à proposer un modèle explicatif de la situation actuelle du monde. Depuis la crise financière des subprimes débutée en 2008, il semble en effet que les sociétés (d’abord occidentalisées, puis le reste de la planète, en particulier dans les pays émergents (le premier sommet des BRIC se réunit à Johannesburg en 2009) aient changé de regard sur la planète. La crise a mis un frein à un vaste élan de libre-échange, de délocalisations, de flux maritimes, de développement des mondes virtuels et des réseaux sociaux qui permettaient d’unifier le monde et de permettre la rencontre entre toutes ses parties. C’était le bon temps du capitalisme harmonieux et de la « mondialisation heureuse », du « village global », de la création des « communautés » par les premiers réseaux sociaux, de la « fin de l’histoire » selon Francis Fukuyama, que rien (pas même le terrorisme) ne pouvait empêcher. Après 2008, une autre représentation du monde s’est imposée : celle d’un monde aussi menaçant que menacé, parce qu’il est « fini » : les réserves de gaz et de pétrole s’amenuisent, les lancements de satellites apportent une meilleure vision de la planète Terre (qui devient une « île », forcément délimitée, au milieu de l’univers), les routes maritimes sont de moins en moins sûres, et les discours sur la transition écologique nous alertent sur les capacités limitées de la planète à produire les ressources que l’humanité a tendance à surconsommer. Après 2008, le monde devient borné, limité, fini. Ce sentiment d’angoisse entraîne une réaction dont l’auteur s’attache à expliciter la logique : puisque les richesses sont « finies », il faut se les accaparer avec précipitation.
Afin d’expliquer les principaux arguments de cet essai, nous proposerons plusieurs façons de lire l’ouvrage.
L’alternance chronologique et le redécoupage des phases du capitalisme
Arnaud Orain propose le découpage chronologique suivant :
Du début du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle : un capitalisme mercantiliste lié à l’amélioration de la connaissance de l’œcoumène. Les Grandes Découvertes, les explorations maritimes, la découverte des derniers continents inconnus, les traités de partage des aires d’influence sur le monde (1494, 1529, 1648, 1713) renforcent l’idée que le monde se réduit. C’est l’époque du colbertisme, des conquêtes territoriales en Europe et dans le premier empire colonial, des compétitions impériales et des rivalités entre les puissances européennes outre-mer. La Guerre de Sept Ans (1756-1763) est le moment révélateur de cette époque.
Entre 1815 et 1880, avec le développement de l’industrialisation en Europe et en Amérique du Nord, le capitalisme change de forme et s’ouvre au libre-échange. Le progrès technique, l’invention de la vitesse, le développement du télégraphe, ouvrent cette fois les portes d’un monde qui s’élargit à nouveau. Le pic de cette période de libre-échange et de libre-concurrence se situe entre 1850 et 1870, à une époque où les gouvernements s’appuient sur la force des entreprises, font entrer des entrepreneurs dans les Chambres élues et dans les gouvernements, et négocient les premiers traités de libre-échange.
Après 1880 et jusqu’à 1945, le monde se referme à nouveau sous l’effet de la course à l’impérialisme qui remet en avant le sentiment de finitude de la planète. La Grande Dépression débute en 1873, parallèlement à la naissance de nouveaux empires centraux, dont l’Allemagne (1871). C’est à la fin du XIXe siècle que reprennent les expéditions de découverte : celles vers la Route du Nord-Ouest, vers l’Antarctique, vers le cœur de l’Afrique. Berlin organise la grande conférence visant au « partage de l’Afrique » en 1884-1885 (c’est la période du Scramble for Africa). Au Royaume-Uni, Benjamin Disraeli organise le couronnement de la reine Victoria devenue « Impératrice des Indes ». En France, Jules Ferry devient ministre des Colonies et défend une vision raciste de la civilisation, particulièrement en Indochine. Friedrich Ratzel puis Karl Haushofer créent le concept « d’espace vital ». Theodor Herzl définit le sionisme à Bâle en 1897, appelant à rendre au peuple hébreu la Terre d’où ils ont été expulsés au cours de leur historie. L’impérialisme a conduit à la course aux armements puis à l’explosion de la Première Guerre mondiale. Malgré sa violence et le désir de paix qui a suivi, le conflit n’a pas mis fin aux rivalités et aux ambitions territoriales : l’Allemagne nazie rêve de revanche, l’Italie mussolinienne souhaite retrouver les terres irrédentes, et le Japon impérial développe le plus grand empire de son histoire, privant la Chine d’un développement dont elle avait déjà été exclue par les « Traités inégaux » du XIXe siècle.
Après 1945, la victoire des Alliés et la domination économique et idéologique des Etats-Unis ouvrent la voie à un nouveau capitalisme libéral, qui devient « néolibéral » à partir de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, dans les années 1980. C’est l’ère de la croissance industrielle reposant sur une consommation de masse et donc sur la liberté des flux d’exportation et d’importation. Le « monde » (même divisé par la guerre froide) est à nouveau ouvert et protégé par le gendarme américain qui développe un empire manufacturier et technologique avancé. La création des accords de Bretton-Woods et du GATT, puis le FMI et l’OMC, manifestent cette victoire du capitalisme libéral et la financiarisation du monde à venir.
Depuis 2010, le capitalisme a à nouveau changé de forme et est redevenu un nouveau capitalisme de la finitude. Le nouveau discours repose à la fois sur la conscience de l’urgence climatique, sur des éléments d’alerte tels que le « jour du dépassement », sur les rapports alarmants du GIEC, mais aussi sur l’entrée des pays émergents dans l’économie de marché. Puisque de la quantité de ressources disponibles dépend l’économie mondiale capitaliste, mais que ces ressources sont précisément reconnues comme limitées, et parce que les écosystèmes parviennent de moins en moins à absorber les désastres environnementaux causés par l’extraction en cours de ces ressources, il n’y a qu’une seule solution possible : la course en avant et la compétition désinhibée à l’accaparement des dernières terres et des derniers océans disponibles ! L’Inde, le Brésil, la Chine, l’Afrique du Sud, la Russie, accélèrent leur développement industriel, économique et financier, en accentuant leur capacité à s’emparer de leurs propres ressources : développement de l’industrie minière, de la déforestation, des secteurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie intermédiaire et des technologies (y compris les technologies numériques et spatiales). Nous assistons au retour des conquêtes afin de s’emparer des ressources d’autres pays : Crimée, Donbass, Hong-Kong, Taïwan, investissements chinois et brésiliens dans des terres arables du continent africain, Nouvelles Routes de la Soie, interprétation stricte des ZEE, course aux armements en Asie de l’Est… Les nouveaux Etats-Unis de Donald Trump emploient à présent la même rhétorique en menaçant de prendre le contrôle du canal de Panama mais aussi du Groenland, en réclamant que le Canada devienne un Etat des Etas-Unis, en rebaptisant le golfe du Mexique, en annonçant vouloir gérer la bande de Gaza. Le contexte contemporain est celui de la prédation des ressources et de l’affirmation de la souveraineté des Etats les plus puissants. Mais les Etats ne sont pas les seuls acteurs de cette prédation : les entreprises privées sont à présent aussi puissantes et peuvent à présent mener des campagnes d’influence voire d’ingérence dans d’autres pays : TikTok, Huawei, Meta, X, Amazon, NSO Group, Wagner…
Les caractéristiques du capitalisme de la finitude comme clé de lecture de la modernité occidentale et mondiale
Fermeture et privatisation des océans
Dans les périodes de libéralisme économique, c’est le principe de « mare liberum » qui prévaut. Paradoxalement, la liberté des mers était garantie par l’hégémonie d’une seule puissance navale : les Provinces-Unies, puis du Royaume-Uni, puis des États-Unis.
A l’inverse, dans les périodes de capitalisme de la finitude, la liberté des mers est absente et les navires ne peuvent circuler qu’en convois, accompagnés d’une flotte armée capable de les protéger de la piraterie ou de la guerre de course (Caraïbes, Méditerranée ou Mer de Chine méridionale du XVIe au XVIIIe siècle), du sabotage ou du torpillage par des sous-marins ennemis (XXe siècle) ou des attaques de groupes armés (Corne de l’Afrique, mer Rouge, golfe de Guinée, détroit de Malacca depuis les années 2000). Le risque est donc plus grand. Les mers se ferment à ceux qui ne peuvent pas militariser leur marine marchande ou passer des accords avec les responsables des attaques. Les premières armées navales sont nées au XVIIe siècle pour convoyer, empêcher ou détruire les navires de commerce et les ports ennemis. Cette fusion des intérêts militaires et commerciaux caractérise assez bien la course à la possession dans une pensée de la finitude des espaces et des ressources.
La Charte des Nations Unis sur le Droit de la Mer (Charte de Montego Bay) de 1982 est aujourd’hui interprétée comme la charte autorisant l’appropriation légale des mers jusqu’à 370km du littoral d’un État côtier. Les États souverains sont alors libres d’exploiter ce vaste espace, y compris les fonds sous-marins. Cet espace doit donc être parcouru, surveillé et défendu. Une confusion se produit entre marine commerciale et marine militaire. Dans le cas de la Chine, qui cherche même à s’approprier un espace maritime beaucoup plus étendu et projette sa propre souveraineté sur les ZEE des Etats voisins, une confusion se produit entre marine commerciale et marine militaire : des pêcheurs chinois qui travaillent sur des navires de pêche sont armés et formés par les garde-côtes chinois pour intervenir contre d’autres navires de pêche étrangers accusés d’entrer illégalement dans des eaux chinoises ; les garde-côtes chinois n’hésitent plus à faire chavirer des navires étrangers.
Pour que la liberté des mers prenne le sens que nous lui donnons, il faut qu’une puissance maritime prenne le rôle d’hegemon naval. Cela a été le cas au XIXe siècle : en 1856, la Grande-Bretagne signe la Déclaration de Paris pour abolir la guerre de course, garantir le commerce sous pavillon neutre et restreindre le droit au blocus maritime. La flotte de la Grande-Bretagne est la plus importante du monde et les Britanniques jouent alors le rôle de « gendarmes des mers ». Toutefois, ce traité est critiqué dès la fin du XIXe siècle, les militaires réclamant le droit de pratiquer la guerre de course ! Ce droit est même réapproprié de facto au cours de la Première Guerre mondiale, sous la forme de la guerre sous-marine à outrance, les U-boot allemands torpillant les navires de croisière accusés de transporter de l’armement pour les pays de la Triple-Alliance.
De plus, si ce rôle est de plus en plus concurrencé à la fin du XIXe siècle, après 1945, ce sont les États-Unis qui s’emparent à leur tour de cette fonction, jusqu’aux années 1990. En-dehors de ces deux périodes (qui correspondent à deux phases de capitalisme libéral), il n’existe pas d’hegemon, ce qui met la liberté des mers en danger. Depuis la fin de la guerre froide, et surtout après la présidence de Barack Obama, les États-Unis accélèrent leur retrait de l’interventionnisme maritime. Nous assistons alors, selon Arnaud Orain, à un retour des compétitions pour l’appropriation des terres, des ports, des îles et des routes maritimes, mais aussi à une course aux armements navals. La différence entre marine marchande et marine de guerre a toujours été brouillée en période de capitalisme de la finitude, et les années 2020 remettent cette confusion au jour. Il en donne plusieurs exemples : les attaques des rebelles Houtis du Yémen contre des navires s’engageant en mer Rouge depuis octobre 2023 (terrorisme maritime) ; les attaques au large de la Somalie et dans le Golfe de Guinée (piraterie maritime). Il s’attarde plus longuement sur l’exemple de la Chine impérialiste. La Chine emploie des moyens d’appropriation plus diversifiée : ligne des 10 traits en mer de Chine méridionale, armement des navires de pêche (c’est-à-dire confusion et interchangeabilité entre les marines militaires et commerciales), modernisation rapide de sa marine militaire, militarisation des îles et des ilots naturels, prise de contrôle de Hong-Kong, base navale hors du territoire national (exemple Djibouti), entraînements militaires et menaces récurrentes d’invasion de Taïwan, envoi de navires-usines dans des ZEE étrangères sans autorisation et sans achat de licence de pêche (pillage des ressources d’un Etat souverain), accompagnement des convois de porte-conteneurs et de pétroliers par des frégates militaires, dissimulation de rampes de lancement de missiles dans de faux conteneurs…
Remise en cause des mécanismes du marché
Ce sont les menaces américaines contre l’activité de TikTok aux États-Unis (la seule entreprise mondiale de la tech qui ne soit pas originaire de la Silicon Valley), et les réponses chinoises contre une politique américaine qui rejette l’économie de marché et la libre concurrence, qui servent d’entrée dans ce thème. En fait, Étasuniens et Chinois ne parlent pas du même capitalisme libéral. La Chine défend à présent un libre-échange ouvert sur le monde mais surveillé par la sphère politique (ce qui conduit les grandes entreprises chinoises à dépendre du gouvernement et du PCC) ; les États-Unis et l’Union Européenne ont longtemps défendu un laissez-faire qui permettait un retrait volontaire des États et laissait l’initiative économique aux entreprises dans le cadre d’une « mondialisation heureuse ». Depuis quelques années, les États occidentaux abandonnent cette représentation et souhaitent reprendre la main sur l’économie. Ce n’est pas que le libéralisme soit abandonné : c’est que l’activité économique nationale doit être dirigée et protégée par le monde politique en vue d’une guerre commerciale à venir. C’est le retour des monopoles, de la préférence nationale et du protectionnisme douanier. Pour ce qui concerne la démocratie, les États, en agissant ainsi, « sauvent » le modèle économique capitaliste et se protègent des risques de révolution sociale liée à une concurrence exacerbée.
Nous assistons donc à une transition du capitalisme du néolibéralisme vers une reproduction moderne du capitalisme de la finitude. Il ne s’agit plus de fournir une abondance de biens à la population grâce au libre-échange, mais de rendre la priorité à la productivité et aux relocalisations pour construire un État puissant, autarcique et autocentré. Les consommateurs modifieront leurs habitudes et toléreront les monopoles, le Made in France et la proximité des produits (finis).
Dans le capitalisme de la finitude (qui est un jeu d’échanges à somme nulle), un pays gagne en appauvrissant nécessairement son voisin. L’auteur compare et analyse plusieurs discours contemporains qui font largement écho à d’autres discours impérialistes, souverainistes, isolationnistes ou monopolistiques du XVIIe siècle ou de la fin du XIXe siècle. Mais cela se trouve vite confronté à un paradoxe indépassable : si l’horizon du capitalisme de la finitude est la plus grande autonomie économique possible, il faut pouvoir exporter pour s’enrichir vraiment. Or, dans un monde qui se ferme et le retour des frontières qui se doublent de tarifs douaniers dissuasifs, l’idée même de croissance économique doit être abandonnée… A moins de créer de manière agressive un marché d’écoulement des stocks dans des Etats rendus plus dépendants (de type colonial).
Les grandes compagnies mondialisées (les FTN) sont-elles concurrentes ? Arnaud Orain répond que non, car elles passent souvent des accords entre elles. Il établit par exemple un pont entre les « conférences » entre plusieurs sociétés du transport créées pour favoriser la cartellisation du secteur après l’ouverture du canal de Suez et l’organisation actuelle du transport maritime. En 1879, plusieurs entreprises du chemin de fer et de la navigation à vapeur se retrouvent dans la « Conférence du fret d’Extrême-Orient » pour coordonner leurs pratiques (horaires, prix du fret, rabais similaires aux meilleurs clients…). En 1892, l’Association des Lignes à Vapeur de l’Atlantique Nord lie les compagnies pour qu’elles se répartissent entre elles le nombre total de passagers au cours d’une année, fixent les tarifs des billets et du fret. Ces pratiques établissent des monopoles entre les plus grandes compagnies. De même, de nos jours, les 10 plus grandes compagnies maritimes assurent 95% du commerce et les 4 premières en assurent à elles seules 60%. Cette concentration par absorption des autres compagnies a conduit au projet de consortium entre le 1er et le 2e (Maersk et MSC) en 2015 (qui est rompu en janvier 2025). Dans le secteur ferroviaire, c’est l’UE qui a rejeté la fusion entre Alstom et Siemens en 2019 (signe que l’UE croit encore à un capitalisme d’une autre époque ?).
Car « le capitalisme est monopoliste » (Fernand Braudel), en particulier dans des périodes de finitude. Ce sont des considérations stratégiques et politiques qui l’encadrent afin d’empêcher le marché trop libre et le multilatéralisme. Il s’agit avant tout d’échapper à l’aspect « libéral » du capitalisme car la finitude accorde peu de confiance aux mécanismes naturels censés régir les échanges. Ce n’est pas l’Etat ou l’entreprise la plus innovante qui gagne : c’est la plus puissante.
Constitution d’empires par des FTN à attributs souverains
L’une des caractéristiques de la finitude est la domination de l’entrepôt sur la manufacture et l’usine, la domination de la logistique et du transport sur la fabrique. Arnaud Orain démontre que les pulsations du capitalisme de la finitude sont données par le « système des entrepôts », qu’il appelle aussi le « capitalisme d’entrepôts » ou le « capitalisme logistique ». Cette forme de domination est organisée autour du transport et du stockage. Les comptoirs, les ville-entrepôt, les magasins, les warehouses sont autant de plateformes de transit qui composent un empire commercial privé qui permet de réunir, de stocker et de distribuer les marchandises et les humains eux-mêmes convertis en marchandises (soldats à déplacer, missionnaires, esclaves, coolies, touristes…).
Autre caractéristique : les compagnies privées s’accaparent des fonctions régaliennes. Arnaud Orain montre le lien entre les prérogatives souveraines et l’activité commerciale des compagnies-Etat/FTN de l’époque moderne à l’époque actuelle.
Aujourd’hui, la situation est celle d’une « mondialisation logistique ». Les villes-entrepôts des époques précédentes sont remplacés par des quartiers d’entrepôts que les villes cherchent à attirer à elles. Walmart, Amazon, Tesla, deviennent des acteurs de l’aménagement du territoire. Les acteurs publics composent désormais avec leur influence pour organiser de vastes plateformes logistiques comme à Lauwin-Planque, Chalon sur Saône, Senlis, Montélimar… La gestion des flux en juste-à-temps et la maîtrise des prix par ces acteurs géants de la distribution font que le régime mercantiliste est aujourd’hui aux mains de quelques-uns, et que les acteurs publics ne peuvent que se soumettre à leurs décisions.
Nous assistons alors à un « éclatement de la souveraineté », dès lors que les États délèguent des pouvoirs aux compagnies qu’ils soutiennent politiquement et financièrement. En effet, les Etats tertiarisés ont abandonné des services aux sociétés privées de la tech, du cyber et du cloud, de l’aérospatiale et de l’aéronautique, de la sécurité. Les contrats entre le Pentagone, les agences de renseignement américaines et les firmes de la Silicon Valley ne sont pas des secrets ; les contrats entre la NASA et les entreprises spatiales privées (Space X, Blue Origin) font récemment la une des journaux. Le fait qu’Elon Musk, le PDG de Space X, ait été nommé ministre de l’Efficacité gouvernementale par le président des Etats-Unis, est l’illustration la plus récente de cette croisée des mondes. Mais ce pouvoir des « marchands-guerriers » va plus loin encore. Les câbles sous-marins, qui sont l’armature fixe du réseau internet mondial, sont désormais développés par Alphabet (maison-mère de Google), Meta et Amazon. Musk a mis les satellites de la constellation Starlink au service de l’effort de guerre ukrainien. Meta est décrit par son PDG comme un véritable Etat et Mark Zuckerberg est auditionné au Sénat américain pour confier son avis et reçu à Élysée comme un chef de gouvernement. Elon Musk est acclamé par Giorgia Meloni en Italie. Les sociétés gestionnaires d’actifs comme Black Rock, les agences de notation comme Fitch, Moody’s ou S&P, exercent une force de lobbying auprès de nombreux États financiarisés et souvent surendettés.
En résumé, la « souveraineté fonctionnelle » des FTN permet à des figures entrepreneuriales de restructurer le capitalisme de la finitude : les FTN ne sont plus des acteurs mais des faiseurs de marché. En position de quasi-monopole, elles rendent des services et exercent une autorité à laquelle il est de plus en plus difficile d’échapper, même si elles définissent les nouvelles règles en-dehors de tout contrôle démocratique. Par exemple, Facebook, Instagram, X et Tiktok décident eux-mêmes de la régulation de leurs contenus, de fact-cheking, de signalement des propos haineux ou discriminants, au nom de la liberté d’expression. Amazon règle les litiges entre vendeurs et acheteurs avec son propre système juridique. Elon Musk a lancé Neuralink en 2016, qui a déjà posé des implants cérébraux sur 3 personnes paralysées (février 2025) et joue avec la science transhumaniste. Les autorités morales, politiques, judiciaires et fiscales peinent à imposer leurs propres lois sur ces entreprises surpuissantes et plus riches que certains États !
Autre caractéristique, développée dans le chapitre 6 : la « mauvaise gouvernance » des ressources par certains Etats africains et sud-américains, les menaces que représentent cette mauvaise gestion pour l’humanité, justifierait le renversement de leur système gouvernement et la néo-colonisation par des puissances plus développées et donc plus responsables. Dans un contexte de finitude, il faut s’emparer du sol, car il faut tout contrôler (de la composition de la terre à son usage et aux populations qui y résident). Cette prédation réalisée dans des territoires extra-nationaux existe depuis l’Antiquité grecque et romaine, et elle renvoie au concept des « hectares fantômes » : les terres cultivées dont un pays aurait besoin sur son territoire pour produire la même quantité de calories qu’il prélève ailleurs. Ces « hectares fantômes » sont un pilier de la « Grande Divergence » au XVIIIe siècle : l’apport calorique des céréales, du sucre, du café, du chocolat, ont permis à la Grande-Bretagne de dégager de la main d’œuvre agricole nationale (remplacée par les esclaves des colonies) pour qu’elle se déverse dans les manufactures. Mais cela n’a pu se faire que par une forte domination foncière de la Grande-Bretagne sur des hectares colonisés, et qui sont par conséquent « fantômes » chez elle. La capacité à fournir des surplus de nourriture, de bras et de matières premières à la métropole est une justification principale de la colonisation depuis 2000 ans. Une autre est liée aux faibles rendements de l’exploitation des terres par des sociétés « agraires » ou « arriérées » qui, sans intervention extérieure, seront condamnées à souffrir toujours de la famine. Une autre est encore liée à « l’échange écologique inégal » (Andre Gunder Frank) qui consiste à externaliser les contraintes écologiques dont on ne veut plus chez soi (exemple l’enfouissement des déchets nucléaires ou le recyclage des produits les plus toxiques). Une autre est d’offrir un espace pour disperser un trop-plein démographique. Une autre, enfin, est lié à l’idéologie de l’expansion ou de la purification d’un espace jugé « vital ».
L’esclavage et les colonies sont à l’inverse considérées comme des poids trop lourds à porter pendant les phases du capitalisme libéral ; depuis la fin de cette dernière phase en 2008-2010, les discours pro-coloniaux (que ce soit pour des ressources ou pour évacuer une partie de la surpopulation) reviennent en force de la part de la Chine en Afrique orientale, de la Russie en Ukraine, des Etats-Unis au Venezuela, au Canada, au Groenland et à Panama, d’Israël à Gaza… Ce mouvement a été théorisé : c’est le « land rush » (ruée vers la terre), le « land grabbing » (accaparement des terres) ou encore le « large-scale land acquisition » (acquisition de terres à grande échelle). Il est d’abord lié à des fonds d’investissement, des fonds souverains, des firmes agroalimentaires ou des Etats originaires des Etats-Unis, de Chine, des Emirats-Arabes-Unis, du Brésil, qui achètent des terres en Indonésie, en Argentine, aux Philippines, en Ethiopie… pour installer des plantations de palmiers à huile, de caoutchouc, de café, de cannes à sucre ou d’agrocarburants, ou des fermes d’élevage de viande. Cette pratique de « sécurité alimentaire » ou de « mercantilisme agrosécuritaire » contribue à l’extension des silos impériaux. Les conséquences sont désastreuses pour l’environnement (déforestation, surconsommation d’eau, intrants chimiques, chaîne de transport…) mais la préservation des écosystèmes ou la transition écologique ne sont pas centrales dans les discours sur la finitude. Récemment, de nouvelles ambitions sont nées qui poussent certains Etats à engager des recherches scientifiques au-delà de leur ZEE, afin de mettre la main sur de potentielles ressources d’énergies fossiles et de terres rares.
Une lecture thématique
Dans l’introduction, Arnaud Orain dit avoir organisé son livre en 6 chapitres, regroupés en 3 thèmes. Les deux premiers chapitres sont consacrés à la mer, sa fermeture et sa militarisation ; les deux suivants sont consacrés à l’idéologie et aux instruments anti-concurrence ; les deux derniers sont consacrés à la conquête territoriale et souveraine des compagnies publiques et privées.
La fermeture et la militarisation des océans
Arnaud Orain démontre que le monde contemporain ne connaît pas la « liberté des mers », mais plutôt la « liberté de fermer les mers ». Dans le chapitre 1, il s’engage dans une relecture des traités d’Hugo Grotius, de William Welwood et de John Selden autour du concept souvent commenté mais mal compris de mare liberum. Dans le chapitre 2, il s’appuie sur des théories plus proches de notre époque, en particulier celles d’Alfred Mahan et de von Tirpitz.
Il faut reprendre le contexte : au début du XVIIe siècle, le monde européen qui s’empare des mers du globe est ancré dans un capitalisme de la finitude. Or, en période de finitude, aucune liberté, aucune concurrence, ne peut être tolérée. Grotius ne défend donc pas la « liberté des mers ». Dans son traité de 1609, il cherche à justifier l’attaque d’un navire de commerce portugais par un navire de la VOC alors que ce navire se situait près de la ligne du traité de Saragosse de 1529 (qui découpait le monde en deux sphères : espagnole et portugaise). Afin de justifier cette attaque, ce que propose Grotius, c’est en réalité une liberté de navigation, qui autorise de facto les attaques de navire et la guerre de course par des flottes ennemies dans des eaux marquées par la compétition entre plusieurs marines en présence (en particulier en Méditerranée et dans les mers d’Asie). Les océans sont des lieux de compétition commerciale armée, sans règles, puisqu’aucune institution internationale ne peut exercer de juridiction sur ces espaces libres. Les traités sur la « liberté des mers » éclairent sur le fait qu’il faut fermer les mers à beaucoup d’acteurs !
La fermeture des océans est un fait depuis le XVIe siècle. Les traités de Tordesillas et de Saragosse ont imposé un contrôle des Espagnols et des Portugais qui se traduit également par une double expulsion : celle des concurrents européens (Hollandais, Anglais et Français) et celle des populations qui n’avaient rien demandé et qui parcouraient les mers depuis longtemps (les marchands arabes, indiens, malais, chinois, indonésiens).
L’époque moderne a mis en place des « zones d’impérialité » : ce sont des espaces maritimes dont un État territorial se proclame maître et qui pose des conditions à son utilisation afin de défendre un monopole. Dans les Caraïbes, les Espagnols ont imposé le système de l’Asiento ; les Français ont créé le système de l’Exclusif. Dans l’océan Indien, les Portugais imposent aux marchands qui empruntent les carreiras l’achat d’un cartaz, une charte qui les autorise à naviguer. Quiconque parcourt l’océan en-dehors des autorisations est considéré comme contrebandier ou comme pirate.
Durant le Grand Siècle, en l’absence d’hegemon, les navires de commerce qui parcourent la Méditerranée sont tous armés de canons. La marine marchande est équipée pour se défendre elle-même, mais aussi pour se transformer en cas de besoin en auxiliaire de la marine royale. Les marins peuvent également servir sur des bâtiments de la Marine. Les Compagnies à charte de l’époque moderne ont renforcé cette pratique : la Compagnie des Indes Orientales et la Compagnie du Levant ont pourvus leurs navires d’une artillerie lourde, et les chantiers navals de Lorient fabriquent aussi bien des navires de commerce que des vaisseaux de ligne. La VOC a inventé au début du XVIIe siècle l’Indiaman, construit dans le chantier naval de Batavia : il s’agit d’un bâtiment de transport pensé pour optimiser sa cargaison transocéanique, mais capable aussi de transporter plusieurs dizaines de canons. Ces navires sont utilisés et copiés par les autres puissances navales européennes jusqu’au début du XIXe siècle.
Au XVIIIe siècle, seule la Grande-Bretagne est parvenue à devenir une puissance maritime mondiale. La France a échoué dans cette voie après les difficultés économiques de la fin du règne de Louis XIV, facilitant la domination britannique de la Guerre de Sept Ans à la guerre d’Indépendance.
A la fin du XIXe siècle, dans une autre période de capitalisme de la finitude, la pratique des monopoles est restaurée par le Royaume-Uni dans le delta du Niger, par la France au large de l’Indochine récemment conquise, ou bien par les Allemands dans les îles du Pacifique. Vers 1900, les Allemands (par la violence et l’intimidation) ont acheté des ports, ont limité les zones de pêche pour privatiser les stocks halieutiques, ont mis en place entrepôts et des transits obligatoires ainsi que des monopoles de la navigation commerciale qui la réservent à des sociétés de Hambourg. La flotte allemande du IIe Reich se renforce et l’Allemagne se dote d’une puissante marine de guerre parce que ce pays neuf devient une grande puissance industrielle qui étend ses relations commerciales à l’échelle de la planète et développe un empire colonial en Afrique et dans le Pacifique, dans un monde qui se referme. La flotte militaire se doit de protéger les importations et les exportations allemandes. Du côté français, les vaisseaux de la Compagnie des Messageries maritimes (une compagnie fondée en 1851 et spécialisée dans le transport de courrier et de touristes) proposent, à partir de la IIIe République, un service de transport des troupes coloniales et de l’équipement militaire au large du Tonkin. En 1895, plusieurs paquebots des Messageries participent à la conquête de Madagascar. L’interopérabilité civil/militaire atteint son apogée pendant la Grande Guerre au nom de l’Union Sacrée.
Arnaud Orain compare ces situations historiques à celle du capitalisme de la finitude actuel, et y voit les mêmes rouages. Une différence cependant : ce ne sont plus tant les Etats que les entreprises mondialisées qui dépendent le plus de la navigation. La décomposition des processus productifs, la mise en place de chaînes de valeur mondialisées et fragmentées entre les lieux d’approvisionnement, de production et de consommation, impose une contrainte externe que les FTN doivent s’efforcer de gérer. Ce sont les grandes firmes (comme les anciennes compagnies à charte de l’époque moderne) qui veulent aujourd’hui gérer, surveiller et contrôler les routes maritimes : il s’agit de protéger leurs flux d’approvisionnement, et éventuellement de bloquer les flux de leurs rivaux. Là encore, l’exemple de la Chine est explicite : sécurisation des routes d’approvisionnement en hydrocarbures (« Nouvelles Routes de la Soie »), blocage des circuits étrangers d’exportation des semi-conducteurs, signature du RCEP en novembre 2020, accords avec les Houtis en janvier 2024 pour accorder un passage sécurisé aux navires à pavillon chinois empruntant la mer Rouge, alors que les autres navires empruntent désormais le Cap de Bonne-Espérance…
La Chine contemporaine a parfaitement compris cette étanchéité entre les marines. Le parti communiste s’appuie sur des firmes nationales pour renforcer sa puissance à la fois maritime (commerciale) et navale (militaire). La compagnie COSCO, 4e transporteur maritime mondial et opérateur de plusieurs ports à travers la planète, devient une nouvelle Compagnie du XXIe siècle, et ses porte-conteneurs deviennent les nouveaux Indiamen. Fondée en 1961, COSCO se transforme en bras armé de la Marine chinoise depuis 2019. Plusieurs navires de COSCO sont aménagés pour déplacer des troupes, du matériel militaire, des hélicoptères, et même des missiles. Certains navires embarquent des troupes de sécurité privée, composées d’anciens militaires chinois, dans des opérations de protection contre la piraterie. Le plus redoutable est que depuis 2021, il est avéré que des missiles de croisière de longue portée sont tirés depuis certains porte-conteneurs de COSCO. Les missiles sont transportés camouflés dans de faux conteneurs, ce qui brouille encore la frontière entre navire commercial et militaire. Les Etats-Unis empruntent la même voie, bien que leur flotte commerciale soit beaucoup plus réduite (il n’y a plus de grande compagnie maritime américaine), et l’auteur cite également le cas de la Russie, d’Israël et de l’Iran. Tout semble donc prêt pour le retour d’une guerre de course et d’une confusion des rôles (armée régulière, garde-côtes, milices de pêche armées, transporteurs maritimes capables de lancer des missiles). La Chine est actuellement la seule puissance à la fois maritime ET navale (alors que les USA, ancien hegemon, ne sont qu’une puissance navale).
Le développement d’une idéologie anti-concurrentielle
La notion de libre concurrence liée au capitalisme est très récente. Arnaud Orain la date du milieu du XIXe siècle et nomme son principal défenseur : Richard Cobden, à une période où la Grande-Bretagne défend une politique libre-échangiste dans un « monde » libéral qu’elle domine lagement (Pax Britannica 1815-1880). Cobden est l’artisan de l’abolition des monopoles britanniques (fin des Corn Laws, 1844) qui restreignaient le commerce de la « nation de marchands ». Selon lui, le libéralisme économique, le libre-échange et la libre-concurrence ont enrichi les Britanniques et permis l’accélération de l’industrie.
Dans la période précédente (la finitude), les théoriciens comme Montchrestien ou Jean-Baptiste de Lagny (un proche de Colbert) ou Josiah Child annoncent que le rôle des marchands n’est ni de s’enrichir ni de fournir aux populations des biens à bas prix, mais de soutenir l’affirmation (parfois agressive) de l’État (en lui fournissant les ressources dont il a besoin). Les intérêts individuels, le confort et le bien-être s’effacent devant cet objectif. C’est l’argument à l’origine de l’association des marchands privés au sein des Compagnies à charte. En retour, l’État soutiendra la conservation de la richesse nationale qui, en profitant à l’État, profitera à tous.
Arnaud Orain prend plusieurs exemples, mais celui de la VOC hollandaise est le plus éloquent (chapitre 3). Elle illustre l’organisation horizontale de la Compagnie et ses relations avec le gouvernement politique des Pays-Bas. Fondée en 1602, elle a le monopole du commerce avec l’océan Indien et l’Asie. Elle s’empare de l’empire portugais dans la violence et le sang, avec des soldats autochtones, allant même jusqu’à planifier un génocide dans les îles Banda en 1621, afin de remplacer la population par des captifs originaires d’Asie du Sud-Est. Il s’agit d’une société esclavagiste dont le succès repose sur le travail servile. Elle a mené des raids en Afrique et en Asie, a organisé la déportation de dizaines de milliers de personnes pour travailler dans les plantations de canne à sucre, de muscadiers et de girofliers. Elle gère également l’intégralité de la filière (de la production à la transformation et au transport) depuis ses entrepôts géants de Batavia et ses navires gigantesques et surarmés : les Indiamen. La fortune de la VOC, et donc des Provinces-Unies, ne repose absolument pas sur une économie de marché, mais sur l’exploitation, le travail forcé, les impôts injustes et la coercition. Elle gère elle-même les colonies qu’elle domine, devenant un Etat dans l’Etat (soumis cependant au gouvernement hollandais dont elle représente les intérêts outre-mer).
A la fin du XIXe siècle, le libéralisme de l’abondance de Cobden est à nouveau dénoncé par les impérialistes protectionnistes comme l’Ecossais William Cunningham ou l’Allemand Gustav Schmoller. On l’accuse d’avoir permis la sortie des richesses du Royaume-Uni, au profit de ses ennemis. En termes plus contemporains, à cause du libre-échange, la balance commerciale n’est pas en faveur du Royaume-Uni, ce qui créerait une « concurrence déloyale » obligeant à décider de « tarifs » aux importations. Le culte de l’abondance bon marché renvoie, à une époque plus proche de la nôtre, à l’afflux des productions chinoises peu élaborées et de médiocre qualité. D’un point de vue global, la critique anti-Cobden rappelle les discours d’autosuffisance, d’indépendance énergétique et de souveraineté industrielle de la Chine et de l’UE, mais aussi les discours de de sécurité nationale de l’administration Biden après le confinement de 2020 et face aux menaces chinoises contre Taïwan (et en particulier TSMC, l’entreprise qui produit les semi-conducteurs), ou ceux, plus belliqueux, du candidat Donald Trump vis-à-vis de la concurrence chinoise, européenne, canadienne, ainsi que de la protection qu’offre l’OMC aux « ennemis » des Etats-Unis.
Arnaud Orain synthétise cette pensée : « C’est comme si chaque phase de mondialisation libérale se terminait de la même manière : par la redécouverte du possible jeu à somme nulle du commerce extérieur par les intellectuels et les politiques. Ce que notre XXIe siècle a de particulier, c’est que ce sont parfois les mêmes acteurs qui ont défendu la position libre-échangiste des gains à l’échange qui finissent par en douter [y compris Paul Krugman!] ».
L’auteur décrit des formes de souverainisme sur le capital, d’hégémonie du centre et de vassalisation des périphéries, autour d’une image : celle du « silo impérial » (chapitre 4). Le silo est un réservoir de ressources au sein d’un système d’organisation de type impérial (à domination directe ou indirecte) dans lequel un Etat dominant peut se servir chaque fois qu’il en a besoin. La construction de ces silos est assurée par les accords bilatéraux (inégaux), la violence, la coercition, l’intimidation, la menace militaire, la guerre commerciale. Plusieurs exemples de silos sont étudiés : l’Exclusif colonial à l’époque moderne, le « Pacte colonial » à la fin du XIXe siècle, le Commonwealth britannique depuis 1932, les Associations régionales aujourd’hui. Ces systèmes construisent des « amitiés », des « colonies » et des « dépendances de type centre-périphéries » (nous pourrions parler de « systèmes-monde ») qui cherchent à supprimer tout principe concurrentiel.
Ces silos sont particulièrement illustrés par les compagnies à monopole, le commerce triangulaire et les ports sélectionnés pour devenir les uniques portes d’entrée des navires sur un territoire (Séville, Lisbonne, Nantes, Vera Cruz, Cap vert, Goa, Manille, Canton…). Il faut ajouter les Navigation Acts anglais (1651, 1660 – abrogées seulement en 1849), le Staple Act de 1663, le Tarif Méline (1892), l’Import Duties Act britannique et les Accords d’Ottawa de 1932, après le krach de Wall Street… Au début du XXe siècle, les entreprises occidentales ou occidentalisées se concentrent en amitiés et forment des trusts ou des cartels (États-Unis), des conglomérats (France), des konzerns (Allemagne) ou des zaibatsus (Japon). L’ensemble de ces mesures montre la solidité d’un système impérial (de type Greater Britain) contre le libre-échange. Elles se sont effondrées avec les Accords du GATT de 1944, mais reviennent en force depuis les années 1990 : création de l’UE, de l’ALENA, du MERCOSUR, du COMESA, de l’APEC, de l’Organisation de coopération de Shanghai, du RCEP. L’OMC, censé protéger les accords de libre-échange, échoue à présent dans sa tâche (tout comme les réunions du G7, du G20 et des COP) et les négociations internationales se transforment en accords régionaux. Les États-Unis de Trump ont fait évoluer l’ALENA vers l’ACEUM et veulent à présent renégocier les tarifs douaniers avec le Canada et le Mexique. La Chine développe une géoéconomie impérialiste avec la Belt and Road Initiative. En Europe, les agriculteurs et les citoyens rejettent en bloc les accords de libre-échange avec le Canada et avec l’Amérique latine. Quelques pays souhaitent sortir des accords bancaires (le système SWIFT) dominés par le dollar pour utiliser des crypto-monnaies… Le multilatéralisme, lié au capitalisme néo-libéral, est généralement abandonné au profit d’accords bilatéraux dominés par un État prédateur (États-Unis, Chine, Inde, Russie). Les nouvelles relations internationales prennent la forme d’une « vassalisation » (Arnaud Orain parle lui de « friendshoring ») de l’Amérique du Nord aux États-Unis, de l’Asie centrale à la Russie, de l’Afrique à la Chine.
La souveraineté des entreprises privées et leur influence sur la gouvernance politique mondiale
La logique spatiale du système des entrepôts est en place depuis les Grandes découvertes du XVIe siècle. Le commerce colonial et la traite négrière ont conduit les Ibériques à créer de grands sites de rassemblement et de tri des esclaves (Cap Vert, Sao Tomé, Hispaniola, Porto Rico…). Rapidement, ces sites deviennent les premiers « hubs » du commerce maritime mondial. Les exemples sont nombreux : au XVIe siècle, tous les navires en partance ou en provenance du Nouveau Monde doivent être autorisés et enregistrés par la Casa de Contratacion de Séville, qui est la seule porte d’entrée des richesses américaines sur le Vieux Continent. Batavia en Indonésie et Amsterdam aux Provinces-Unies dessinent une toile connectée entre les différentes parties du monde néerlandais. En Angleterre, le Staple Act (1663) annonce que tous les produits commercés à l’intérieur de l’Empire britannique doivent non seulement emprunter des bateaux et des équipages britanniques, mais aussi passer par Londres, où les marchandises sont débarquées, pesées, paient les douanes, puis réempaquetées et réexpédiées.
Cette « logique d’entonnoir » renforce la position dominante des élites capitalistes et des marchands des compagnies par rapport aux planteurs esclavagistes, aux armateurs, aux négociants indépendants ou aux manufacturiers.
A la fin du XIXe siècle, la situation est un peu différente : les grandes entreprises internationales possèdent moins de comptoirs et ne s’organisent plus autour de hubs et de spokes. La logique spatiale a évolué car il faut désormais se rapprocher des sources d’énergie fossile et des bassins de main d’œuvre. Le transport reste cependant important. Mais aux Etats-Unis, la fin du XIXe siècle (le « Gilded Age ») voit l’apparition des « grossistes » dans des villes-entrepôts qui sont aussi des villes-terminaux ferroviaires : Chicago, Cincinnati, Buffalo, Saint-Louis. Ces sociétés gèrent l’ensemble des filières de la production. Elles sont souvent comparées à des pieuvres aux bras tentaculaires (cette image n’est donc pas réservée à la Standard Oil Company de Rockfeller, qui ne fait qu’en imiter les principes). JP Morgan est le premier de ces capitalistes commerçants et maîtres des flux logistiques. Morgan possédait plus de 8000km de voies ferrées en 1902, mais aussi la Compagnie de marine marchande internationale, qui possède à la fois la majeure partie de la flotte transatlantique américaine mais aussi anglaise et hollandaise. Il est à lui seul le principal agent de la disparition du système d’entrepôts au sein de l’empire britannique.
Dans le cas français, Marseille et Saïgon, reliés par le canal de Suez à partir de 1869, s’organisent comme deux villes-entrepôts ultra-modernes à cette époque. Marseille incarne le capitalisme d’entrepôt, à la fois maîtresse de la réception et de l’expédition des marchandises et en tant que portail vers les autres mondes exploités. Saïgon est bâtie en miroir de Marseille, à l’autre bout de la planète et de l’empire français en Indochine.
A propos des compagnies privées, Arnaud Orain développe dans le chapitre 5 le cas de l’East India Company et son influence dans l’Inde moghole à partir de 1690. L’EIC agit en tant que délégation du pouvoir moghol (collecte d’impôts, levée de l’armée des Cipayes, gestion de domaines fonciers, conseil politique) et s’empare peu à peu du Raj de l’intérieur. Dans la période suivante, les compagnies à charte sont de retour après une phase libérale, et elles retrouvent leur rôle d’« agences souveraines de colonisation ». L’auteur développe à plusieurs reprises l’exemple de la Compagnie royale du Niger (fondée par la reine Victoria en 1884), mais aussi la British South Africa Chartered Company (1889-1924) dominée par le millionnaire Cecil Rhodes qui gère en administration directe en Rhodésie (Afrique du Sud). Les Allemands fondent quant à eux la Compagnie de Nouvelle-Guinée (1884-1899). Du côté français, le général Gallieni tente (mais échoue) de donner des droits souverains à la Compagnie de Suberbie dans l’Ouest de Madagascar après la conquête de l’île en 1895. Dans tous les cas, ces compagnies ont mis en place un « despotisme privé », impérialiste, colonialiste et fondé sur une économie de prédation et une économie de rente qui assure leur solidité et leur durabilité.
Pour Arnaud Orain, toutes les compagnies créées dans des phases de capitalisme de la finitude one développé et renforcé le système de la « plantation » et l’exploitation humaine par le travail forcé, le travail sous contrat, le travail sous contrainte ou le travail obligatoire par nécessité contre faible salaire. Ce système a conduit à une première « primarisation » des colonies outre-mer à l’époque moderne, puisque les domaines colonisés sont en réalité des périphéries dominées qui ont été spécialisés afin de fournir des matières premières aux manufactures des métropoles : une dépendance sans concurrence économique, caractéristique de l’économie de la finitude.
L’économie de plantation est une caractéristique importante du système capitaliste qui ne s’est jamais mieux portée qu’en contexte de finitude. Au tournant du XIXe et du XXe siècle, la plantation refleurit sur des bases réinventées (l’esclavage ayant été aboli au cours du XIXe siècle et la période connaissance une deuxième phase de l’impérialisme colonial).
Arnaud Orain prend deux exemples un peu inattendus.
Le premier est l’Indonésie hollandaise. A partir de 1870-1880, l’Etat y encourage l’implantation de sociétés agricoles à Sumatra, qui mettent en faillite les petits planteurs individuels. L’économie sucrière est alors remplacée par de vastes plantations capitalistes de palmier à huile et d’hévéa (une plante importée du Brésil) et travaillées par des travailleurs sous contrat (indentured labourers) ou coolies javanais, chinois et indiens.
Le deuxième exemple concerne les Caraïbes colonisées par les Etats-Unis. Les Etats-Unis s’emparent de Porto-Rico en 1898, s’implantent à Cuba la même année, occupent la République dominicaine de 1916 à 1924 et Haïti de 1915 à 1934. Les vastes capitaux agroalimentaires et les trusts créés pendant le Gilded Age se saisissent de cette opportunité et intègrent les îles dans le silo impérial américain (surnommé le « royaume du sucre »). Ils construisent les chemins de fer, électrifient les campagnes, bâtissent des raffineries modernes, rassemblent d’immenses terres qu’ils remembrent. La production totale de Porto Rico, Cuba et Dominique est multipliée par 10 entre 1900 et 1919 ! Dans les deux cas, cette ingérence étrangère a joué dans la trajectoire du sous-développement régional, au profit de la dynamisation d’un centre dominateur.
Depuis 2010, cette forme économique revient en force et se généralise. L’Indonésie et la Malaisie produisent 85% de l’huile de palme consommée dans le monde. En Indonésie, entre 2010 et 2015, de nouvelles plantations sont créées par des FTN (de l’agroalimentaire ou des biocarburants) rasant des villages, déforestant massivement les forêts primaires et fonctionnant grâce à des migrants venus des autres îles indonésiennes, particulièrement des femmes jeunes. La production d’huile de palme a progressé de 7 millions de tonnes en 2000 à 32 millions en 2016 et 47 millions en 2023 !
Le modèle de plantation se diffuse actuellement dans d’autres pays comme le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Nouvelle-Guinée, qui louent des millions d’hectares de terre à des FTN agroalimentaires. Le Honduras a vu sa production d’huile de palme augmenter de 560% entre 2001 et 2017 ! Au Brésil, la superficie consacrée au soja a augmenté de 326% entre 2000 et 2017. Ce sont souvent de grands conglomérats, souvent étrangers, qui possèdent et contrôlent de vastes exploitations, qui ruinent sans effort les petits et moyens propriétaires nationaux.
L’accaparement des terres mis en place par des firmes concentrées dans des logiques non-concurrentielles conduit bien sûr à une remise en cause du discours de la « mondialisation heureuse ». Ces pratiques de silo produisent une nouvelle « primarisation », à une « périphérisation » et à un nouvel « développement du sous-développement » pour des pays dominés et qui vendent leurs intérêts à des entreprises plus puissantes en offrant tout ce qu’elles peuvent proposer : une servitude des populations et une spécialisation dans l’extraction et la fourniture de ressources primaires peu chères.
Arnaud Orain voit deux raisons à ce phénomène. Le premier est la concurrence des produits chinois depuis l’entrée de la Chine à l’OMC en 2001. Le marché mondial est désormais inondé de produits déjà peu chers, ce qui a ruiné les débuts d’industrialisation (textile, sidérurgique) dans d’autres pays en développement (Brésil, Colombie, Uruguay, Argentine et Afrique du Sud). La Chine négocie en plus ses investissements directs dans les produits de base : les entreprises chinoises s’installent et offrent des prêts en échange de prix concurrentiels sur les matières premières, ce qui favorise l’essor des activités d’extraction. Il s’agit d’un hard power qui condamne les pays à demeurer des fournisseurs de matières premières à long terme. La deuxième raison pour Arnaud Orain est la « ruée minière » vers des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon), des métaux comme le cuivre, le nickel, l’uranium, des terres rares comme le lithium, le cobalt, le manganèse, le platine. Outre la croissance de la demande en énergie, les métaux sont nécessaires à la production d’éoliennes, aux batteries électriques, aux câbles de fibre optique, aux satellites, à l’industrie d’armement… Les principales régions d’extraction dans lesquelles des firmes étrangères sont parvenues à imposer un quasi-contrôle sont des pays en développement ou des pays les moins avancés : Congo, Colombie, Argentine, Kazakhstan, Mexique, Mali, Tchad, Niger, et bientôt les fonds marins. Cela éclaire enfin sur l’appétit de Donald Trump pour le Groenland…
En conclusion
Dans les périodes de capitalisme de la finitude, les compagnies se passent des mécanismes du marché et transforment le vivant en marchandises dans un environnement monopolistique qui conforte leur domination. Leur puissance repose à la fois sur des actifs qu’elles sont les seules à maîtriser, sur la force, sur des prérogatives souveraines. Contrairement aux périodes libérales, elles sont davantage dans une logique d’exploitation et de rente que dans une logique d’entreprise, d’innovation et de profit. Ce sont des « compagnies de colonisation ». L’accaparement des terres et des mers, la destruction des forêts, les déplacements de population, le travail forcé, les freins aux prix libres et à la concurrence, sont des moteurs de la coercition dans un monde fini et limité.
Depuis 15 ans, l’économie de rente est de retour, tout comme les mesures de protection douanière, les silos impériaux, les mouvements de concentration des capitaux, la cartellisation des entreprises par fusion-acquisition. C’est cette réalité que le livre nous amène à réaliser de façon concrète dans une expression limpide et grâce à une argumentation convaincante. Comme l’écrit Arnaud Orain, « plus elles colonisent d’espaces (le fond des mers, l’atmosphère, le cyber), plus elles s’accaparent des droits souverains, régaliens ou fonctionnels, et plus elles sont en mesure non pas de faire du profit dans un environnement concurrentiel, mais au contraire de capturer des « sujets » en situation de monopole […]. Leur intérêt est de devenir des souverains dans un « espace » précis, puis de faire payer aux « sujets » qui empruntent ou vivent dans ces espaces des « taxes » contraignantes (impôts au sens strict, travail forcé, prix ou abonnements imposés, publicité obligatoire, etc). Ces taxes constituent leur rente de monopole. Plus on envisage le monde comme « fini », plus des firmes vont chercher à conquérir de nouveaux « espaces » et à s’y trouver en situation de monopole. Elles auront tendance à devenir des compagnies-Etats qui y exerceront leur souveraineté ».
Quelques critiques cependant : la première est qu’Arnaud Orain ne parle jamais de « système-monde » (Immanuel Wallerstein) alors qu’il en décrit parfaitement le fonctionnement. De plus, il reste très eurocentré dans son discours et ne s’est intéressé qu’à une définition « occidentale » du capitalisme. Or, les chercheurs anglo-saxons depuis Andre Gunder Frank ou japonais depuis Takeshi Hamashita ont bien mis en évidence l’existence d’un capitalisme asiatique. Enfin, loin de l’Occident mercantile ou libéral, la Chine a étendu un système tributaire dans toute la mer de Chine et dans l’Océan Indien depuis la dynastie des Han. Il s’agit d’une autre forme d’encadrement du marché économique, qui associe une vision de la finitude à une vassalisation de l’Asie face au puissant empire « chinois ». Arnaud Orain ouvre ainsi une nouvelle porte d’analyse : le concept de « monde confisqué » pourrait être utilement testé dans un contexte autre que celui de l’Occident dans les deux premières périodes chronologiques qu’il identifie comme des périodes de « finitude ».