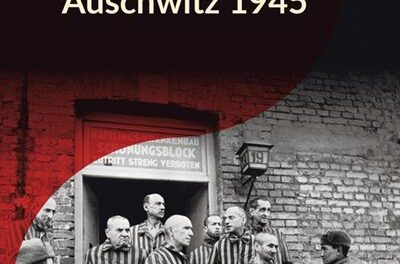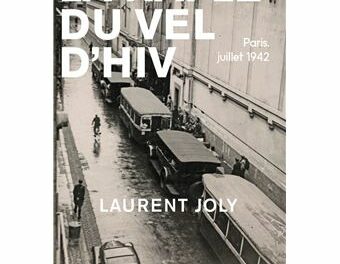Cet ouvrage est tout entier consacré à démontrer que l’oubli du génocide des Juifs au lendemain de la guerre est une « légende », un « mythe » ; que l’on n’a pas attendu 35 ans, pour en parler, en France ; que l’opinion publique, en France, a été très tôt instruite et sensibilisée au drame du génocide, par des études, des films, des récits, des témoignages. Cette thèse prend donc le contre-pied de celle jusqu’ici admise, et enseignée dans les classes de terminale littéraire dans le cadre du chapitre sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, fondée en grande partie sur les travaux d’Annette Wiewiorka, exposés dans son livre Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli (Plon, 1992), thèse qui affirme que la spécificité du sort des Juifs n’a pas été reconnue par la mémoire collective pendant plusieurs décennies.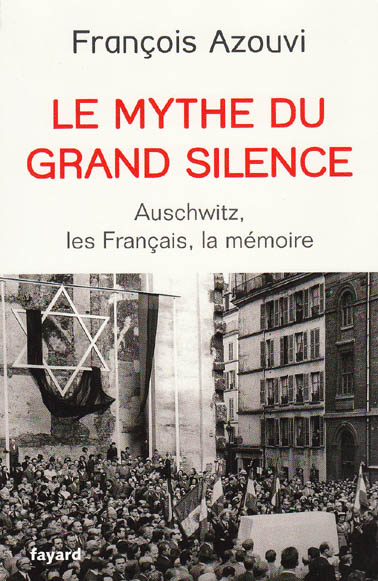
François Azouvi entend prouver que la spécificité du génocide des Juifs n’a jamais été absente de la mémoire française et retracer l’histoire de la pénétration du génocide dans la conscience française. Sa thèse est la suivante : le génocide a d’abord été pensé par les intellectuels, catholiques et protestants plus particulièrement, dès la fin des années 1940. Puis, dans les années 1950, les romans, les récits et les films l’ont enraciné dans l’opinion. Enfin, à partir du tournant des années 1960 et 1970, quand la mémoire du génocide croise celle de Vichy, commence le processus de reconnaissance par l’État. Le procès Eichmann en 1961 et la guerre de Six-Jours en 1967 n’auraient pas joué le rôle qu’on leur attribue habituellement dans le réveil de la mémoire. Par contre la pièce de Rolf Hochhuth, Le Vicaire aurait eu un immense impact. S’il y a bien eu en France un « syndrome de Vichy » l’auteur affirme qu’il n’y a pas eu de « syndrome de la Shoah » : si les Français ont occulté Vichy, ils n’ont pas occulté l’extermination des Juifs.
Directeur honoraire de recherche au CNRS et directeur honoraire d’études à l’EHESS, François Azouvi, est l’auteur d’un ouvrage sur Descartes et d’un autre sur Bergson. Le Mythe du grand silence est un livre très dense, 400 pages de texte suivies d’un millier de notes et d’un index. Même si des centaines de références sont données dans les notes, une bibliographie aurait été la bienvenue, ainsi qu’un index des œuvres citées (romans, films, essais, articles etc.). Il analyse de manière sans doute presque exhaustive le vaste domaine de la production culturelle française sur le génocide (article de revues et ouvrages philosophiques et littéraires, romans, pièces de théâtre, films etc.).
L’ouvrage se compose de trois parties : le génocide dans la culture française (1944-1961), le génocide dans l’espace public (du Vicaire en 1963 à la guerre des Six-Jours en 1967), le génocide dans la sphère de l’État (de la grâce de Touvier en 1972 au procès Barbie en 1986). Estimant avoir démontré qu’à la fin des années 1980 le processus de reconnaissance et de mémorisation du génocide, en France, est parvenu à son terme, l’auteur n’aborde que brièvement, dans l’épilogue, les vingt dernières années.
Le génocide dans la culture française (1944-1961)
Les intellectuels pensent le génocide
Le sort spécifique des Juifs est abordé par la presse française, juive et non juive, dès 1944. Les écrivains catholiques se montrent particulièrement précoces et attentifs « à la radicale nouveauté du crime contre les Juifs ». Immédiatement donc, la spécificité du génocide n’est « ni passée sous silence, ni noyée dans la série indifférenciée des crimes nazis ». Immédiatement aussi, les intellectuels « se sont employés à penser l’extermination des Juifs avec les catégories dont ils disposaient ».
Les intellectuels chrétiens réagissent avec force et rapidité à l’extermination des Juifs : Mauriac, Mounier, Maritain, Frossard, Claudel, et d’autres moins connus, on parlé très tôt et très fort, ce qui conduit l’auteur à faire la remarque suivante : « S’il y a quelque chose d’occulté dans l’histoire que je retrace, ce n’est pas le génocide, c’est la pensée du génocide par les chrétiens ». Les intellectuels chrétiens ont en effet compris immédiatement la spécificité du génocide, et témoigné de leur désir de racheter ce qui leur apparaissait comme leur propre faute. Jules Isaac, ami de Péguy, dreyfusard, pacifiste, auteur avec Albert Malet des manuels d’histoire qui portent leurs deux noms, réagit avec force en 1946 à la publication d’un ouvrage de Daniel Rops, Jésus en son temps. Il entend montrer que l’antijudaïsme chrétien a formé une tradition dont l’aboutissement a été la chambre à gaz. Avec d’autres chrétiens, dont l’historien Henri Irénée Marrou, et Jacques Maritain, il participe à la constitution du groupe de L’Amitié judéo-chrétienne qui travaille à montrer l’inanité des thèses qui sont au fondement de l’antijudaïsme chrétien. Jules Isaac rencontrera le pape Jean XXIII en 1960, et cette rencontre sera décisive, dans la mesure où le concile Vatican II marquera une rupture avec l’antijudaïsme.
Un très fort mouvement de sympathie se manifeste en France en 1947-1948 en faveur des Juifs, à l’occasion de l’affaire de l’Exodus. La grande presse soutient inconditionnellement les insurgés, et l’idée est très généralement défendue, y compris sous la plume d’un Sartre ou d’un Camus, qu’il s’agit en 1947 d’empêcher que ne se reproduise 1942, et que donner aux survivants des camps une terre est un acte de justice.
L’auteur souligne la précocité de l’historiographie du génocide même si ce ne sont pas les historiens de métier qui s’y intéressent les premiers. Léon Poliakov commence effectivement ses travaux au Centre de documentation juive contemporaine, et publie en 1951 Le Bréviaire de la haine. Le Troisième Reich et les Juifs. L’ouvrage est précédé d’une préface de François Mauriac qui souligne la singularité du génocide, son caractère bureaucratique, la responsabilité de Vichy, le silence du pape, le fait qu’Auschwitz a produit dans l’histoire une coupure irrémédiable. Henri Monneray, procureur au procès de Nuremberg, rassemble de nombreux documents parmi ceux présentés à Nuremberg, et publie en 1947 La Persécution des Juifs en France dans les autres pays de l’Ouest, livre préfacé par René Cassin et introduit par Edgar Faure. Edgar Faure forge alors une expression qui sera reprise plus tard par l’historien du génocide Raul Hilberg : l’Allemagne a inventé, dit-il, « le fonctionnaire assassin ».
L’enseignement de la Seconde Guerre mondiale n’entre dans les programmes du lycée qu’à la fin des années 1950 et dans ceux du collège en 1969. Mais l’enseignement primaire est paradoxalement en avance sur l’enseignement secondaire et, dès 1948, il est fait référence aux persécutions contre les Juifs et à leur spécificité, « cette génération dont on dit qu’elle a grandi sans rien savoir de ce qui était advenu des Juifs en aura été informée, sinon au biberon, du moins dans son enfance. »
Le 27 février 1949 est inaugurée à Paris à la synagogue de la Victoire, un monument à toutes les victimes juives de la guerre. La cérémonie a lieu en présence de nombreuses personnalités des mondes politique, culturel et religieux, dont le Président de la République. Le Grand Rabbin Kaplan affirme que « c’est en tant que Juifs que, dans la presque totalité des cas, ils ont été déportés. ».
Le génocide mis en film et en roman
Dans les années 1950 la pénétration du génocide dans la conscience publique française se fait par la diffusion d’une importante création littéraire et cinématographique. En 1950 paraît Le journal d’Anne Frank, trois ans après sa publication initiale en néerlandais. Porté à la scène en 1957 et au cinéma en 1959, il connaît un succès immense et mondial et « fait pénétrer le drame juif dans un public où, jusque-là, il n’était pas allé ». Deux ans plus tard, paraissent chez Gallimard deux ouvrages eux aussi promis à de gros tirages : La Mort est mon métier de Robert Merle qui, à la première personne du singulier, fait parler le commandant d’Auschwitz et La Muraille de John Hersey qui raconte, lui aussi à la première personne, la destruction du ghetto de Varsovie et qui fut salué par une immense réussite. En 1953, 1955 et 1956, trois prix Goncourt vont à des écrivains dont l’oeuvre évoque, « centralement, de façon périphérique ou métaphorique » le génocide : Le Temps des morts de Pierre Gascar, Les Eaux mêlées de Roger Ikor et Les Racines du ciel de Romain Gary. En 1959, paraît Le Dernier des justes d’André Schwarz-Bart.
En 1948 quatre films au succès très inégal évoquent plus ou moins l’extermination des Juifs ; le plus important étant La Dernière étape de Wanda Jakubowska. Le film se déroule au camp de femmes de Birkenau, tourné sur place par d’anciens déportés, il s’impose par son authenticité. En 1952, c’est la sortie française du film tchèque d’Alfred Radok, Ghetto Terezin.
« Oui, décidément, quelque chose change au milieu des années 1950. Le génocide acquiert une visibilité, une évidence, qui dépasse maintenant le cercle restreint des élites et des Juifs. On le mesure très simplement à l’avalanche des recensions qui accompagnent la sortie parisienne au théâtre Montparnasse, en septembre 1957, de la pièce tirée du Journal d’Anne Frank et la réédition à cette occasion du livre lui-même (…) Pour la première fois le génocide des Juifs atteint la presse populaire de grande diffusion (…) Et la télévision consacre le 5 juin 1959 un dossier de Cinq colonnes à la Une à Anne Frank ». L’immense vague médiatique suscitée par le cas d’Anne Frank, vient alors cumuler ses effets avec plusieurs autres oeuvres, romans et films dont deux au moins rencontrent un immense public : Le Dernier des justes qui ouvre le débat sur la « passivité » des Juifs et Exodus de Léon Uris, porté au cinéma par Otto Premminger en 1961. L’auteur peut donc conclure que « au moment même où se déroule à Jérusalem le procès Eichmann, en France l’opinion est largement instruite sur ce que les nazis ont fait aux Juifs et qui est appelé « « solution finale » ».
« Le grand virage des années 1970, salué par tous les historiens comme la levée du tabou, est en réalité la conclusion d’une période pendant laquelle romans et films ont fait entrer dans les foyers de ceux qui lisent et vont au cinéma, la conscience qu’entre 1942 et 1945 quelque chose de particulier est décidément arrivé aux Juifs. »
Le génocide dans l’espace public (Du « Vicaire » à la Guerre des Six-Jours)
L’auteur admet que les historiens sont unanimes pour dater du procès Eichmann un second temps de la mémoire juive du génocide, le moment où celui-ci se constitue comme un événement distinct dans l’espace public, en France comme en Israël, en Allemagne ou aux États-Unis. Il entend démontrer dans un premier chapitre de cette seconde partie que ce n’est pas vrai pour la France.
Le rôle secondaire du procès Eichmann
François Azouvi affirme que le génocide n’entre pas dans l’espace public français en 1961, avec le procès Eichmann, mais en 1963-1964 avec l’affaire mondiale du Vicaire de Rolf Hochhuth. « Après le cercle de l’opinion, où il a fait son chemin dans les années 1940 et 1950, le génocide pénètre dans le cercle de l’espace public avec sa dimension constitutive de controverses et de polémiques ». Si le procès Eichmann n’a pas en France le rôle qu’on lui attribue généralement, c’est par ce qu’il « se joue d’emblée dans un registre non polémique, consensuel, qui empêche son inscription dans l’espace public ou la règle est justement la conflictualité. » Il réveille des mémoires engourdies mais ne suscite aucune passion publique et n’enclenche pas la dynamique de l’État : François Azouvi en veut pour preuve, le fait que le général de Gaulle, fidèle à sa ligne de rapprochement avec l’Allemagne fédérale, fasse libérer, en décembre 1962, Karl Oberg, chef de la SS et de la police pour la France, chargé de la lutte contre la Résistance et responsable de la « question juive », ainsi que son assistant, Helmut Knochen, chef de la police de sûreté du service de sécurité.
Le scandale du « Vicaire »
Le contraste est vif avec le scandale déclenché par la pièce de Rolf Hochhuth, Le Vicaire. Elle est jouée pour la première fois en février 1963, à Berlin, et en décembre, à Paris, dans une mise en scène de Georges Semprun, qui vient de remporter le prix Formentor pour son Grand Voyage. Plus de 3000 articles sont publiés dans le monde en à peine deux ans à propos de cette pièce, qui traite de la responsabilité du pape Pie XII dans la non-dénonciation du génocide. Les journaux juifs français sont, dans l’ensemble, plutôt favorables à la pièce. Les journaux de gauche, ainsi que ceux représentant les anciens déportés sont unanimement favorables. La polémique précipite dans l’arène des personnages publics qui prennent la défense du pape ; « adversaires et partisans de l’avant-dernier pape s’affrontent avec une violence inouïe au sein du monde chrétien » écrit Léon Poliakov en octobre 1963. C’est pour cette raison affirme François Azouvi que 1963 « doit être retenu comme la date à laquelle le génocide des Juifs entre dans l’espace public, celui des Juifs comme des non Juifs ». À partir de 1963 le génocide des Juifs acquiert avec « Auschwitz » une « désignation métonymique ».
La guerre des Six-Jours
L’auteur pense avoir démontré que dès les années 1960-1965 les deux conditions pour que la guerre des Six-Jours fasse l’événement dans l’opinion française étaient déjà réunies : de la part des Juifs, « une conscience de judéité ou de judaïcité, proclamée et revendiquée », et de la part des non Juifs, un savoir largement partagé concernant le génocide. Dans ces conditions, il est aisé de comprendre que Juifs et non Juifs aient instantanément mobilisé tous les répertoires métaphoriques du génocide et de la Seconde Guerre mondiale quand Israël s’est trouvé menacé par ses voisins arabes. La guerre des Six-Jours n’ouvre donc pas une nouvelle période dans la conscience du génocide, elle est plutôt un point d’aboutissement, la marque et la preuve du « considérable travail d’appropriation du génocide effectué en France depuis vingt ans ». Un immense mouvement de solidarité envers Israël se manifeste donc en mai et juin 1967. À partir de 1967, les Juifs de France décident de parler en tant que Français et Juifs.
Le génocide dans la sphère de l’État
De la grâce de Touvier à l’extradition de Barbie
Le 5 juin 1972, L’ Express révèle que le président Pompidou a gracié six mois plus tôt l’ancien milicien Paul Touvier, condamné à mort par contumace en 1946 et 1947. Une tornade médiatique se lève. Personne n’accepte ce qui apparaît comme une insupportable démission : l’impunité de ceux qui ont participé aux crimes de guerre n’est plus admissible. Dans l’intervalle, une demande d’extradition à l’encontre de l’ancien chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a été adressée au gouvernement bolivien. « La dynamique judiciaire, c’est-à-dire politique, est en route ; la mémoire des crimes nazis change radicalement de régime (…) À un moment donné, la conscience du génocide des Juifs, installée progressivement dans la sphère de la culture puis dans l’espace public, embraye sur une action politique. » L’auteur date ce tournant du début des actions, en Allemagne, de Simon Wiesenthal et de Beate Klarsfeld, dont il rappelle l’essentiel. Il le met aussi en relation avec la critique du totalitarisme qui en est la toile de fond. L’installation dans l’opinion française d’un consensus antitotalitaire (parution en 1974 du premier tome de L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne et en 1977 de La Barbarie à visage humain de Bernard Henri Lévy) semble, selon l’auteur, « déterminante dans le processus d’entrée du génocide dans la sphère de l’État ». Il montre également, en recensant avec précision plusieurs émissions qui concernent ce sujet (en particulier Les Dossiers de l’écran), que la télévision française accompagne le mouvement.
L’interprétation psychanalytique
François Azouvi accorde une importance essentielle à la publication par Bruno Bettelheim de son ouvrage Le Coeur conscient, en 1972. C’est alors que les concepts de refoulement, d’angoisse et de déni investissent la mémoire du génocide et permettent de penser les événements. L’ouvrage de Bettelheim donne « une nouvelle interprétation d’une histoire à laquelle il manquait sa grille de lecture ». « Pour ces hommes et ces femmes qui ont autour de 40 ans dans les années 1970, l’interprétation de l’histoire en termes psychanalytiques est formidablement éclairante. Elle rend compte du délai qui leur a été nécessaire pour passer à la parole et donne aux films, romans et récits qui restituent la période « occultée » la valeur cathartique d’un retour du refoulé. »
L’auteur traite ensuite avec précision de l’affaire Darquier de Pellepoix, des dépôts de plaintes contre Jean Leguay et René Bousquet, de la diffusion par Antenne 2 du feuilleton américain Holocauste, de l’extradition et du procès de Klaus Barbie, de l’essor du négationnisme (affaires Roques et Faurisson, loi Gayssot). Il accorde une large place à la réception du film Shoah de Claude Lanzmann : « Tout se passe comme si, grâce au film de Lanzmann, le génocide des Juifs acquérait enfin la dimension de sacralité qui était son horizon depuis longtemps. Avec Shoah, quelque chose commence assurément : un nouveau régime de l’événement, doté maintenant d’un nom propre choisi parce qu’il ne dit rien à personne parce qu’il respecte, nous dit Lanzmann, le caractère insondable, incompréhensible, d’un événement qu’il serait « obscène » de vouloir comprendre. »
« Dans le même temps où l’on se met à parler de la Shoah d’une façon mystique, l’on commence à jeter sur les décennies antérieures un regard nouveau, entièrement dépendant sans doute de cette perception elle-même nouvelle de l’événement. C’est là que s’impose la thèse qui prévaut encore si largement : celle d’un immense silence commandé par un refoulement général qui n’aurait cédé que dans les années 1970 ou 1980 (…) En 1992, la publication du livre d’Annette Wiewiorka, Déportation et génocide apporta à la thèse du grand silence l’irremplaçable caution de l’historienne. Sa conclusion est nette : pas de conscience du génocide de la part des Juifs au lendemain de la guerre en raison de l’absence d’une identité, début d’un changement, en France comme ailleurs, avec le procès Eichmann. La thèse emporte immédiatement l’adhésion (…) L’interprétation par le refoulement originel a eu d’autant plus de force de conviction qu’elle a conflué en France avec la thèse, vite classique, du « syndrome de Vichy » proposé par Henri Rousso à la fin des années 1980. »
Il n’est pas aisé de rendre compte d’un ouvrage aussi dense, sauf à se contenter d’en donner le thème. Le rédacteur de ce compte rendu en est douloureusement conscient ! Il s’est efforcé de citer les passages essentiels de l’ argumentation de l’auteur, mais il est bien loin d’avoir traduit toute la richesse d’un contenu qui devrait rendre de grands services aux professeurs d’histoire. La thèse défendue par François Azouvi donnera sans doute lieu, sinon à des polémiques, du moins à des débats scientifiques dont nous nous efforcerons de rendre compte en leur temps.