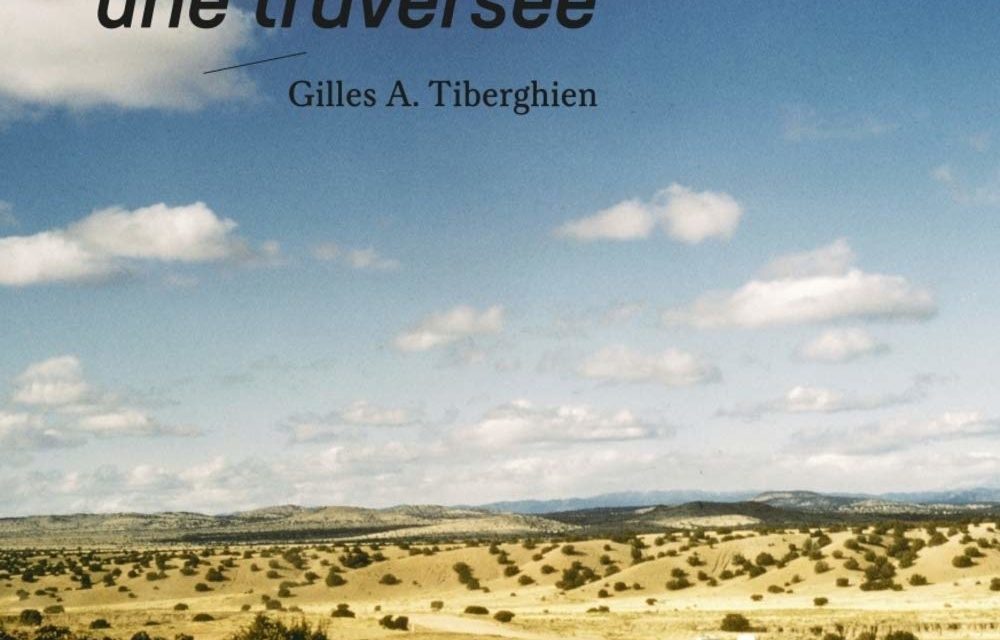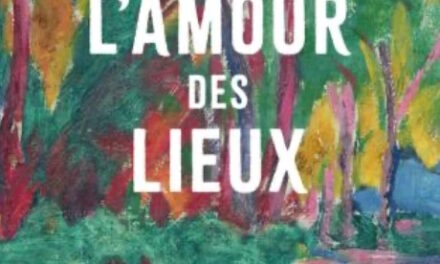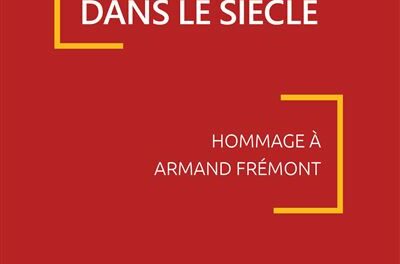Gilles A. Tiberghien est philosophe, maître de conférences à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne. Il y enseigne l’esthétique. Depuis 1998, il co-dirige avec Jean-Marc Besse la revue Les Carnets du paysage. Gilles Tiberghien travaille à la croisée de l’histoire de l’art et de l’esthétique. Ce nouvel ouvrage s’attaque à la question de la compréhension du paysage en dépassant l’idée d’un spectacle inerte ou d’un simple « objet » mais bien davantage comme un milieu dynamique que l’observateur est invité à traverser et avec lequel il est mis en relation.
« La plus statique des images de paysage invite-t-elle celui qui l’observe à une mobilité sans fin », affirme Tiberghien (p.5). Le paysage nous mobilise, nous engage à le parcourir parce que nous l’avons toujours déjà parcouru. On pourrait dire cela autrement en citant Merleau-Ponty : « Tous mes déplacements par principe figurent dans un coin, sont reportés sur la carte du visible. Tout ce que je vois par principe est à ma portée, au moins à la portée de mon regard, relevé sur la carte du je peux » (Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, 1985). Ainsi, Tiberghien affirme que le paysage est une traversée : il ne s’arrête jamais nulle part, il est sans limites et sans frontières. En l’encadrant, on le domine, on s’en fait un tableau. La traversée est tout le contraire d’une appropriation. Nous ne possédons par le paysage, nous le partageons.
L’ouvrage est conçu en quatre temps, comme quatre étapes dans un parcours à travers les paysages. D’abord, Tiberghien s’intéresse aux chemins, aux traversées. Ensuite, il aborde la question de l’hypothétique fin du trajet : le bout du monde. Puis, la troisième partie tente de de démêler l’étrange lien qui unit les hommes aux paysages, d’analyser les cosmogonies qui expliqueraient ce lien. Enfin, la dernière partie montre que l’expression de ce lien avec la nature est à chercher dans le paysage et l’art. Chacune des parties est séparée du reste par une page noire d’intertitre qui donne l’impression d’un fondu enchaîné dans ce voyage en paysages. L’ouvrage regorge d’illustration de qualité qui viennent soutenir le propos de l’auteur et en font une sorte de livre d’art, objet précieux consacré à toutes les sortes de paysages.
Le chemin : l’approche hodologique
William Wordsworth, poète anglais du XIXe siècle est l’un des premiers à avoir fait de la marche un mode d’« être au monde » (Heidegger). Le géographe américain J.B. Jackson qui s’intéressa à la fabrique de territoire par les modes de vie et les manières de se déplacer, fait de la marche et des chemins un point fondamental de la géographie vernaculaire. Il écrit, en 1984, « je vais introduire un nouveau mot savant dans le lexique du paysage : c’est l’hodologie. Il provient du grec hodos, qui signifie route ou voyage. L’hodologie est donc la science ou l’étude des routes ». En fait, le concept vient du psychologue Kurt Lewin qui, dans les années 1950, l’avait utilisé pour décrire la structure de l’espace vécu.
Ainsi l’hodologie s’intéresse aux routes mais également à ceux qui les empruntent. Ils y sont liés dans la mesure où plusieurs individus participent à la fabrique de ce chemin. La route, et les termes qui lui sont apparentés (street, via rupta, strada…) sont du côté de la construction et de la surface parcourue. Le chemin (way, hodos…) est davantage du côté du mouvement et du processus. L’auteur voit dans la mythologie un argument à sa théorie du chemin en opposant Hermès, dieu du chemin et de la route, à Hestia, déesse du foyer, gage de permanence et d’immobilité. L’historien Jean-Pierre Vernant remarque à ce propos : « On peut dire que le couple Hermès-Hestia, exprime dans sa polarité, la tension qui se marque dans la représentation archaïque de l’espace : l’espace exige un centre, un point fixe, à valeur privilégiée, à partir duquel on puisse orienter et définir des directions, toutes différentes qualitativement ; mais l’espace se présente en même temps comme lieu du mouvement, ce qui implique une possibilité de transition et de passage de n’importe quel point à un autre » (Vernant, 1965). Dans l’Être et le Néant (1943), Sartre exprime cette idée que l’espace est hodologique et qu’il se déploie autour de nous par nos actions : « Le monde se dévoile comme indication d’actes à faire […]. Il est sillonné de chemins et de routes, il est instrumental et il est le site des outils ». L’espace hodologique est fait de « chemins familiers », parcourus de lieux tactiles et visuels. En cela, la théorie de Tiberghien se rapproche de la psychogéographie de Guy Debord. La dérive est un chemin particulier qui permet de connaître un autre visage des villes.
Tiberghien rattache ce courant philosophique et géographique de l’espace hodologique à des pratiques artistiques et à des manières d’envisager l’espace par des artistes. L’exemple de Stalker, une « association culturelle », sorte de laboratoire artistique lancé en 1996 dans la banlieue de Rome. L’objectif de Stalker est de révéler l’espace en le « pratiquant » à travers un certain nombre d’actions dont la marche et diverses installations. Anna et Lawrence Halprin s’intéressent également à la mobilité et plus particulièrement à la chorégraphie. Dans les années 1960, Halprin invente un système de notation du mouvement dans l’espace, la « motation », qu’il destine à l’étude de l’environnement mais aussi à la chorégraphie. Halprin en vient à transcrire de véritables partitions urbaines qui donnent une autre image des itinéraires dans la ville.
Les bouts du monde
Nos chemins, tracés dans le monde, sont limités par la surface terrestre. L’auteur rappelle l’étymologie phénicienne du terme « océan », a-cayana qui veut dire « ce qui encercle ». L’oikouménè signifie plus largement « monde familier », « monde connu ». Cet oikouménè est limité par les océans et les déserts (érémoi). Ces confins, dans toutes les mythologies, sont peuplés par des créatures extraordinaires telles les hemikune, les cynocéphales, les otoliknoi ou les sciapodes. Pour Hérodote, les limites de la Terre sont définies comme vides (érémoi) et indéterminées (apeiroi). Pour Kant, les limites « supposent toujours un espace qui se trouve en dehors d’un lieu déterminé et l’enferme ».
Les cartes, dans lesquelles les blancs ont souvent laissé la place à l’imaginaire, ont beaucoup à voir avec l’art pour Tiberghien. Le géographe britannique John Brian Harley écrivait que toutes les cartes étaient rhétoriques (Le pouvoir des cartes, 1995). L’identification des lieux est affaire à la fois de désignation (lac) et de nomenclature (supérieur). L’auteur évoque alors les artistes qui ont fait de la carte un support et un matériau de premier choix pour évoquer le mouvement. Il en va de même pour les photographes et des photographies aériennes. Représenter le monde, le nommer, noter les trajets est un des objectifs de leurs travaux.
L’ouvrage de Gilles Tiberghien est un ouvrage passionnant qui nous emmène sur des réflexions itinérantes à propos de l’espace, des mobilités et de l’existence. Les paysages en sont donc les manifestations visuelles. Ils traduisent une manière de voir et d’appréhender le monde par celui qui les observe. Ce livre, proche du livre d’art, traduit une grande connaissance de l’art, des sciences de l’espace et des pensées qui s’y rattachent.