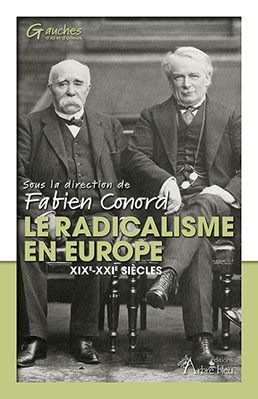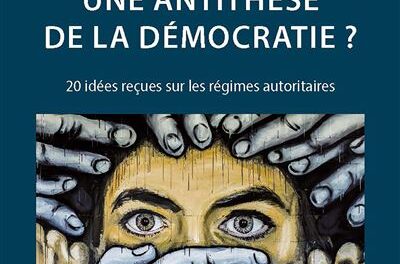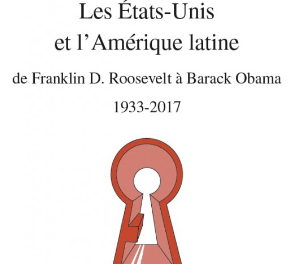L’ouvrage Le radicalisme en Europe (XIXe-XXIe siècles), publié sous la direction de Fabien Conord, avec les contributions de ce dernier ainsi que de Julien Bouchet, Jean-Etienne Dubois, Virgile Cirefice et Jérôme Henning, constitue l’une des dernières parutions de l’Arbre bleu Éditions, dans la collection « Gauches d’ici et d’ailleurs » dirigée par Gilles Candar, en mars 2022.
Fabien ConordFabien Conord (42 ans), agrégé d’histoire, est professeur d’histoire contemporaine à l’université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand II. Il a notamment publié Les gauches européennes au XXe siècle (Paris, Armand Colin, 2012), Le tour de France à l’heure nationale, 1930-1968 (Paris, Puf, 2014), et Les socialistes et les élections sénatoriales (1875-2015) (Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2015). Il a également dirigé l’ouvrage L’Europe de 1948 à 1945 (Paris, Ellipses, 2014). Il travaille actuellement sur le rapport entre gauches et nations, du XIXe siècle à nos jours., Julien BouchetJulien Bouchet (38 ans), professeur agrégé et docteur en histoire, enseigne au lycée Montdory de Thiers et à l’Université Clermont Auvergne (département d’histoire et INSPE). Auteur d’une thèse sur le combisme qui a été remarquée (prix de thèse du Sénat et prix Jeune Chercheur) puis publiée (La République irréductible, Atlande, 2018), Julien Bouchet a valorisé ses conclusions à l’occasion du centenaire Émile Combes qui s’est tenu, durant le printemps 2021, au Sénat puis à Pons (Charente-Maritime), sa terre d’élection. Il a co-animé la Jeune Équipe durant ses années doctorales, puis participé aux travaux de l’axe I du CHEC. En parallèle, il a participé à plusieurs programmes ANR, et co-organisé des journées d’études et colloques. Spécialiste d’histoire politique, en particulier celle des idées et du parlementarisme, Julien Bouchet a ouvert ses voies de recherche après la soutenance de sa thèse, notamment en direction de l’histoire sociale de la Seconde Guerre mondiale, avec des travaux toujours en cours sur les Justes parmi les Nations (Les justes d’Auvergne (uca.fr)). Professeur-relais de l’Académie de Clermont auprès du Mémorial de la Shoah-Centre culturel Jules Isaac, correspondant pédagogique du Mémorial de la Shoah, il a une attention spéciale en direction de la didactique et de la valorisation de ses recherches, à plusieurs échelles (Réseau Mémorha, Fondation pour la mémoire de la Shoah)., Jean-Etienne DuboisJean-Etienne Dubois (40 ans), agrégé et docteur en histoire, enseigne au lycée de la Plaine de l’Ain (Ambérieu-en-Bugey) et chargé de cours à l’IEP de Lyon. Lauréat du Prix de thèses de l’Institut Universitaire Varenne – édition 2015, catégorie : « Philosophie politique et histoire des idées et de la République »., Virgile CireficeVirgile Cirefice (33 ans), agrégé (2013) et docteur en histoire, est enseignant et membre de l’Ecole française de Rome (Section Époques moderne et contemporaine), située dans la capitale italienne, depuis 2019. Auteur d’une thèse intitulée Cultures et imaginaires politiques socialistes en France et en Italie, 1944-1949, sous la co-direction de Marie-Anne Matard-Bonucci et Patrizia Dogliani, Université Paris 8 & Université de Bologne, soutenue en 2018. et Jérôme Henning : cinq enseignants-chercheurs membres du CHPP
Cet ouvrage n’est pas la première collaboration entre Fabien Conord et Jean-Etienne Dubois car ils ont rédigé un manuel d’histoire intitulé Histoire du monde de 1870 à nos jours, en 2017, chez l’éditeur Armand Colin, en compagnie de 3 autres confrères (Mathias Bernard professeur d’université d’histoire contemporaine à Clermont-Ferrand, Pascal Gibert professeur agrégé en CPGE et enseignant au lycée Madame-de-Staël à Montluçon ainsi que Jacques Brasseul professeur d’université émérite en sciences économies).
Le radicalisme est l’une des principales forces politiques de l’histoire contemporaine de la France et de la Suisse. Il a également joué un rôle important au Royaume-Uni et, de manière plus discontinue, dans d’autres pays : Danemark, Espagne, Italie notamment. Souvent assimilé au cas français, généralement saisi – y compris par la littérature – à son apogée durant la première moitié du XIXe siècle, il est souvent réduit dans les représentations collectives à quelques images parfois caricaturales comme celle du radical « bouffeur de curés ou penchant du côté de « l’assiette au beurre ». En fait, son histoire est autrement plus riche et complexe, aussi bien par ses évolutions chronologiques que par sa diversité géographique. C’est pourquoi les 6 auteurs réunis dans ce livre présentent le radicalisme dans sa triple ampleur temporelle, spatiale et culturelle. Ils en proposent la première étude synthétique à l’échelle européenne, sur l’ensemble de la période contemporaine, dans une démarche attentive aux acteurs, aux idéaux et aux pratiques.
Pour proposer une synthèse du radicalisme en Europe, Fabien Conord et les 5 autres co-auteurs ont retenu un découpage en 4 grandes phases chronologiques constituées de 3 chapitres chacun et rédigées par un seul auteur : Le radicalisme combattant (des origines aux années 1890 – chapitre 1, 2 et 3) par Fabien Conord ; le radicalisme triomphant (des années 1890 à 1914 – chapitre 4, 5 et 6) par Julien Bouchet ; le radicalisme hésitant (1914-1945 – chapitre 7, 8 et 9) par Jean-Etienne Dubois et, enfin, le radicalisme survivant (de 1945 à nos jours – chapitre 10, 11 et 12) par Virgile Cirefice sans oublier les contributions de Jérôme Henning pour les chapitres 7 (p. 124-130), 9 (p. 156-160) et 10 (p. 166-169) sur « Les incertitudes institutionnelles ». L’ouvrage est composé, outre une introduction générale signée de Fabien Conord (p. 9-20), de la répartition suivante : 8 pour la partie I (p. 21-66), 9 pour la partie II (p. 67-110), 9 pour la partie III (p. 111-160), 10 pour la partie IV (p. 161-210). Puis, suivent une conclusion rédigée par Fabien Conord (p. 211-214) ainsi qu’un index des noms cités (p. 215-222) et une table des encadrés (p. 223-224) puis, enfin, une table des matières (p. 225-229).
Le radicalisme combattant (des origines aux années 1890)
La première partie, intitulée « Le radicalisme combattant (des origines aux années 1890) » (p. 21-66), est rédigée par Fabien Conord.
Le chapitre 1 « L’univers idéologique du radicalisme » (p. 23-42) énonce les trois dimensions de cette idéologie républicaine : la revendication, d’une démocratie politique la plus complète possible, les préoccupations sociales et le rapport complexe à la religion. Le radicalisme apparaît premièrement, dans tous les pays où il se déploie, comme la force revendiquant avec le plus de vigueur l’avènement de la démocratie politique (p. 24-29). Celle-ci repose sur le suffrage universel masculin mais aussi sur la question du régime (radicaux anglais et espagnols acceptant la monarchie) sans oublier le concept de « vraie République » des radicaux français comme étant une alternative à la démocratie libérale (France et Suisse). Les doctrines économiques et sociales, une importance seconde ? (p. 29-35), Dans les années 1860 jusqu’aux années 1880, les questions économiques et sociales ne sont pas centrales dans le combat radical. Les radicaux européens ne peuvent pas néanmoins faire abstraction du contexte économique et social dans un siècle qui connaît de véritables bouleversements et où la misère continue à sévir dans de multiples pays. Quelques traits communs se dégagent aisément comme l’humanitaire et le néo-malthusianisme, la justice sociale et le rôle de la puissance publique et, enfin, l’association des termes radicaux et socialistes. Les débats démographiques occupent une large place en Europe au XIXe siècle et de nombreux radicaux y prennent part en promouvant un néo-malthusianisme. Cette sensibilité rejoint d’une certaine manière une autre source intellectuelle du radicalisme, l’utilitarisme, en estimant que l’homme a le droit de rechercher son bonheur et le contrôle des naissances est un moyen de lutter contre la misère. Les radicaux manifestent également une vive sensibilité humanitariste, qui nourrit plusieurs revendications économiques et sociales. C’est le cas de l’interdiction du travail des enfants de moins de quatorze ans. C’est aussi au nom de sentiments humanitaires qu’une forme d’anti-colonialisme s’exprime au sein du radicalisme français des années 1880. Durant cette période, les radicaux européens ont pu se sentir proches des socialistes européens mais la défense de la propriété privée, héritage de la Révolution française, par les radicaux européens contre le collectivisme socialiste européen fut une ligne de fracture irréconciliable. Radicalisme et religion (p. 35-42), soit l’anticléricalisme des radicaux européens est une coloration indéniable de cette famille politique mais elle est très inégale, selon les confessions religieuses, les pays d’Europe et les périodes historiques. En effet, la matrice protestante est présente non seulement en Grande-Bretagne mais aussi en Suisse, voire en France. L’anticléricalisme prononcé des radicaux européens est dû au développement du radicalisme dans une Europe latine majoritairement catholique le plaçant en contact et en confrontation avec une confession fortement structurée, dont la hiérarchisation s’accentue au XIXe siècle, avec le développement de l’ultramontanisme, que symbolise en 1870 la proclamation de l’infaillibilité pontificale en matière de dogme. Dans ce schéma plus conflictuel entre religion et modernité, les radicaux européens prennent toute leur part dans le combat anticlérical. Dès lors, les radicaux européens deviennent des acteurs de la sécularisation avec la séparation des Eglises et de l’Etat, lors du dernier tiers du XIXe siècle (Italie, France, Suisse).
Le chapitre 2 « Des modes d’actions évolutifs » (p. 43-56). La violence apparaît en effet encore assez régulièrement comme un mode de résolution des conflits, que la politique comme médiation à travers ses institutions ne supplante que très progressivement au cours d’un XIXe siècle scandé par de nombreuses révolutions. Cette tension entre violence et pratiques plus civiles traverse le radicalisme, surtout lorsqu’ il est confronté à la résistance mais aussi à la répression des pouvoirs qu’il combat. Recenser les pratiques politiques des radicaux européens au XIXe siècle conduit à illustrer la variété de leur répertoire d’action, même s’il est néanmoins possible d’observer une tendance à la pacification. Par exemple, faire la révolution (p. 43-48) a été compris de manière très différente par les radicaux français et suisses. Les radicaux français ont été acteurs des révolutions du XIXe siècle (1830, 1849, 1860 et 1871) en se référant constamment à la Révolution française de 1789 devenant incontournable. Quant aux radicaux suisses, ils passent de l’agitation armée à la domination radicale. De plus, convaincre (p. 48-52) est essentiel pour les radicaux européens tant par les manifestations, les pétitions (pour le suffrage universel masculin au Royaume-Uni et en France). Cependant, la presse est le vecteur essentiel des idées radicales (comme L’Intransigeant en France, Suisse, Belgique, Royaume-Uni). Enfin, s’organiser (p. 52-56) : les pratiques militantes radicales sont tributaires du régime politique et de l’appareil juridique en vigueur. C’est ainsi que pour échapper aux interdictions de réunion, les radicaux européens subvertissent banquets ou enterrements. Les évolutions politiques du XIXe siècle permettent néanmoins le développement de formes plus institutionnalisées telles que des embryons partisans (sociétés, comités en Royaume-Uni, Associations belges ou suisses, comités politiques français) ou des associations sœurs telles que le cercle en France (Maurice Agulhon), les sociétés de Libre Pensée en Royaume-Uni et en France ainsi que les loges franc-maçonniques en Royaume-Uni, France, Suisse. En France, les radicaux dominent le GODF jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, le radicalisme demeure encore profondément marqué par des pratiques militantes variées qui associent dimensions spirituelles et sociales. C’est à l’époque suivante qu’il revient de le structurer, d’ailleurs partiellement, avec la naissance des partis modernes.
Le chapitre 3 « Des profils sociaux variés » (p. 57-66) : le radicalisme se nourrit de l’évolution démocratique du XIXe siècle qu’il anime largement. Il serait pourtant simpliste de l’assimiler sans nuances aux catégories populaires. En effet, il présente une sociologie hétérogène. À l’échelle européenne, l’appréhension du personnel radical local est malaisée, faute d’études en nombre suffisant. Sa sociologie semble assez mêlée. Cependant, des années 1840 aux années 1880, les bastions électoraux du radicalisme en Europe sont plutôt urbains et populaires comme l’illustre la géographie électorale avec une composition d’Ouvriers, artisans et « bourgeois du peuple » (p. 58-63). Comme le résume l’historien-militant Jean-Thomas Nordmann dans son ouvrage Histoire des radicaux, en forçant le trait, « le radicalisme de boulevard fait place au radicalisme de terroir » (p. 108), après l’épisode boulangiste, c’est-à-dire en passant des villes aux campagnes (p. 63-66). La majeure partie de la population européenne étant rurale au XIXe siècle, les radicaux, partisans du suffrage universel masculin, sont nécessairement confrontés à la question de leur implantation dans les campagnes, encore largement agricoles. Bref, vers la fin du XIXe siècle, le radicalisme a investi – même inégalement – les campagnes dans tous les pays européens où il s’est implanté.
Le radicalisme triomphant (des années 1890 à 1914)
Dans le chapitre 4 « Les radicalismes européens de la fin du XIXe siècle » (p. 69-92), malgré une dynamique continentale centrifuge et une mosaïque européenne, la géographie différenciée (p. 70-73) de l’Europe radicale fait émerger trois modèles structurés et dominants (p. 73-80) (qui sont le radicalisme libéral en Grande-Bretagne, le radicalisme républicain en France et un radicalisme suisse plus conservateur) qui sont parfois mobilisés par d’autres dynamiques radicales plus segmentées (p. 80-86) telles que des radicalismes de foisonnement en Méditerranée, des radicalismes intégrés mais à plus faible rayonnement en Scandinavie et, enfin, des radicalismes minoritaires et mixtes dans le reste de l’Europe. L’Europe des années 1890-1914 est donc bien mue par une dizaine de présences radicales qui, si elles ne sont pas partout triomphantes, modèlent le devenir du libéralisme de progrès et du républicanisme, qu’il soit en situation d’exercice du pouvoir, de minorité ou d’opposition institutionnelle. Cette Europe radicale est plurielle, aucun projet pan-européen n’étant alors proposé pour rassembler et coordonner les différents cercles informels, groupes partisans, mouvements politiques, courants idéologiques, partis dûment constitués et fédérations, à l’exclusion de rassemblements anticléricaux. La mue radicale de la fin du XIXe siècle consiste au passage d’une radicalité souvent intransigeante en situation de lutte acharnée contre des puissants (les nobles, les élites de la terre mal partagée, le clergé, les militaires, les sénateurs) à une visibilité partisane plus participative au destin de nations inégalement pétries d’un patriotisme exacerbé à la veille de la guerre. Le radicalisme est bousculé par l’arrivée des socialistes puis des sociaux-démocrates, de même que par la restructuration du mouvement social qui ne craint pas de mettre en question la légitimité des partis dans la réalisation des réformes ouvrières et paysannes.
Dans le chapitre 5 (p. 87-100), les « pratiques de pouvoir » et les « pratiques de gouvernement » sont deux outils d’analyse utilisés par les historiens du politique et les politistes pour penser de manière pragmatique et interactive les différentes échelles de la praxis en général, et de la pratique politique en particulier. Ces différentes pratiques sont bien entendu à historiser et à comparer. Elles sont déterminées par des rapports de force qui se manifestent à plusieurs degrés. Elles sont configurées par le militantisme de court ou de plus long terme, par l’exercice de l’opposition dans la cité et/ou du pouvoir dans ses aréopages, mais aussi par des crises internes et externes aux groupes, mouvements et partis. Les pratiques modèlent enfin un environnement mental à l’origine de cultures politiques et, parfois, de nouvelles doctrines forgées sur le terrain. Afin de bien entendre la stratification politique de champs pluriels et complexes, trois échelles ont été choisies pour apprécier ces logiques : Une activité militante à l’échelle locale soit le radicalisme « d’en bas » (p. 88-92), la coalescence de dynamiques politiques à l’échelle partisane (p. 92-96), et enfin, le radicalisme légiférant et administrateur (p. 96-100), à l’échelle nationale (parlement et gouvernement).
Le chapitre 6 « Cultures radicales » (p. 101-109) porte spécifiquement sur les caractères du radicalisme européen « fin de siècle », ses déterminants et ses bornes identitaires. Le radicalisme politique est alors décliné en plusieurs modèles et dynamiques propres. L’identité radicale est fondée sur un héritage libéral l’exercice du pouvoir de plus en plus courant à plusieurs échelles, en particulier au sud du continent, et l’association d’un engagement anticlérical et réformiste social, ce qui renvoie aux origines protestataires du radicalisme au sein d’une Europe de tradition chrétienne transformée par l’industrialisation. La notion de culture politique est ici capitale pour apprécier les cultures radicales. En première approximation, une culture politique peut être définie comme un ensemble de normes, de valeurs, de connaissances voire de croyances qui configurent les comportements et les attitudes de l’engagement des militants d’une collectivité. Il y a cependant plusieurs faux-semblants qui forment autant de trompe-l’œil : certains « non-radicaux » se disent radicaux (tel le ministre Charles de Freycinet), tandis que des radicaux « authentiques », à l’instar, à gauche, de Georges Clemenceau à ses débuts ou bien, plus à droite, de Joseph Caillaux, sont en fait des républicains « indépendants », comme plusieurs dizaines de socialistes qui peinent, eux aussi, à rejoindre les rangs partidaires. L’hétérodoxie doctrinale et l’hétéropraxie politique sont ainsi constitutives d’une identité radicale toujours en constitution, ce qui se voit notamment au moment de la formalisation du Parti radical en France au début des années 1900 qui peine à construire son programme pendant plusieurs années. Plusieurs héritages historiques, idéologiques et doctrinaux (p. 102-104), entrent en confrontation avec les questions du moment (p. 104-106) (les questions sociales et le rapport aux luttes ouvrières et paysannes ainsi que l’environnement colonial et impérial) que les radicaux intègrent pour configurer un radicalisme modern style, à l’orée du déclin, au printemps 1914, soit au seuil de la Première Guerre mondiale (p. 106-109), qui n’est autre qu’une culture radicale de gouvernement ou une dérive conservatrice.
Ainsi, dans la deuxième partie « Le radicalisme triomphant (des années 1890 à 1914) » (p. 67-110) écrit par Julien Bouchet, le radicalisme européen, en l’espace d’une génération, s’est transformé sous l’effet de facteurs internes et externes à la galaxie de ses mouvements. La fin du me siècle a été tout d’abord contemporaine de la fixation de trois modèles (anglais, français et suisse) qui ne reposèrent pas toujours sur une organisation partidaire dûment singulière au sein du milieu libéral, ce qui constitue une permanence avec l’époque du radicalisme combattant. Ce temps a été de plus celui d’un foisonnement militant et organisationnel qui a recomposé l’intransigeance doctrinale passée pour fixer des bases proto-gouvernementales (Espagne, Portugal), ou pour maintenir une opposition porteuse en matière militante (Italie, Mittel Europa). Plusieurs radicalismes sont désormais concernés par l’exercice du pouvoir, à plusieurs échelles, ce qui participe à reconfigurer leur culture politique. Tandis que les inégalités foncières restent un enjeu traité par ces libéraux avancés et leurs contradicteurs ultra-conservateurs ou anarchistes (Andalousie et Italie du Sud), l’approfondissement industriel d’une partie du continent (Angleterre, Belgique et France), de même que l’expansion coloniale consolidée par l’impérialisme économique et culturel (Royaume-Uni, Empire allemand) sont à l’origine de nouvelles crises de la conscience radicale qui épouse en ces domaines son siècle, en exprimant de plus en plus un conservatisme. L’Europe des radicalismes n’a presque jamais été un terrain de concertation fédératrice entre les mouvements et les partis, ce qui est, également, un point commun avec l’époque du radicalisme combattant. Il n’y eut pas de désir de coordonner outre-mesure ces gauches, et les pratiques unionistes sont d’autant moins récurrentes que l’on passe de l’échelle locale à l’échelle transnationale. Cet élément distingue nettement les radicaux de leurs frères républicains anticléricaux, de leurs cousins socialistes et de leurs adversaires démocrates-chrétiens. 1914 est une année de maturité pour la majorité des radicaux européens qui dominent l’alliance parlementaire en France et gouvernent dans plusieurs États du Nord, notamment l’Angleterre. L’Europe de l’entrée en guerre est donc un continent dans lequel les radicaux, quand ils ne sont pas maîtres de l’heure, font battre le pouls du libéralisme républicain.
Le radicalisme hésitant (1914-1945)
La troisième partie, « Le radicalisme hésitant (1914-1945) » (p. 111-160), est de Jean-Etienne Dubois.
Dans le chapitre 7 « 1914-1929, le radicalisme entre guerre et reconstruction » (p. 113-130), le cataclysme de la Grande Guerre est le premier événement structurant de la période envisagée dans ce chapitre. Dans la plupart des pays où les radicaux exercent une influence politique non marginale, ils se rallient aux gouvernements d’union nationale qui se forment un peu partout, dans les pays en guerre comme dans ceux qui restent neutres (Le radicalisme pendant la Grande Guerre : des trajectoires diverses entre un radicalisme de guerre et un radicalisme pacifiste, minoritaire mais croissant / p. 113-118). Au sortir de la guerre, les radicaux européens connaissent un déclin électoral plus ou moins prononcé (le radicalisme en campagne : à « la recherche de l’âge d’or » électoral / p. 118-122). Selon les pays, ils parviennent, ou non (le radicalisme contrarié : Italie, Espagne et Royaume-Uni), à rebondir (le radicalisme confirmé ou renouvelé : Suisse et France), avant que la crise économique mondiale de 1929 et ses conséquences ne rebattent les cartes des enjeux politiques. (Le radicalisme au pouvoir : entre réformisme et pacifisme / p. 122-130), si les radicaux européens placent beaucoup d’espoirs dans la création de la Société des Nations et œuvrent à son renforcement quand ils sont au pouvoir (le radicalisme européen, promoteur du nouvel ordre international par Jérôme Henning, sur le plan intérieur, ils tentent d’orienter la reconstruction des sociétés et des économies bouleversées par la guerre dans une voie réformiste, sans grand succès cependant (une politique réformiste limitée ou contrariée : Suisse, Royaume-Uni et France).
Dans le chapitre 8 « 1929-1945, le radicalisme dans la tourmente » (p. 131-144), la crise financière qui débute aux États-Unis, en octobre 1929, en raison de son caractère mondial, place les pays européens face aux mêmes conséquences économiques et sociales, faites de faillites de banques et d’entreprises, de hausse du chômage et des déficits publics. La crise financière de 1929 ébranle les conceptions libérales traditionnelles auxquelles les radicaux sont historiquement attachés. La crise donne du poids aux efforts de rénovation doctrinale engagés au sein des partis souvent dès la fin des années 1920. Elle pousse les radicaux européens à un effort de rénovation doctrinale, notamment chez les jeunes générations (le radicalisme face à la crise : une rénovation inachevée / p. 131-134). Cet effort, plus ou moins abouti, n’empêche pas que, partout où ils restaient influents, les années 1930 marquent un déclin très net des radicaux, avant même les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale, à l’exception de la Suisse où cette érosion est moins forte. Au cours des années 1930, la montée des extrêmes politiques, professant des doctrines fascisantes à droite et marxisantes à gauche, finit de placer les partis radicaux des différents pays européens dans une position politique centrale. Des tensions vives les traversent pour les faire basculer soit vers la gauche, soit vers la droite. Ce jeu de balancier radical est sensible partout, y compris en Espagne où les radicaux sont au centre du jeu politique rouvert par l’instauration de la Seconde République, à partir de 1931. Le choix de l’antimarxisme est adopté par les radicaux de droite (le radicalisme, un centrisme hésitant face à la montée des extrêmes / p. 135-141). Quand la Seconde Guerre mondiale éclate (Le radicalisme européen emporté par la Seconde Guerre mondiale / p. 141-143), l’audience du radicalisme européen s’est resserrée sur deux pays principaux, la France et la Suisse. Au Royaume-Uni, les libéraux sont associés au gouvernement d’union nationale de Winston Churchill en 1940 mais ils jouent un rôle politique marginal, bien que deux économistes libéraux, Keynes et Beveridge, soient parmi les plus écoutés du pays et tracent les contours du Welfare State promis pour l’après-guerre. Les radicaux français et suisses connaissent un destin si diffèrent pendant ces sombres années qu’il convient de les étudier séparément (les radicaux français en guerre : entre impuissance, compromission et timide sursaut ; neutralité suisse et ouverture à gauche des radicaux suisses
Avec le chapitre 9 « Le radicalisme à l’heure des masses : une inadéquation croissante » (p. 145-160), l’entre-deux-guerres marque la fin de l’âge d’or du radicalisme, qui rentre en crise et décline dans tous les pays d’Europe occidentale où il était présent, à l’exception de la Suisse. Cette concomitance peut laisser penser que le radicalisme avait fait son temps, et que l’essentiel de son programme avait été accompli dès les années de la Belle Époque. Elle indique plus sûrement une inadéquation croissante entre l’organisation et le recrutement des partis radicaux et les populations européennes de l’entre-deux-guerres, inadéquation sociologique (p. 145-149), donc, mais également médiatique (p. 149-153)., qui se conjuguent et expliquent la dégradation de leur image dans l’opinion. Bien adapté aux sociétés encore très rurales de la fin du XIXe siècle, et à un électorat limité au Royaume-Uni, le recrutement des partis radicaux pâtit au contraire de l’urbanisation et de l’industrialisation croissante des sociétés européennes pendant et après la Grande Guerre, qui génèrent des antagonismes sociaux plus marqués (des partis vieillissants et un ancrage social rétréci). Les radicaux se trouvent également en porte-à-faux avec une des revendications sociales majeures de la période : l’intégration des femmes à la sphère politique perdant ainsi une occasion ratée. L’inadéquation sociologique grandissante entre le recrutement des partis radicaux et les modifications du corps social et électoral va de pair avec l’insuffisante adaptation de leurs formes de militantisme et de propagande politiques, encore ancrées dans les pratiques et les habitudes d’avant-guerre. Par ailleurs, les partis radicaux apparaissent de plus en plus, à l’occasion de plusieurs affaires de corruption révélées par la presse, comme le parti des scandales. Le déclin du radicalisme dans l’entre-deux-guerres est donc aussi un problème d’image et de relais médiatique. Un dernier fil peut être intégré à l’écheveau des causes du déclin radical en Europe dans l’entre-deux-guerres : son incapacité à figurer comme une force politique d’avenir (Le radicalisme : un réformisme en crise ? / p. 154-160). Malgré leurs efforts de rénovation doctrinale, les radicaux semblent, au fil des ans, de plus en plus à contretemps de leur époque. Ils apparaissent comme une force politique du passé, ayant accompli l’essentiel de son programme avant-guerre, et incapable de porter les réformes profondes, notamment institutionnelles (Jérôme Henning), que les crises multiformes que traversent les sociétés européennes semblent imposer à beaucoup d’autres acteurs politiques.
Le radicalisme survivant (De 1945 à nos jours)
La quatrième partie, intitulée « Le radicalisme survivant (De 1945 à nos jours) » (p. 161-210), est rédigée par Virgile Cirefice.
Avec le chapitre 10 « Le radicalisme, une renaissance inégale » (p. 163-180), au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le radicalisme européen apparaît en grave crise. Seuls les radicaux suisses semblent encore en mesure d’influer sur les destinées de leur nation alors que de nombreux pays voient la tradition radicale s’éteindre ou être réduite à quantité négligeable. Même en France, où le radicalisme avait constitué l’une des forces les plus importantes de la IIIe République, le poids du parti semble diminué. Outre ses difficultés électorales lors des premières consultations de l’après-guerre, c’est surtout l’image du parti, associée aux compromissions de la IIIe République finissante, qui pâtit de la volonté de renouvellement qui traverse la société. De même, en juin 1945, un sondage montre que seuls 12 % des Français estiment que le Parti radical a un avenir. Pourtant, alors que le radicalisme français semble au bord de la disparition, les radicaux tirent peu à peu parti de la situation internationale et de ses répercussions sur la vie politique française, repartant de leur implantation locale mais réussissant également à attirer à eux de jeunes dirigeants issus de la Résistance, jusqu’à reconquérir des positions de pouvoir sous la IVe République alors même que le parti apparaissait en 1945-1946 comme l’un de ses plus farouches opposants. Le radicalisme français de l’après-guerre se caractérise par sa diversité qui se traduit pendant toute la IVe République par de farouches luttes internes se soldant par de régulières scissions. Dès 1946, le parti clarifie sa ligne en excluant l’aile gauche, favorable à une entente avec le Parti communiste. Ces partisans du Front populaire, tels Pierre Cot, Jacques Kayser ou Madeleine Jean-Zay rejoignent pour la plupart l’Union progressiste, proche du PCF. À l’inverse, certains radicaux font le choix du Rassemblement pour la France et du gaullisme à partir du moment où la double appartenance radicale et gaulliste n’est plus autorisée. Celle-ci avait surtout concerné des figures locales quoique les cas de Jacques Chaban-Delmas et Michel Debré fassent exception (Sauver le radicalisme au sortir de la guerre / p. 164-165). Durant l’occupation, malgré l’inaction du Parti radical face à Pétain, nombre de ses membres avaient préparé l’après-guerre, l’après-humiliation, l’après-parlementarisme. Pour plusieurs courants radicaux de la Résistance, la réflexion sur les institutions s’inscrit dans l’esprit de révolte. Analysant les causes de la débâcle de 1940 et, surtout, la dissolution presque automatique de la République dans l’État français, une partie des radicaux soulève la faute du parti de n’avoir pas su admettre les évolutions nécessaires du régime pour faire face aux enjeux de l’entre-deux-guerres. Jean Zay, isolé dans sa prison, est de ceux-là. Moins isolés, Justin Godart, Yvon Delbos ou André Marie préparent en France ou à Alger des réformes d’envergure pour la République future. Paul Bastid surtout participe au Comité général d’études constitué par Jean Moulin en 1942 pour préparer un projet relatif aux futures institutions. Toutefois à la sortie de la guerre, à l’encontre de cette réflexion, les radicaux vont tenter de sauver la IIIe République. Bien qu’incapables de retrouver une place centrale dans la vie politique, ils s’opposent à la Constitution de 1946 pour finalement s’y rallier en jouant un rôle central dans la transformation des institutions de la IVe République (les incertitudes institutionnelles par Jérôme Henning / p. 166-169). Les premiers mois de la Libération sont indéniablement difficiles pour les radicaux : aux élections de l’Assemblée constituante d’octobre 1945, ils n’obtiennent les suffrages que de 7,3 % des inscrits contre 16,6 % en 1936. De même, les déboires radicaux aux différents référendums constitutionnels montrent la perte d’audience du parti dans la société. Même l’ancrage local, point de force traditionnel de la formation, est en net recul quoique de manière moins éclatante : aux élections municipales d’avril-mai 1945, environ 6 000 communes portent à leur tête une liste à majorité radicale, contre un peu plus de 9 000 avant-guerre (la conquête de la IVe République / p. 169-170). Ainsi, à la fin des années 1950, les différents partis radicaux européens éprouvent des difficultés et n’occupent plus la place centrale dans les jeux politiques nationaux qui étaient la leur dans l’entre-deux-guerres. La période a aussi montré que derrière certains héritages communs, quoiqu’avec des dosages différents en fonction des acteurs — européisme, défense de la propriété et du parlementarisme, laïcité —, il existait des divergences fortes entre une frange plutôt libérale économiquement (néo-radicalisme en France, PRD en Suisse) et une autre plus interventionniste (Italie, mendésisme), provoquant tensions et scissions (le recul radical de la fin des années 1950 / p. 177-179).
Avec le chapitre 11 « La division du radicalisme et l’émergence de nouveaux combats (années 1960-1980) » (p. 181-196), si l’on excepte la Suisse, où le radicalisme tend tout de même à décroître, les années 1960 entérinent une tendance en germe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : les différents partis radicaux d’Europe occidentale ne peuvent plus prétendre occuper une place centrale dans la vie politique nationale et doivent se contenter d’administrer certaines collectivités locales ou de jouer les supplétifs de majorités de droite ou de gauche auxquelles ils tentent d’inspirer certains principes qui deviennent dès lors les principaux marqueurs de leur discours politique, auxquels on les identifie de plus en plus. Par ailleurs, dans le processus qui tend à la bipolarisation de la vie politique, les radicaux sont contraints de faire des choix, entre le centre-droit et le centre-gauche, ce qui conduit parfois à la division, comme en France où la scission de 1972 confirme une tendance qui durait de fait depuis les années 1930, le Parti radical étant perpétuellement tiraillé entre les deux allégeances (une polarisation accrue / p. 182-190). Ces divisions n’obèrent pas toute possibilité de travail en commun, comme en témoignent les passages assez fréquents de certains dirigeants d’une formation à l’autre, mais démontrent le caractère minoritaire du radicalisme, désormais incapable d’agréger autour de lui des majorités comme sous les IIIe et IVe Républiques. Si le radicalisme européen semble dès lors en déclin rapide, il n’en reste pas moins une culture politique solidement ancrée dans certains espaces — Sud-Ouest de la France, certains cantons suisses comme celui de Vaud — et conserve une capacité à imposer certains sujets dans le débat public. Les mutations des sociétés contemporaines portent les radicaux à évoluer dans les combats qu’ils mènent. Si certains demeurent emblématiques, comme la lutte pour une école émancipatrice et garante d’ascension sociale ou la défense de la laïcité — en 1969, les radicaux italiens mènent en effet une campagne, infructueuse, pour l’abolition du Concordat — radicaux français et italiens portent à partir des années 1970 de nouvelles revendications qui contribuent à les caractériser clairement dans le champ politique. Si l’on peut établir quelques parallèles avec les radicaux suisses, ces derniers demeurent largement en retrait de ces évolutions, tout à leur approche très pragmatique et relativement conservatrice. Ces nouveaux combats radicaux (p. 191-196), inspirés de certains courants d’opinion qui prospèrent dans les années 1970 et 1980, montrent aussi la capacité des radicaux à dépasser leur stricte audience électorale en imposant, le temps d’un débat de société, certains thèmes au cœur du débat public. Ces propositions s’articulent autour de la question européenne, dont ils sont souvent des promoteurs acharnés, et de celle des libertés publiques et individuelles, dans toutes leurs déclinaisons.
Avec le chapitre 12 « Le radicalisme à l’heure des masses : une inadéquation croissante » (p. 197-210), le radicalisme a en effet abordé la dernière décennie du XXe siècle dans une position délicate : relégués aux marges des majorités de droite ou de gauche, les radicaux français peinent à peser dans le jeu politique national alors que le Partito radicale italien, moins en phase avec la société de son époque que pendant les deux décennies précédentes, ne semble plus capable d’imposer dans le débat public des thématiques suscitant l’adhésion de larges pans de la population. Quant aux radicaux suisses, ils se voient concurrencés sur le terrain du libéralisme conservateur par l’UDC qui monte en puissance d’élections en élections. Confrontés au rétrécissement des catégories sociales dans lesquelles se recrutait la majorité de leur électorat, les radicaux s’interrogent sur leur idéologie, leurs combats et leur spécificité politique. En effet, certaines des thématiques principalement portées par le radicalisme des années 1960-1970 — libéralisme économique, construction européenne — ne portent plus la marque d’une particularité radicale. De fait, les différents partis radicaux peinent à affirmer leur spécificité et à se distinguer d’autres partis centristes, en France et en Italie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le radicalisme est assez éclaté en Europe et peine à apparaître comme une seule et même famille politique. Au tournant des XXe et XXIe siècles, ce constat s’impose avec encore plus de force, les trois pays (France, Suisse et Italie) ayant conservé une tradition radicale présentant des situations assez différentes, ce dont témoignent d’ailleurs les liens très faibles qu’entretiennent les différentes formations radicales entre elles à l’échelle européenne (diversité du radicalisme en Europe / p. 198-206). Si l’on compare la situation du radicalisme en Europe aujourd’hui à ce qu’elle a été pendant une grande partie du XXe siècle, le constat de l’affaiblissement est incontestable. Les différents radicaux ne sont plus en mesure d’influer significativement sur la vie politique de leur pays, à l’exception de la Suisse où le poids du radicalisme a toutefois largement diminué. De même, les différentes formations se réclamant du radicalisme entretiennent très peu de liens entre elles. Au sein du Parlement européen, elles constituent une seule fois, à l’issue du scrutin de 1994, un groupe commun, fédéré autour des députés de la liste Énergie radicale conduite par Bernard Tapie (le radicalisme en péril / p. 206-209).
Le radicalisme en Europe (XIXe-XXIe siècles) : la première étude synthétique sur le radicalisme européen et contemporain
En dépit de ces aspirations et de problématiques communes à des situations contemporaines, le radicalisme demeure largement un phénomène national. À la différence des socialistes mais aussi des libres penseurs avec lesquels ils se recoupent pourtant, ou même de leurs adversaires démocrate-chrétiens et, à vrai dire, de l’essentiel des forces politiques, les radicaux ne se constituent pas en Internationale spécifique et ce livre, malgré l’attention portée par les différents auteurs aux esquisses de réseaux et aux transferts éventuels, est donc une histoire du radicalisme en Europe davantage que d’un incertain radicalisme européen, même si cette unité est largement valide dans son moment génétique.
Il est trop divers par la suite pour que l’on cherche à en présenter un visage unifié. Son étude illustre en revanche la possibilité d’une lecture européenne du radicalisme qui, sans chercher à repérer à tout force des traits communs, permet de constater d’indéniables originalités mais aussi de dégager des logiques similaires et de décentrer le regard porté traditionnellement sur le seul radicalisme français, dont l’épaisseur est ainsi redéfinie par son inscription dans un ensemble plus vaste, dont les temporalités se chevauchent sans toujours se confondre. C’est ainsi que le radicalisme connaît son apogée dès le XIXe siècle en Suisse, mais seulement dans les années 1900 en France, au Royaume-Uni ou au Danemark, tandis qu’il doit attendre l’entre-deux-guerres pour exercer, brièvement et jamais seul, le pouvoir en Espagne, et même la seconde moitié du XXe siècle en Italie pour rencontrer un écho médiatique supérieur à son poids électoral.
Face à la crise de la démocratie en Europe, en ce début de XXIe, la radicalisme européen n’aurait-il pas un rôle à jouer afin de redonner un coup de fouet salvateur à la représentation citoyenne auprès des électeurs européens ? Quant à la situation actuelle de la France, d’ailleurs, le macronisme, à certains égards, ne serait-il pas une forme de néo-radicalisme français du XXIe siècle dévoyé dans un (pseudo social-)libéralisme mondialisé ?
Outre le fait que cet ouvrage soit la première étude synthétique sur le radicalisme européen et contemporain, cette étude est importante, à plusieurs titres ! En effet, il s’agit du premier travail universitaire de valeur et de langue française sur le radicalisme, depuis l’ouvrage de 2004 sous la direction de Marcel Ruby et Serge Berstein, Un siècle de radicalisme, soit il y a presque 20 ans, déjà ! De plus, ce dernier était le fruit d’un colloque avec son lot de contributions de valeur mais avec une thématique très lâche… Or, là, nous avons affaire à une synthèse chrono-thématique où chaque période historique est rédigée par un seul et même auteur (à l’exception des trois inserts de Jérôme Henning) donnant ainsi à l’ouvrage une cohérence de style et intellectuelle ! En espérant que cet ouvrage remarquable puisse donner un nouvel élan aux étudiants de master 1 et 2 voire des doctorants ainsi que les enseignants-chercheurs pour des études locales sur le radicalisme français ou européen afin d’affiner les grands axes de l’équipe de Fabrice Conord.
Ainsi, nous ne pouvons que recommander cet ouvrage qui s’adresse aussi bien aux enseignants-chercheurs s’intéressant à de nouveaux champs historiques que les érudits locaux et les étudiants en histoire cherchant de nouveaux sujets de Master 1 et 2, voire de thèse.