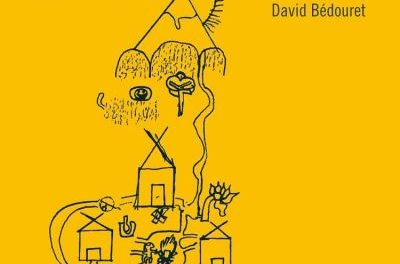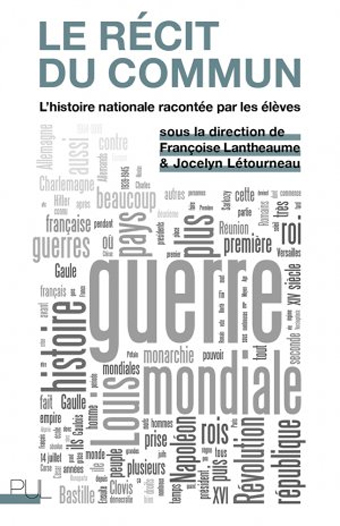
Dans ce contexte de conflictualité et de remise en question, comment les élèves se placent-ils face à tout cela ? Quelles réceptions ont-ils des savoirs historiques ? Que connaissent-ils de leur histoire ? Contre les idées reçues circulant à ce sujet (les jeunes n’apprennent pas ou mal l’histoire de leurs pays, il y a une absence de tout récit commun), cet ouvrage collectif dirigé par Françoise Lantheaume et Jocelyn Létourneau nous propose une analyse détachée de tout jugement de valeur. Issu d’une enquête internationale menée auprès d’environ 7 000 élèves âgés de 11 à 19 ans à la rentrée scolaire de 2012 et auxquels il a été demandé de raconter l’histoire de leur pays, Le récit du commun offre une analyse alors jusque là inédite en France.
Dans le premier article, les deux directeurs s’attachent à nous définir la méthodologie de l’enquête, basée sur un questionnaire commun à tous les élèves de fin de cycles de formation. Si l’enquête s’est déroulée en milieu scolaire, la forme qui lui fut donnée ne correspondait pas du tout à une évaluation et les auteurs tiennent particulièrement à ce point : il ne s’agit pas de juger leurs connaissances historiques. La première question ouverte « Raconte l’histoire de France » invitait à faire un récit, laissant libre cours à l’élève dans la manière de le mener. La deuxième question les conduisait à faire un choix hiérarchique dans les sources qui, selon eux, participent de leurs connaissances historiques. La dernière question leur proposait de résumer en une phrase ou une expression l’histoire du pays. Pour ce qui est de la Réunion et de la Corse, les auteurs ont testé l’hypothèse d’un effet insulaire sur le récit : en leur demandant de « Raconter l’histoire du pays » et non pas de « Raconter l’histoire de France », les élèves choisissent-ils de raconter l’histoire de France ou de leur île ?
Car, comme se le demande Bruno Garnier dans l’article suivant, que demande-t-on aux élèves lorsqu’on leur demande de raconter l’histoire de France ? Attendons-nous d’eux qu’ils restituent des connaissances historiques, qu’ils produisent une œuvre littéraire ou qu’ils romancent l’histoire ? Si le vocabulaire employé et les références sont difficilement abordables pour un lecteur non spécialiste de la philologie et de la narratologie, les exemples fournis facilitent la compréhension de la démonstration. L »auteur s’est ainsi questionné sur la place et le statut de l’élève en tant que narrateur actif de l’histoire. Spontanément, les élèves ont alors eut recours à des formes narratives littéraires ainsi qu’à des marques d’énonciation. Et si les historiens et professeurs d’histoire-géographie pourront avoir le poil hérissé par certains récits, l’auteur rappelle que « même truffée d’erreurs et d’approximation, ces connaissances historiques sont bel et bien présentes » (p.36). La question du récit et de son retour dans les programmes scolaires est ici soulevée, Bruno Garnier se réjouissant pour sa part de le voir réapparaître comme outil pédagogique dans les programmes.
« D’où viennent les savoirs des élèves ? » (p. 39). Pour Vincent Chambarlhac, le pluriel du terme renvoie à l’hétérogénéité des savoirs. L’école n’est pas l’unique matrice du récit historique. En effet, si au premier rang des réponses apparaît la réponse : « cours déjà suivis pendant votre scolarité » à hauteur de 52%, les 48% restant viennent d’ailleurs. Et c’est essentiellement dans le cercle familial que les élèves considèrent acquérir le reste du savoir historique. Cette analyse a aussi relevé que les commémorations et les entreprises mémorielles ne pèsent pas au premier rang des réponses, et constituent seulement 1% des réponses au rang deux. L’auteur note alors que « cette faiblesse marque l’absence de dimension civique dans la constitution des savoirs » (p.45).
Dans l’article suivant, Laurence Cook et Benoît Falaize relèvent la forte présence des acteurs de l’histoire dans le récit des élèves. Plus d’une centaine de protagonistes différents furent recensés, Louis XIV et Napoléon arrivant en tête. Néanmoins, les auteurs ont remarqué que le « panthéon national » commençait à se renouveler : certaines figures disparaissent, d’autres apparaissent comme Hitler ou Nicolas Sarkozy (le lien avec l’actualité au moment de l’enquête n’y étant peut-être pas pour rien, à savoir la campagne présidentielle de 2012). Des personnages non politiques sont également présents comme Victor Hugo, Voltaire ou encore Molière. Notons que « le peuple » et « la France » sont des occurrences principales et qu’elle agissent comme des identifiants à une culture commune, la France devenant ici un quasi-personnage. Les auteurs relèvent une autre tendance dans les récits : celle de « l’identification de groupes ayant été victimes dans l’histoire » (p.61). Ils se demandent alors si cela a un lien avec la concurrence des martyrs en œuvre à notre époque ou avec la révision des programmes scolaires de 2002.
Prenant la suite, Françoise Lantheaume se questionne sur la manière dont le politique se manifeste dans le récit des élèves, qui « reste l’un des organisateurs majeurs de leur compréhension de l’histoire de France » (p.68). La politique est alors souvent associée au pouvoir, à la domination. Si les origines de l’histoire de France ne sont ni évidentes, ni partagées unanimement par les élèves, tous partagent l’idée que l’histoire de France est un construit longtemps instable (par les guerres notamment), dont la stabilité est venue des formes politiques. Pour eux, la finalité de l’histoire de France est la démocratie et la république : tous les événements ont mené à cela.
Eglantine Wuillot s’attache, quand à elle, à l’analyse de la guerre dans les récits. Il en ressort que lorsque les élèves pensent à l’histoire de France, ils pensent majoritairement aux guerres : 60% des récits en parlent. Pourtant, peu d’entre eux (seulement 20%) réfléchissent au sens de la guerre et à sa répétition. Pour ces élèves, la guerre représente soit une évolution, un progrès, un moyen de lutter pour la justice et la liberté (après la Première guerre mondiale surtout) ou encore un moyen pour la France de s’élever et de montrer la bravoure du pays.
Sebastien Urbanski se questionne ensuite sur place accordée par les élèves à la religion et à la modernité : si en France une « certaine méfiance subsiste à l’égard des religions » (p.101), est-ce la même chose pour les élèves ? Une première distinction est à effectuer entre les élèves de la Métropole et ceux de la Réunion. Les premiers insistent sur la disparition progressive de l’emprise religieuse, la religion étant avant tout un phénomène politique. Majoritairement perçue comme négatif, le christianisme est valorisé dans seulement 16% des récits pour son apport à l’histoire de France. Les seconds, quant à eux, emploient le terme de religion au pluriel, se référant essentiellement au culte des ancêtres. Une seconde distinction est également à noter entre les élèves du public et du privé : ces derniers insistent fortement sur la religion dans leurs récits mais occultent certains moments de l’histoire, comme la Saint Barthélémy qui n’est jamais mentionnée à la différence des récits du public.
En ouverture de la partie consacrée à la territorialité des savoirs, Stéphane Clerc se questionne sur les liens existants entre le territoire et les récits, entre le territoire et la construction d’une identité collective. Après avoir étudié le territoire de la Bourgogne de de Rhône Alpes, l’auteur parvient à la conclusion que l’histoire locale, ainsi que les monuments locaux ont un rôle bien moindre dans la construction du récit, et que le cadre national demeure la matrice essentielle des récits. Si les événements, comme la prise de la Bastille, sont bien présents, le patrimoine architectural et les lieux historiques sont cependant peu cités (1/3 des récits).
À sa suite, se trouve l’article d’Angelina Ogier-Cesari centré sur l’analyse des récits corses. Une distinction est à faire entre les récits des collégiens et ceux des lycéens. Les premiers ont un rapport enchanté à leur île, considérant bien la Corse comme française mais étant à part. L’on note chez les seconds un phénomène de déterritorialisation, seulement 35% des élèves racontent l’histoire de la Corse. Si le fossé entre histoire régionale et nationale existe, il apparaît bien moins grand qu’on ne l’aurait cru.
La situation est assez différente à la Réunion. Analysés par Raoul Lucas, Mario Serviable et Stéphane Guesnet, les récits des élèves montrent que 83% d’entre eux ont choisi la Réunion comme étant leur pays. La singularité de l’île ressort de ces récits, marqués par l’esclavage et la colonisation : la diversité et le pluralisme ont forgé la Réunion, et constituent le socle de la société. La question de l’altérité est ainsi soulevée, les élèves ayant conscience d’être et de vivre à la croisée de multiples cultures. Celle de l’enseignement réunionnais est aussi abordée, ce dernier oscillant entre la diversité de son histoire et le cadre unifié des programmes scolaires.
La dernière partie est « une exploration des cas suisse, allemand et catalan », basée sur le même questionnaire. Si leurs analyses n’apportent rien à la question d’un récit commun en France, et ne permettent pas de dresser une lecture sur le récit de leurs pays (les études étant menées dans des villes bien spécifiques), il est cependant intéressant de noter les interrogations soulevées par ces résultats. Premièrement, sur le rapport qu’ont les élèves en général sur leur passé et sur la question du rapport à la vérité dans nos rapports au passé et à son intelligibilité : dans les récits genevois, on s’aperçoit que ce sont principalement les images d’Épinal du pays qui ressortent, la figure de Guillaume Telle arrivant en tête. Vient ensuite la question autour de l’héritage narratif de l’histoire du pays : si les récits des élèves à l’est de Berlin mentionnent la RDA, ceux situés à l’ouest montrent que la RDA n’est pas présente dans la conscience historique.
En conclusion, il convient avant tout de rappeler la rigueur et la pluridisciplinarité qui sont à l’œuvre dans cet ouvrage : utilisant une méthodologie stricte, les auteurs appuient leur analyses sur des thèses d’auteurs, offrant au lecteur un résumé des données via des tableaux clairs. La bibliographie, mise à la fin de chaque article, permet au lecteur d’apprécier les lectures utiles sur chaque sujet. De plus, l’évocation de nombreux extraits des récits d’élèves au fil des démonstrations s’avèrent utiles à la compréhension mais peut également satisfaire la curiosité du lecteur.
Mais ce que nous devons retenir est que Le récit du commun offre une analyse inédite et passionnante du récit que se font les élèves de leur histoire nationale. Ces récits ont ainsi montré que la majorité des jeunes, contrairement à une idée reçue, aime l’histoire et cherche à se constituer un socle de connaissances historiques. Leur conscience d’appartenir à une nation commune et de partager une mémoire et une histoire commune transparaît dans les réponses, l’utilisation du pronom « nous » dans de nombreux récits en est un bel exemple.