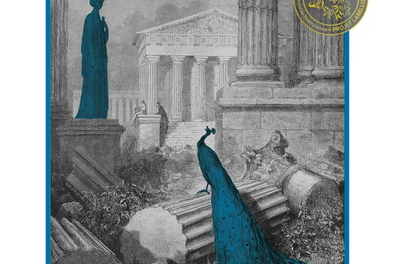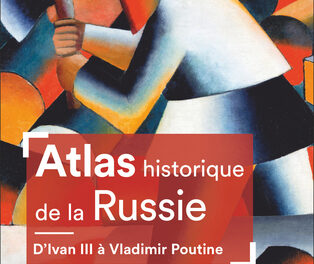Cet ouvrage réunit les contributions des participants à la rencontre qui s’est déroulée les 27 et 28 septembre 2004 à Madrid, à la Casa de Velazquez, autour de la question du sentiment national à l’époque moderne, notamment en Espagne, en Italie et en France.
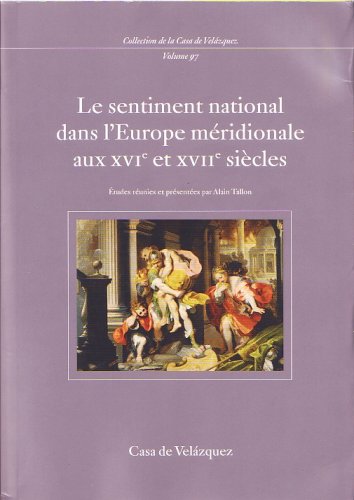
Un sentiment national à l’époque moderne ?
Dans son introduction, Alain Tallon dresse un premier bilan tant de l’historiographie que des différentes contributions réunies dans ce volume. La nation apparaît, aux XVIe et XVIIe siècles, comme une notion encore très floue pour les contemporains. Elle est également très variable suivant le contexte. C’est ce que l’article de Richard Kagan illustre à travers l’étude du vocabulaire employé par les historiens espagnols aux XVIe et XVIIe siècles. Même si le terme de « nation » tend de plus en plus à recouvrir ceux d’Espagne et de monarchie, tandis que « patrie » est plutôt associée aux différents royaumes de la monarchie espagnole, les contours de ces deux termes restent encore très flous. Pourtant, selon Alain Tallon, un sentiment national, propre à l’époque moderne, peut être défini. Il s’agirait d’une « communauté imaginaire » qui n’exclut pas les autres types d’identités. Elle n’est pas obligatoirement associée à une représentation politique. Enfin, elle ne disposerait pas de relais suffisamment efficaces pour connaître une diffusion uniforme dans l’intégralité d’une population. Elle s’épanouirait en effet de manière privilégiée dans les sphères diplomatiques, politiques ou érudites.
A contrario, pour Jean-Frédéric Schaube, la question nationale n’est pas particulièrement pertinente à l’époque moderne dans la mesure où l’historien ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de connaître l’étendue de l’adhésion d’un éventuel sentiment national dans la population. C’est pourquoi il préfèrerait que cette problématique reste cantonnée à la période contemporaine. Selon lui, l’étude des mécanismes de politisation des sociétés modernes lui semblerait plus féconde. Seul l’article de Jean-François Dubost répond en partie à la question méthodologique posée par Jean-Frédéric Schaube. Jean-François Dubost s’attache en effet à montrer que le tournant du XVIe et du XVIIe siècle réunit les conditions pour l’émergence d’une opinion publique, notamment dans la bourgeoisie officière.
Le rôle de l’Etat dans la constitution d’une identité nationale
Les articles de Tamar Herzog et Jean-Pierre Dedieu abordent chacun à leur manière le rôle que joue l’Etat dans la définition de l’identité nationale. Ils en montrent toute la complexité. A travers la question de la définition du statut de natif en Castille (attaché à l’exercice de droits tant en Castille que dans l’Amérique espagnole), Tamar Herzog montre que le durcissement des conditions de naturalisation concédé au début du XVIIe siècle par l’Etat au consulado de Séville, attaché à limiter l’accès au monopole du commerce transatlantique, n’avait eu qu’une efficacité très limitée. En effet, la reconnaissance du statut de natif passe avant tout par l’intégration réelle à la communauté (résidence, mariage, possession de biens) et donc par les interactions quotidiennes entre les individus. Jean-Pierre Dedieu montre comment l’Etat a, du XVIe au XIXe siècle, contribué à forger la nation espagnole. La titulature royale révèle une unité beaucoup plus précoce dans les relations du roi d’Espagne avec les Etats étrangers. A l’inverse, la titulature en chaîne est encore de mise jusqu’au début du XIXe siècle et illustre les relations pactistes que le souverain espagnol entretient avec ses sujets. Pourtant dès le XVIIe siècle, la polarisation des réseaux autour du roi a constitué un facteur d’unité. Enfin, Jean-Pierre Dedieu insiste sur le tournant qu’a représenté la réforme institutionnelle de Philippe V (Cortès uniques, recomposition des Conseils, création de secrétariats d’Etat avec traitement thématique et non plus géographique des affaires) dans l’unification territoriale de la monarchie espagnole et par conséquent la définition d’une identité nationale.
La figure de l’étranger, miroir de l’identité nationale
Deux articles s’attachent à décrire comment la figure de l’étranger révèle l’identité nationale. Bertrand Haan montre ainsi que la stigmatisation de l’étranger venu du royaume de France dans les royaumes espagnols dans les années 1560 révèle avant tout la vocation messianique de la monarchie espagnole, garante de la chrétienté après la prise de Grenade, l’expulsion des Juifs et la main-mise sur l’Amérique, monarchie qui cherche à asseoir sa suprématie sur un royaume gangrené par l’hérésie. Jean-François Dubost analyse les figures de l’Espagnol, de l’Italien mais aussi du « mauvais » et du « bon » Français dans les libelles qui, au cours de l’année 1615, dénoncent le gouvernement et la politique de la régente florentine à l’occasion de la question des mariages espagnols. A travers les stéréotypes moraux, sociaux et physiques qui décrivent les étrangers apparaît l’idéal identitaire français autant social et moral (idéal nobiliaire) que politique (attachement à une monarchie où le droit naturel prime et dans laquelle la noblesse n’est pas écartée du pouvoir).
La question des origines, un enjeu politique
La contribution de Pablo Fernandez Albaladejo montre que, quelle que soit l’origine retenue (origine wisigothique liée à la victoire sur Rome ou origine ibère pré-romaine liée à une résistance continue à Rome), l’identité espagnole recèle une opposition à l’autorité pontificale. Chantal Grell montre comment les historiens nationaux, notamment français et espagnols, se sont emparés des reconstructions généalogiques d’Annius de Viterbe. La « résurrection » par ce dernier des sources égyptiennes et babyloniennes a permis de jeter le discrédit sur les auteurs gréco-latins et sur l’humanisme classique de la Renaissance italienne. Ainsi chaque nation européenne pouvait s’affranchir de la tutelle romaine. En outre, chacune d’elles pouvait prétendre être la plus ancienne et donc affirmer sa primauté par rapport aux autres.
Les intellectuels, Rome et l’identité italienne
Selon Adriano Prosperi, l’humanisme a permis, aux XVe et XVIe siècles, de prendre conscience de l’héritage de la Rome antique et d’une rupture avec ce passé romain. Le double thème de la décadence et d’une renaissance espérée a permis de faire naître un sentiment d’italienité, notamment dans la sphère érudite avec des auteurs comme Valla ou encore Machiavel. Ce sentiment aurait décliné avec l’affirmation de l’hégémonie de la papauté au XVIe siècle. Les intellectuels ne sont pas étrangers à cette hégémonie comme le montre Cesare Vasoli à travers l’oeuvre de Scipione Ammirato, écrivain, historien et penseur de la Contre-Réforme. Ce dernier justifie l’action de Rome en réfutant la thèse de Machiavel selon laquelle l’union de la péninsule aurait été rendue impossible par l’action pontificale. Gigliola Fragnito développe l’idée selon laquelle le maintien du latin par l’Eglise de la Contre-Réforme a constitué un obstacle à l’unification linguistique de la péninsule et donc, d’une certain manière, a été un frein à la diffusion du toscan, privilégié par les lettrés, et par conséquent à la diffusion d’un certain sentiment national italien. Enfin, Gianvittorio Signorotto analyse comment les principautés italiennes ont dû tenir compte à la fois du thème de la liberté de l’Italie et des deux puissances à l’oeuvre dans la péninsule, à savoir Rome et l’Espagne, pour asseoir leur existence politique.
Sentiment national et question religieuse
Sylvio Hermann de Franceschi s’attache à montrer à travers l’étude des écrits du théologien vénitien Paolo Scarpi qu’au tournant du XVIe et du XVIIe siècle le sentiment d’appartenir à la chrétienté, c’est-à-dire à une société de salut commun, s’efface au profit d’un nouveau sentiment collectif, celui de la fidélité à l’autorité temporelle légitime. L’identité de Paolo Scarpi est également faite d’un emboîtement d’identités d’échelles différentes (Venise / l’Italie / l’Europe / le monde). Le récit des visions de frère Fiacre de Sainte-Marguerite permet à Denis Crouzet de définir un sentiment national centré sur la personne du roi, Christ terrestre, à la tête d’un royaume protégé par Dieu, au destin duquel celui de ses sujets est identifié. Pour Arlette Jouanna, la question religieuse qui divise le royaume de France durant les Guerres de religion a rendu nécessaire l’élaboration d’une identité française pour transcender les clivages religieux. Le thème de la liberté française, assis en grande partie sur les origines troyennes des Francs, a ainsi servi à construire une identité politique faite d’attachement au roi mais de rejet de la tyrannie, de refus de l’impôt sauf s’il est librement consenti à travers ses représentants (Etats-Généraux). Cette construction identitaire n’a pu résister à la division religieuse du royaume mais a survécu sous la forme d’un attachement aux libertés lors de la restauration de l’autorité monarchique. Selon Arlette Jouanna, elle trouve également un prolongement au XVIIIe siècle dans la volonté des Français d’être consultés à travers leurs représentants. Myriam Yardeni s’attache à mettre en évidence la dimension religieuse du sentiment national français. Elle montre ainsi comment le thème de l’élection divine s’est peu à peu concentré aux XVIe et XVIIe siècles au profit du seul roi. A l’écart de cette conception catholique de l’élection, les huguenots maintiennent un sentiment national par leur attachement à la « patrie » et leur fidélité au roi. Dans un XVIIe siècle de plus en plus difficile pour eux, en dépit d’un réel attachement au roi, les huguenots développent avant même l’édit de Fontainebleau le thème de l’étranger voyageur en pays natal. Ils se détachent ainsi de la « patrie » pour leur vraie patrie : le ciel.