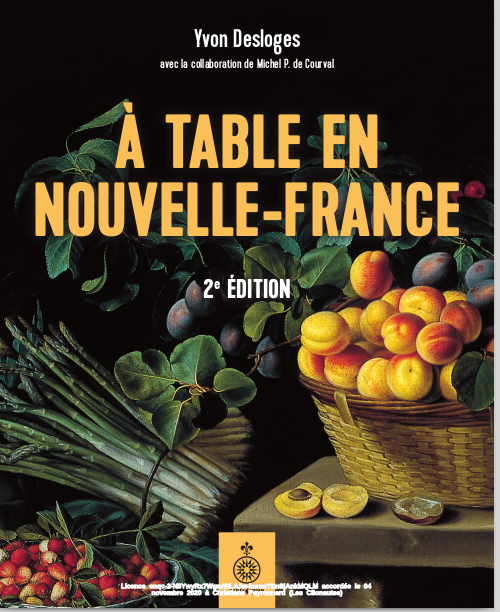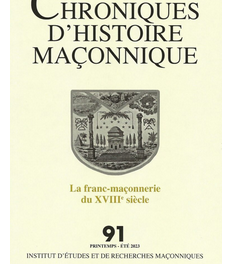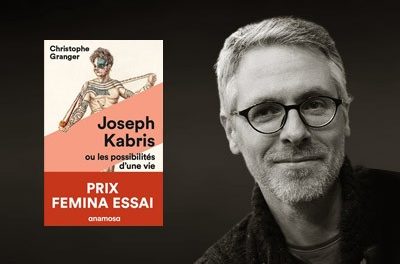Ce livre propose une expérience culinaire à vivre. Un tableau à grands traits de l’alimentation d’autrefois au Canada français précède un livre de recettes.
Un modèle culturel
La mise en valeur la cuisine traditionnelle est l’occasion pour les Québécois d’affirmer leur culture même si la problématique des échanges culturels entre autochtones et européens, et entre Européens et Nord-Américains interroge la tradition. Le menu immuable n’a jamais existé.
Dès le début s’affronte deux modèles, si on en croit les textes. En effet selon Marc Lescarbot, en 1617, le régime alimentaire des Premières Nations est sans sel, sans pain et sans vin ; alors que pour l’intendant De Meulles, à la fin du XVIIe siècle :« Nous vivons à Québec, écrit-il, comme en France et on y fait aussi bonne chère et même meilleure, tout y étant à meilleur marché et en plus grande abondance.»Cité p. 10.
L’ouvrage permet d’aborder successivement les perceptions des voyageurs au sujet des aliments et des modes de préparation des Premières Nations, les aliments de base tant en ville qu’à la campagne mais aussi le faste des tables bourgeoises et des palais.
Manger à la mode autochtone
Que consommaient les divers groupes amérindiens de la vallée du St Laurent ?
Les Iroquoiens, à l’époque de Cartier, vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Ils cultivent le maïs, les courges et les haricots, et du tournesol. Ensuite peu présents dans la vallée leur alimentation est mal connue, une certitude : leur civilisation est celle du maïs.
Le portrait général fait par Champlain est celui de peuples « gloutons », qui mangent beaucoup lors de festins et font peu de réserves. Les divers auteurs parlent tous de pêche ou de chasse (viande boucanée) et de courges, de haricots et de pain de maïs ou de sagamité (bouillie de maïs). Ils recueillent aussi les œufs des oies et des outardes.
Les Algonquins, Micmacs, Outaouais ou Sauteux ne cultivent pas. Ils vivent de chasse et de pêche, de la cueillette les bleuets et des atocas (canneberges). Ce sont des chasseurs-cueilleurs selon le jésuite Beschefer. Certains témoignages font état du manque de vivres à certaines saisons. Ils consomment alors les fibres internes de l’écorce de pin ou une mousse : la tripe de roche.
Les nations de l’ouest et du sud des Grands Lacs pratiquent l’horticulture. Ils cuisent le maïs avec les citrouilles puis le font sécher et d’autres plantes difficiles à identifier.
Extrait d’une gravure tirée de Joseph François Lafitau, bonnes quantités de courges et Mœurs des sauvages ameriquains comparées aux mœurs des premiers temps, vol. 2, p. 154, Bibliothèque et Archives Canada (BAC), C-125262. (p. 22).
Les colons sont confrontés à des plantes ou des animaux inconnus (topinambour, dindon…) et à des modes de préparation nouveaux (p. 25-26 préparation de la sagamité). La culture du maïs par les Hurons a, semble-t-il, beaucoup impressionné les Européens. Plusieurs auteurs décrivent les festins autochtones comme Marquette et Jolliet qui sont conviés à un festin illinois, qui se compose de quatre plats : une sagamitéRecette de la sagamité au poisson p. 37 assaisonnée de graisse, de trois poissons, puis un grand chien et enfin du « bœuf sauvage » (bison).
Les Amérindiens vivant à proximité des établissements français ou « Indiens domiciliés » font connaître aux colons leurs mets. Les Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal semblent beaucoup apprécier le blé fleuri (du maïs éclaté sous la cendre chaude, connu aujourd’hui sous le nom de pop-corn). Les Amérindiennes préparent aussi le sirop d’érable qu’elles apportent au marché de Montréal. Les emprunts se font dans les deux sens, les Amérindiens cultivent des pois français, élèvent quelles vaches pour le lait et mangent de la soupe de légumes. Ils adoptent petit à petit la chaudière en cuivreSur ce sujet voir le chapitre « Faire chaudière » en Amérique du Nord in Laurier Turgeon, Une histoire de la Nouvelle France – Français et Amérindiens au XVIe siècle, Belin, 2019.
L’auteur évoque aussi les provisions de voyages de ces peuples semi-nomades. Il pose la question des carcasses d’animaux tués pour la traite des fourrures.
Garnir le garde-manger : les aliments de base
Pain de blé froment, produits de l’élevage, produits de la pêche pour les jours maigres du calendrier liturgique, les légumes, sont les aliments habituels des colons français. C’est, comme en Europe, la civilisation du pain. Les viandes sont issues de l’élevage, au XVIIe siècle, qui se compose de 65 % de bovins, 27 % de porcs et à 8 % de moutons. L’élevage ovin se développe au XVIIIe siècle. La production laitière demeure faible même s’il est important dans l’alimentation estivale.
Les ressources du pays ne sont pas négligées, notamment la chasse qui n’est pas réservée à la noblesse comme sur le vieux continent. L’auteur analyse la place du gibier grâce à l’archéologie. Si les premiers colons ont survécu grâce à l’orignal, les générations suivantes l’ont délaissé, question de goût, préférant le gibier à plumes.
Outre les poissons consommés pendant le carême, les produits maraîchers : légumes, légumineuses et herbes tiennent une grande place comme les poisLes pois sont la base d’un plat typiquement québécois : la soupe aux pois dont une recette est données p. 184 et les fèves en hiver. Les jardins de Québec montrent la grande variété de légumes cultivés. Si la citrouille amérindienne y est présente ce n’est pas le cas du maïs. Les colons ne cultivent ni ne consomment la pomme de terre qu’ils réservent aux cochons.
Pour assaisonner leur cuisines les Laurentiens utilisent le sel qui sert aussi à la conservation, les épices et les fromages importés.
L’auteur fait une place aux fruits et aux boissons : lait en été, bouillon (eau fermentée avec une boule de pâte au levain), cidre et bière produits localement, vins importés. Au XVIIIe siècle le café, le thé, le chocolat et le sucre entrent dans l’alimentation. Un paragraphe est consacré à « l’eau d’érable », décrite la première fois par Marc Lescarbot, en 1607, chez les Micmacs en Acadie. Le sucre d’érable, au XVIIIe siècle rivalise avec le sucre des Antilles.
Cornelius Krieghoff, La fabrication du sucre d’érable, 1852, Bibliothèque et Archives Canada, collection Winkworth, C-150736. Cité p. 74
En conclusion Le garde-manger des colons de la Nouvelle-France est généralement bien garni.
La diffusion des aliments : un phénomène urbain
En ville les habitants ont accès aux marchés locaux, à des stocks de produits importés. Les institutions religieuses qui reçoivent les revenus de leurs terres sont des plaques tournantes des échanges.
L’auteur décrit le marché de Québec, le circuits des denrées provenant des ordres religieux et des magasins du roi. Les produits alimentaires et des vins et alcools représentent environ 30 % des importations. Ces produits alimentent les tables des palais coloniaux. Les religieux ne sont pas en reste, la première mention d’un cuisinier à Québec est celui des Jésuites en 1645.
Avec les Anglais qui ont l’habitude de manger à l’extérieur, des cafés et tavernes ouvrent dans les à Québec et Montréal.
Les fondements de l’alimentation populaire rurale
Les bases de l’alimentation reposent, pour les engagés, les soldats et les officiers des troupes sur les rationsTableau des rations civiles et militaires quotidiennes en grammes, 1636-1800 p. 96 qui nous informent sur le discours diététique mais aussi sur les habitudes et les goûts. Les composantes sont le pain (1 kg/jour) et le lard, à l’occasion un peu de graisse et des légumineuses (principalement des pois). Les donations réclamées par les ruraux vivant à l’intérieur des limites du gouvernement de Québec montrent, avec précision, les composantes et l’évolution de l’alimentation notamment, à la fin du XVIIIe siècle au contact des Britanniques.
Le régime alimentaire urbain
Ce sont les données archéologiques qui permettent d’approcher l’alimentation urbaine, en particulier en matière d’alimentation carnée. Le régime des patients de l’Hôtel-Dieu donne des indications en matière de viandes fraîches. Les inventaires après-décès montrent les réserves de grains et les stocks des marchandsTableau – Mentions de légumes dans les inventaires après décès des résidents de Québec, 1639-1799 p. 126. Ce chapitre reprend les différents aliments en comparaison avec les informations du chapitre précédant. L’influence des Britanniques est plus rapide qu’à la campagne (thé, sucre, Rhum).
Quand tradition égale changement
Pour le colon de la Nouvelle-France la soupe est un plat de base. Ces choix sont aussi dicté par des considérations économiques. Si les emprunts faits à l’alimentation amérindienne s’effacent progressivement les Amérindiens connaissent aussi des changements dans leur alimentation. Pour tous, au denier tiers du XVIIIe siècle, l’implantation de la culture de la pomme de terre et des techniques de production du fourrage vont modifier durablement le régime alimentaire.
De la théorie à la pratique : quelques recettes
Chaque recette est précédée d’un court texte qui évoque soit les ingrédients (disponibilité, importation au XVIIe et XVIIIe siècle), soit tel ou tel personnage qui donne le contexte de l’époque. Elles sont à essayer tant elles paraissent toutes gourmandes. La source est précisée même si le texte est adapté à notre époque (température du four, robot par exemple).
Si la plupart des recettes sont d’inspiration française quelques-unes viennent d’autres pays européens.
L’auteur classe les recettes selon leur lieu de consommation. Dans chaque catégorie il propose entrée, viande, poisson et dessert. On découvre ainsi des recettes de la table paysanne, celles du missionnaire ou du voyageur ou du marchand, ce que mangent les religieuses, le gouverneur français ou l’administrateur britannique et ce que le Canadien pouvait consommer à l’auberge ou au cabaret.
Un livre à déguster sans modération