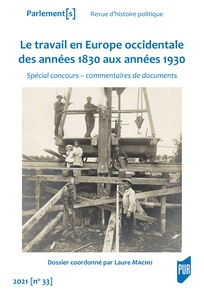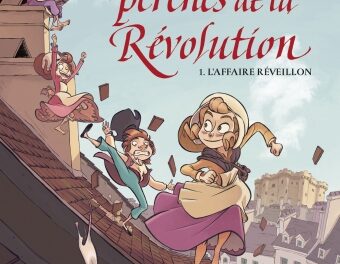Créée en 2003 sous le titre Parlement[s], Histoire et politique, la revue du CHPP change de sous-titre en 2007 pour affirmer sa vocation à couvrir tous les domaines de l’histoire politique. Chaque volume est constitué pour l’essentiel d’un dossier thématique (partie Recherche), composé d’articles originaux soumis à un comité de lecture, qu’ils soient issus d’une journée d’études, commandés par la rédaction ou qu’ils proviennent de propositions spontanées. Quelques varia complètent régulièrement cette partie. La séquence (Sources) approfondit le thème du numéro en offrant au lecteur une sélection de sources écrites commentées et/ou les transcriptions d’entretiens réalisés pour l’occasion. Enfin, une rubrique (Lectures) regroupe les comptes rendus de lecture critiques d’ouvrages récents. Enfin, la revue se termine systématiquement par des résumés des contributions écrits en français et en anglais (suivis de mots-clés).
La revue Parlement[s] n° 33 a pour thème : Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930 (Spécial concours – Études de documents). Ce trente-troisième dossier est coordonné par Laure Machu. Exceptionnellement, le dossier ne se compose pas de deux éléments distincts mais d’un seul : une première partie consacrée à 20 documents commentés (avec la contribution de 20 chercheurs différents, jeunes ou confirmées) [Sources] et, une fois n’est pas coutume, la seconde partie consacrée habituellement à des lectures (critiquées par historiens différents) [Lectures], a été supprimée dans ce numéro, spécial concours.
Ce dossier s’ouvre avec une introduction rédigée par Laure Machu : « Suivant une tradition désormais bien établie, la revue Parlement[s] choisit de publier des commentaires de sources dans l’espoir qu’ils soient utiles aux candidats qui préparent les concours du CAPES et de l’agrégation comme à l’ensemble de ses lecteurs. Une variété de documents (correspondance, pétitions, enquêtes, discours parlementaires, convention collective, articles de presse, photographies, daguerréotypes, caricatures, etc.) émanant d’acteurs ou d’instances divers (ingénieurs, patrons, parlementaires, militants du mouvement ouvrier… sans oublier les ouvriers eux-mêmes) est ici proposée. L’ensemble permet donc de croiser les discours émanant de la classe ouvrière elle-même avec ceux tenus sur le travail et les ouvriers. Son hétérogénéité est à la mesure des enthousiasmes, des craintes et des préoccupations que suscitent l’industrialisation et l’émergence des mondes ouvriers. Dans sa composition, ce dossier s’efforce d’aborder un grand nombre des problématiques incluses dans la question aux concours tout comme d’évoquer l’ensemble des renouvellements thématiques et méthodologiques qui marquent le « réveil de l’histoire ouvrière » et l’essor de l’histoire du travail depuis le début des années 2000 (p. 11-12). […] On voit ainsi combien cette histoire du travail, entrelaçant les mains-d’œuvre, les pratiques, les débats et les conflits autour de la question sociale interdit toute vision irénique d’une marche rassurante vers le progrès. » (p. 18).
I. Mutations du travail et de l’organisation du travail : (p. 19-60)
Dans la première partie du dossier, sont présentés trois articles qui mettent d’abord en évidence la variété des lieux et des formes d’organisation du travail, tout en incitant à réfléchir sur les modalités de leur succession. Sont ainsi évoqués la proto-industrie (Didier Terrier et Mohamed Kasdi), la fabrique collective (Julien Caranton) mais aussi l’usine, tant la « PME rurale » que la grande usine rationalisée belge (Éric Gerkeens). L’ensemble rappelle qu’il n’existe de passage ni évident ou soudain, ni inéluctable ou nécessaire, de l’une à l’autre forme d’organisation du travail.
I-1/ « Conserver les ouvriers à leur sol natal ». Processus d’industrialisation et regards sur l’avenir du tissage à bras dans les campagnes françaises (années 1860) : (p. 21-38)
Mohamed KASDI (Docteur en histoire) et Didier TERRIER (Professeur émérite, Université Polytechnique des Hauts de France, membre associé au laboratoire ACP)
L’industrialisation n’apparaît pas comme un processus brutal et univoque mais un phénomène complexe aux dimensions économiques, sociales et politiques. En étudiant deux textes, le premier de 1864 de l’entrepreneur belge Charles De Poorter et le second de 1867 du journaliste français Maurice Cristal, favorables à la pluriactivité dans les campagnes françaises, afin de constituer un lien entre le monde rural et urbain tout en régulant les rapports sociaux. Ainsi, dans les années 1860, comme le démontrent Didier Terrier et Mohamed Kasdi, le sort de l’industrie rurale est loin d’être scellé, sous le Second Empire, dans sa période dite libérale. Entre l’image que l’Empire libéral se donne (un régime soucieux de moderniser à grands pas la production industrielle en promouvant la concentration et la mécanisation des fabrications) et la réalité du pays (un partage des tâches productives entre villes et campagnes dans le textile encore plus vivace qu’on ne veut bien le dire), il existe un hiatus de taille.
I-2/ Fabrique collective et travail indépendant : l’autonomie ouvrière en question au tournant des XIXe et XXe siècle : (p. 39-50)
Julien CARANTON (Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Grenoble Alpes, LARHRA)
Les changements organisationnels qui président à la mise en place de la fabrication en série et de la rationalisation doivent être envisagés sur le temps long. Loin d’être déterminées par les évolutions technologiques, les formes d’organisation du travail sont constamment débattues, défendues ou combattues. Elles sont diversement appréciées en fonction de jugements moraux mais aussi de considérations politiques ou tactiques. Comme le montre Julien Caranton, la préface de Jean Jaurès (à une thèse d’économie de 1903, rédigée par Léon Côte, sur l’industrie gantière à Grenoble) critique vivement le système de la fabrique collective et le travail indépendant, estimant que l’amélioration des conditions de travail passe par la généralisation du salariat au sein du système usinier. Dans les années 1920, les industriels du textile utilisent le travail à domicile pour briser les mouvements sociaux et contourner la législation du travail, notamment la mise en place de la journée de huit heures. Pour autant, l’attention portée au temps long et aux permanences n’exclut pas d’interroger le rôle des crises, notamment la Grande Dépression de 1929 et la Première Guerre mondiale, qui contribuent à accélérer la diffusion de nouveaux modes d’organisation du travail.
I-3/ La production en série dans l’industrie armurière belge : (p. 51-60)
Éric GEERKENS (Professeur d’histoire à l’université de Liège, UR Traverses)
En présentant deux textes émanant de deux dirigeants de la Fabrique Nationale d’armes de guerre de Belgique (le premier de Joseph Chantraine datant de 1892 et le second de René Laloux de 1930), Éric Gerkeens note que les « travaux de force » justifient dans les conventions collectives une majoration de salaire pour les hommes. La contribution d’Éric Gerkeens rappelle que le « travail réel » des ouvrières, comme les compétences nécessaires pour l’accomplir, sont largement ignorés, justifiant une infériorisation de leur rémunération. Cette situation perdure jusqu’en 1966, quand les ouvrières de la FN mènent une grève de douze semaines pour obtenir l’application du principe « à travail égal, salaire égal », en référence à l’article 119 du Traité de Rome ; dans cette entreprise au très fort taux de syndicalisation, les ouvrières se lancent dans ce combat sans le soutien initial des organisations syndicales. Cette grève, au retentissement européen, leur apporte une victoire tant symbolique que matérielle. Il faudra toutefois attendre une seconde grève des femmes dans cette entreprise, en 1974, pour que des perspectives de promotion interne par la formation soient ouvertes aux femmes.
II. Conditions de vie et de travail des mains-d’œuvre ouvrières : (p. 61-180)
De récents travaux renouvellent en profondeur l’histoire du temps de travail, de sa durée, de son rythme et de son intensité. Dans la deuxième partie du dossier composée de huit contributions, sont abordées les conditions de travail et de vie de la main-d’œuvre industrielle dont les sources commentées ici révèlent l’extraordinaire diversité des statuts (ouvriers, compagnons, tâcherons, apprentis, contremaîtres, ingénieurs, maîtres, etc.) qui la composent. Non seulement la figure de l’ouvrier est multiple mais toutes les mains-d’œuvre industrielles ne sont pas ouvrières. Ces statuts restent longtemps poreux – dans la ganterie grenobloise par exemple, le petit patron est un « ouvrier-chef d’équipe » – ce qui peut favoriser des formes de mobilités sociales et géographiques. À domicile, à l’atelier ou à l’usine, ouvrières et ouvriers n’effectuent pas les mêmes tâches, et travaillent parfois dans des espaces séparés. Le dossier donne, enfin, un aperçu de la pluralité et de l’évolution des formes d’organisation du mouvement ouvrier.
II-4/ Pratiques de la réclamation du prix du travail : différends autour des rémunérations des tisseurs et des tisseuses en soie de Lyon au début des années 1830 : (p. 63-78)
Manuela MARTINI (Professeur d’histoire contemporaine, Université Lumière de Lyon 2, LARHRA et Institut Universitaire de France)
Manuela Martini présente la séance (du 16 février 1832) du Conseil des Prud’hommes de Lyon, via le périodique ouvrier L’Écho de la Fabrique. Les résumés de ces audiences ici présentés pour Lyon en 1832 permettent de saisir les éléments essentiels de la négociation autour du prix du travail dans une période particulièrement intense en termes de tensions sociales de l’histoire de l’industrie de la soie lyonnaise. La rémunération à la pièce s’accompagne de négociations marquées par l’asymétrie des relations sociales. En s’adressant aux Prud’hommes pour la résolution d’affaires ordinaires autour du respect du contrat ou de la rémunération convenue, les demanderesses et les demandeurs ouvriers signifient le besoin d’être reconnus en tant que porteurs de requêtes spécifiques. Le nombre croissant des affaires traitées par les Prud’hommes est révélateur d’une confiance dans la fonction d’arbitrage et de conciliation qui est au cœur de leur mission et qui, pendant cette période, prend une importance toute particulière.
II-5/ Londres, 10 avril 1848 : les chartistes dans l’œil du daguerréotypiste : (p. 79-100)
Fabrice BENSIMON (Professeur d’histoire de la Grande-Bretagne, Sorbonne Université, Centre d’histoire du XIXe siècle)
À travers deux daguerréotypes qui donnent à voir le rassemblement chartiste de Londres, du 10 avril 1848, la contribution de Fabrice Bensimon souligne les liens entre le chartisme, premier mouvement politique de masse, et les travailleurs des métiers artisanaux urbains qui voient dans la réforme politique la solution à la question sociale anglaise. L’auteur montre que le 10 avril 1848 ne marque pas la fin du mouvement chartiste. Certes, le pays ne connaît pas de révolution. Pendant plusieurs mois, le chartisme continue de se mobiliser et d’inquiéter le pouvoir, qui recourt aux arrestations et à la déportation pénitentiaire de plusieurs de ses militants. Puis, le mouvement décline jusqu’à sa fin, en 1858. En 1852, sous la pression de la bourgeoisie locale, Kennington Common a été transformé en parc « civilisé », dans une finalité de loisir récréatif.
II-6/ Travail, immigration et nation. L’expulsion des mineurs belges à Liévin et Lens en 1892, à travers les sources judiciaires et la presse socialiste : (p. 101-116)
Bastien CABOT (Professeur agrégé, Doctorant à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS / Cespra / Tepsis)
L’énoncé analysé par Bastien Cabot « la mine aux mineurs » traduit une aspiration à décider de l’embauche et relève là encore du contrôle ouvrier. Entre le 15 août et le 21 septembre 1892, une intense agitation anti-Belge traverse le bassin houiller du Pas-de-Calais. Ces derniers sont pris pour cible par des émeutiers qui brisent les vitres de leurs habitations, les prennent à partie verbalement et, parfois, physiquement, et conduisent au départ d’environ mille personnes – le tout dans un mouvement d’une apparente spontanéité, sans aucun encadrement syndical, politique ou idéologique. Les deux documents présentés ici offrent un témoignage au « ras du sol » des événements qui permet un regard nuancé sur les lignes de fracture qui traversent les mondes ouvriers. Le premier est composé d’extraits de la correspondance entre le procureur général du tribunal de Douai et le garde des Sceaux, Louis Ricard, conservée comme pièces à conviction dans le dossier de demande en grâce d’Oscar Milville, auprès du président de la République Sadi Carnot. Le second est constitué de deux extraits d’articles du Réveil du Nord, journal quotidien qui fait office de tribune socialiste républicaine dans le Nord-Pas-de-Calais, relatant des réunions tenues à Liévin par des représentants du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, et notamment par Émile Basly, directeur du syndicat et député de la circonscription minière. D’une certaine manière, les événements de 1892 viennent sanctionner le processus d’« enracinement national prolétarien » des travailleurs français depuis les années 1830, mis en évidence par l’historien Pierre-Jacques Derainne. Toutefois, à la différence des troubles xénophobes qui se sont manifestés jusque-là, ceux de 1892 mettent en évidence l’articulation entre la nationalité et les capacités politiques offertes aux ouvriers par la citoyenneté. L’idéal de « République industrielle », cher notamment à Jean Jaurès, se transmue alors, dans un contexte de « nationalisation du monde social », selon la formule de l’historien Gérard Noiriel, en un épisode douloureux qui met à mal un autre idéal du mouvement ouvrier, celui de l’internationalisme prolétarien.
II-7/ Contre le travail de nuit des enfants dans les verreries (L’Humanité, 1909) : (p. 117-128)
Nicolas HATZFELD (Professeur des universités en histoire contemporaine, Université d’Évry – Paris Saclay, IDHES)
Présenté par Nicolas Hatzfeld, cet article est publié le 11 juin 1909 dans L’Humanité, « journal socialiste quotidien » dirigé par Jean Jaurès depuis sa fondation, cinq ans plus tôt (1904). Il est écrit par Léon et Maurice Bonneff, généralement associés dans leur activité journalistique. Dans cet article, les frères Bonneff annoncent le lancement d’une campagne publique à venir dans L’Humanité, en liaison avec l’action des syndicats de la verrerie : l’intervention dans l’opinion publique rejoint l’action institutionnelle. La thématique est, de fait, duale, et combine la lutte contre le travail de nuit avec le combat contre la surexploitation des enfants. Le point de rencontre de ces thèmes, l’interdiction du travail de nuit imposé aux enfants dans de nombreuses verreries, est propre à recueillir un assentiment relativement large, au temps de la généralisation de l’enseignement primaire, de la préoccupation démographique et de certains progrès de l’hygiénisme dans la société française.
II-8/ Des ouvriers écrivent au patron d’une rubanerie normande (1912-1921) : (p. 129-142)
Michel PIGENET (Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonnne, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains)
Les dix-sept lettres et simples mots réunis ont été rédigés par des ouvrières et des ouvriers. Adressés à Juste-Victor Schneider (1880-1945), chef d’une entreprise normande de rubanerie installée dans l’Eure, ils ont été écrits entre 1912 et 1921. Tirés du riche « fonds Schneider, rubanerie à Menneval » déposé en 1988 aux Archives départementales de l’Eure, ils ne constituent qu’une petite partie des 327 courriers retrouvés dans les classeurs commerciaux des clients de l’entreprise. La rémunération du travail connaît des évolutions majeures : rémunérés à façon, à la tâche ou à la pièce, les ouvriers sont ensuite payés au temps – suivant leur qualification ou le poste qu’ils occupent – mais aussi au rendement. Quelle que soit sa forme, elle est débattue et parfois négociée. Les employés de l’usine de ruban, dont Michel Pigenet étudie la correspondance, raisonnent en termes de minimum vital et demandent une rémunération qui leur permette de vivre dignement. Les barèmes des conventions collectives manifestent un compromis sur les hiérarchies et les inégalités que les uns et les autres jugent acceptables. Les critères pris en compte pour fixer le « prix du travail » – qui ne se réduit pas au salaire – sont indéniablement genrés.
II-9/ Mains-d’œuvre et travail pendant la Grande Guerre : pratiques et représentations : (p. 143-154)
Adeline BLASZKIEWICZ-MAISON (Doctorante et ATER en histoire contemporaine, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonnne, CHSMC)
Le premier document est un discours prononcé par le sous-secrétaire d’État, militant et député socialiste de la Seine Albert Thomas (1878-1932), devant les ouvriers et les industriels de l’usine Schneider du Creusot le 17 avril 1916, alors que la bataille de Verdun (février-décembre 1916) bat son plein. Le deuxième document n’est pas destiné à une si large publicité. Il s’agit d’une note de service interne du Service ouvrier, revenant sur ses missions et son contexte de création. Ce service, chargé du recrutement et du contrôle de la main-d’œuvre employée dans les usines de la défense nationale, est créé dès juin 1915 et géré par le chef de Cabinet d’Albert Thomas qui en assure ainsi le contrôle direct, signe de l’importance stratégique de l’épineuse question des mains-d’œuvre en guerre. Le troisième document est la couverture d’un journal satirique illustré en date du 31 juillet 1915 mettant en scène Albert Thomas et Alexandre Millerand, ministre de la Guerre, pointant du doigt les contradictions de la mobilisation industrielle au service de défense nationale présentée comme seule garante de la paix future. Comme l’évoque la contribution d’Adeline Blaszkiewicz-Maison, le corpus soulève le caractère stratégique de la main-d’œuvre industrielle employée dans les usines d’armement durant la Première Guerre mondiale. Du fait du caractère limité des ressources humaines, occupées sur les deux « fronts », la France opte pour une centralisation du placement, une militarisation d’une partie des ouvriers et une diversification des catégories de mains-d’œuvre employées. Le corpus est au croisement des représentations et des pratiques du travail soumises à l’épreuve d’une guerre industrielle sans précédent dans l’histoire. L’héroïsation du travail des ouvrières et ouvriers dans les usines de guerre est à la mesure de la dégradation des conditions de travail causée par une volonté de rendement maximal. De ce point de vue, la guerre doit être perçue comme une parenthèse dans le processus de construction de la législation française sur le travail. Mais elle est, en même temps, un laboratoire d’innovations sociales et économiques, dont la politique menée par le ministère de l’Armement en charge des questions de mains-d’œuvre est l’illustration.
II-10/ Le chef dans l’entreprise industrielle. Notes sur l’invention du manager en Italie dans l’entre-deux-guerres : (p. 155-166)
Ferruccio RICCIARDI (Chargé de recherche en histoire, Lise-CNAM / CNRS)
Cet extrait est tiré de l’ouvrage Il capo nell’azienda industriale (« Le chef dans l’entreprise industrielle ») écrit en 1941 par l’homme d’affaires et intellectuel Francesco Mauro (1887-1952) à la suite d’une expérience pluriannuelle dans le domaine de la gestion de l’entreprise, à la fois comme praticien et comme théoricien. Dans l’usine ou dans les ateliers, enfin, les mains-d’œuvre ne sont pas seules à travailler. Il existe aussi un travail des patrons que ce dossier peut contribuer à éclairer : ceux-ci embauchent et débauchent les mains-d’œuvre, s’emploient à les retenir, choisissent les matières premières et l’outillage, assurent l’écoulement des produits ou la promotion de l’entreprise, etc. À en croire l’historien Denis Poulot, l’ampleur de la tâche est telle que « diriger des travailleurs n’est pas seulement pénible, c’est décourageant ». La contribution de Ferruccio Ricciardi montre, ainsi, que le taylorisme conduit à expliciter les missions et les tâches du « chef », comme à réfléchir aux fondements moraux de son autorité. Le référentiel états-unien, en l’occurrence le modèle taylorien, n’est pourtant qu’une parmi les différentes sources d’inspiration à disposition de ces chefs. Le document ici examiné en est un exemple. L’auteur, Francesco Mauro, s’efforce de conjuguer la leçon de ceux qui sont désormais considérés comme les pères fondateurs de la science managériale : Taylor et Fayol. Il y voit la possibilité de combiner l’organisation du travail ouvrier dans les ateliers avec l’action de coordination et de contrôle menée par la direction générale, véritable « cerveau » de l’entreprise.
II-11/ Conditions de vie et relations sociales dans les « colonies industrielles » de Catalogne à la fin du XIXe siècle : (p. 167-180)
Céline VAZ (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université Polytechnique des Hauts de France de Valenciennes / CRISS)
Dans un article au titre évocateur, « Le féodalisme dans les usines », publié le 7 mai 1891 dans La Publicidad, quotidien de Barcelone de tendance républicaine, l’écrivain et journaliste Luis Morote (1864-1913) jette, pour la première fois, un éclairage cru sur les relations économiques et sociales caractérisant ce système de production alors en pleine maturité. Il y décrit des conditions de vie et de travail abrutissantes, qu’il a pu observer lors d’un reportage mené dans plusieurs colonies industrielles, et dénonce l’asservissement des ouvriers et les abus de patrons tout-puissants. Dans les « colonies industrielles catalanes » étudiées par Céline Vaz, l’insalubrité des logements édifiés par les industriels dégrade encore la santé des travailleurs. Pourtant annoncée, la suite de cette enquête ne parut jamais, preuve, s’il en fallait, du poids économique et politique, tant local que national, des industriels du coton catalans. Si les colonies industrielles catalanes présentent des particularités, les conditions de travail et les relations de domination économique et sociale qui y ont cours ne semblent cependant ni pires ni meilleures que celles observables alors dans les villages ou villes-usines d’autres pays de l’Europe industrielle.
III. Travail et question sociale : (p. 181-298)
L’industrialisation génère, par conséquent, des maux et des tensions. Avec neuf articles, la troisième et dernière partie du dossier s’intéresse à la formulation de la question sociale ainsi qu’à sa résolution.
III-12/ Taxer les machines ? Trois pétitions de travailleurs au Parlement britannique (1830-1833) : (p. 183-194)
François JARRIGE (Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Bourgogne, LIR3S)
Ces trois documents sont des pétitions adressées à la Chambre des communes par des groupes ouvriers très différents, situés dans l’Est rural et agricole et le Nord industriel et cotonnier du Pays. Les « compagnons papetiers » du comté de Norfolk en premier lieu, comté majoritairement rural formant la partie septentrionale de la région d’East Anglia, écrivent en mai 1830. Le 1er avril 1833, ce sont les travailleurs agricoles de Stoke Holy Cross, petit village au sud du Norfolk, à proximité de Norwich, qui pétitionnent. Le troisième document date du 19 juillet 1831 et émane des « tisserands et autres de Padiham ». Padiham est alors une petite commune sur la rivière Calder, à environ 3 miles de la ville de Burnley dans le Lancashire, au cœur d’une grande région cotonnière qui expérimente à la fois l’expansion de l’industrie textile et une grave crise conjoncturelle. Cette autonomie présente de multiples déclinaisons : les machines sont perçues par les ouvriers comme une menace sur la maîtrise qu’ils avaient du progrès et du rythme de travail, et, par-là, sur le recrutement de la main-d’œuvre, nous rappelle François Jarrige. Alors que des émeutes et désordres traversent le pays, les pétitions du début des années 1830 offrent à la fois un exutoire aux attentes et aux colères populaires, tout en étant de puissants vecteurs de mobilisation qui accompagnent par les mots d’autres pratiques moins visibles. On ne connaît pas précisément l’écho de ces pétitions, mais elles ne furent pas suivies d’effets directs. Si les pouvoirs publics britanniques étaient soucieux de maintenir la légalité et la crédibilité des procédures pétitionnaires afin de montrer qu’ils étaient à l’écoute du pays et des classes populaires dans un contexte marqué par de nombreuses contestations sociopolitiques, les revendications en faveur d’une taxation des machines apparaissent néanmoins de moins en moins crédibles au cours des années 1830.
III-13/ Un catholique libéral dans le débat parlementaire sur le travail des enfants dans l’industrie (1840) : (p. 195-206)
Claire LEMERCIER (Directrice de recherche au CNRS, CSO-Sciences-Po Paris)
La loi du 22 mars 1841 concernant le travail des enfants est souvent présentée comme la première loi sociale française (l’expression « loi sociale » n’était pas utilisée à l’époque). En effet, elle pose des restrictions à l’emploi d’enfants : ils ne doivent pas avoir moins de 8 ans et, jusqu’à 16 ans, leurs horaires de travail sont limités. En outre, jusqu’à 12 ans, ils doivent aller à l’école en parallèle. La loi de 1841 sur le travail des femmes et des enfants ne concerne que les usines et les ateliers de plus de 20 ouvriers. Claire Lemercier rappelle que l’inspiration chrétienne est présente chez une bonne partie des industriels partisans d’une réglementation du travail des enfants, en France comme en Angleterre. C’est ainsi sur la base de longs débats qui mettent en circulation à la fois des arguments chiffrés et des appels à l’émotion que le travail des enfants dans la grande industrie est devenu intolérable dans les années 1830, pour des élites dont l’engagement politique sur le sujet s’appuie parfois, mais pas toujours, sur leur religion. Dans la seconde moitié du siècle, les mêmes types d’arguments insistant sur la santé à la fois physique et morale sont progressivement appliqués à d’autres types de travail des enfants, mais aussi des femmes. Le travail agricole reste toutefois l’exception : la loi de 1874 étend les protections aux plus petits ateliers, mais seulement dans « l’industrie ».
III-14/ L’encadrement religieux au Val-des-Bois : les Filles de la Charité dans l’usine chrétienne de la famille Harmel (années 1860-1870) : (p. 207-220)
Anne JUSSEAUME (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université d’Artois / CREHS)
Le premier document est un extrait du compte rendu d’une visite régulière effectuée par l’une des sœurs officières de la congrégation dans l’établissement nouvellement fondé. Consigné dans le registre des visites régulières qui dresse le compte rendu des activités en œuvre en 1864, il reste destiné à un usage interne à la congrégation. Un peu plus de dix ans plus tard, celui-ci décrit l’organisation de l’usine dans son Manuel d’une corporation chrétienne (1877), dont nous avons ici un extrait de l’introduction et du chapitre sur l’organisation du service charitable. Cet ouvrage, véritable guide à l’usage d’autres patrons, formalise la pensée de Léon Harmel et s’inscrit dans un ensemble plus vaste de publications et de conférences – il intervient régulièrement à l’Union des œuvres catholiques ouvrières à partir de 1872 où il remporte un franc succès et s’affirme comme un patron « modèle et idéal » – destinées à faire connaître son système censé résoudre le problème ouvrier. Comprendre la conflictualité exige d’inclure les stratégies patronales dans l’analyse et de ne pas s’en tenir au seul point de vue ouvrier. De fait, si le dossier ne comporte qu’une seule contribution portant spécifiquement sur le patronat, celui-ci est abordé dans de nombreuses sources qui invitent à prendre en compte sa diversité interne, la variété et l’évolution des pratiques et des politiques qu’il déploie : le paternalisme, la répression ou encore la négociation collective. Cette « corporation chrétienne » au Val-des-Bois développée par les Harmel dans le dernier tiers du XIXe siècle constitue une forme de « phalanstère chrétien » et fait de Léon Harmel une des figures de proue du catholicisme social, engagé tant dans les œuvres religieuses que pour le développement du syndicalisme chrétien et dans la démocratie chrétienne. Le système Harmel que ces documents permettent d’entrevoir constitue une synthèse originale du catholicisme social, imbriquant à la fois des pratiques charitables pour répondre aux problèmes de l’industrialisation, des activités de congrégations soignantes et des organisations patronales. Le cas de Léon Harmel, dont Anne Jusseaume présente les œuvres, figure emblématique du patronat catholique, membre du tiers-ordre franciscain et ami personnel du Pape Léon XIII, souligne l’influence de la doctrine sociale de l’Église sur l’action patronale.
III-15/ Transformer la condition des ouvrières et des ouvriers : le programme d’Erfurt de 1891 de la social-démocratie allemande : (p. 221-232)
Jean-Numa DUCANGE (Professeur d’histoire contemporaine, Université de Rouen, GRHIS, Institut Universitaire de France)
Le programme du Parti social-démocrate allemand de 1891 est un des plus connus de l’histoire du SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; Parti social-démocrate d’Allemagne). En effet, ce programme, qui contient de nombreuses revendications relatives à l’amélioration des conditions matérielles des ouvrières et des ouvriers, sert de base à l’agitation politique et sociale du milieu social-démocrate jusqu’aux lendemains de la Première Guerre mondiale. Comme le relève Jean-Numa Ducange, le réformisme exprimé par les sociaux-démocrates allemands à Erfurt en 1891 – qui est aussi celui du syndicalisme des mineurs – n’appelle pas au renversement de l’État mais considère la conquête de celui-ci comme la voie majeure d’amélioration de la condition ouvrière. Pour qui s’intéresse à la question de l’histoire sociale du travail, le cas du SPD d’Erfurt représente un cas d’école particulièrement significatif. Il incarne à la fois les espoirs messianiques d’une révolution sociale qui a traversé des franges importantes des mondes artisanaux et ouvriers tout au long du XIXe siècle et jusqu’à l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir. En même temps, soucieux de peser sur la situation présente, il a proposé à travers ses programmes politiques des revendications immédiates concernant le travail quotidien des ouvriers pour proposer au vaste milieu qu’il représentait des perspectives immédiates. Son histoire a été traversée par de nombreuses controverses, notamment sur les modes d’action que devaient employer les ouvriers pour leur émancipation.
III-16/ Portraits grinçants de la céruse en assassin dans L’Assiette au beurre (1905) : (p. 233-244)
Judith RAINHORN (Professeure d’histoire contemporaine, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonnne, CHS, Maison française d’Oxford)
Les deux documents iconographiques proposés sont issus du journal hebdomadaire illustré L’Assiette au beurre, fondé en 1901, qui s’est rapidement imposé dans le paysage de la presse satirique de la Belle Époque, proposant une critique mordante de la société et des valeurs bourgeoises comme de toutes les formes d’autorité. Au début du XXe siècle, l’ouvrier cérusier est devenu, avec le peintre en bâtiment qui fait un usage quotidien de céruse, la figure emblématique de l’homme broyé par son travail. L’humour grinçant de L’Assiette au beurre renvoie dos à dos toutes les composantes de la société bourgeoise complices de l’empoisonnement collectif des ouvriers par des patrons cruels et cyniques. Par la virulence de la dénonciation et l’ironie mordante dont ils sont porteurs, ces œuvres artistiques et politiques produisent un message immédiatement lisible à l’efficacité politique redoutable : ils contribuent à l’ensemble des discours, articles, prises de parole qui, au cours de la décennie 1900, sensibilisent l’opinion publique en faveur d’une interdiction de la peinture au plomb, malgré de fortes résistances patronales et politiques. Le 20 juillet 1909, après quelques années supplémentaires de débats et de contre-offensives au parlement, la loi prohibe l’usage de la céruse dans la peinture, faisant de la France la nation la plus précoce en matière de manipulation des toxiques au travail. Les ouvriers ont gagné une bataille, ils n’ont cependant pas gagné la guerre : il faudra plus d’une loi pour abattre le blanc poison et donner une existence légale aux maladies professionnelles.
III-17/ La représentation du travail par la photographie au sein des fonds d’entreprises conservés aux Archives nationales du monde du travail : des sources atypiques : (p. 245-256)
Gersende PIERNAS (Archives nationales du monde du travail, Département Archives d’entreprises)
Les deux photographies sont issues du fonds du bureau d’études de procédés de construction Pelnard Considère et Caquot déposé aux Archives nationales du monde du travail en 1994 par l’Institut français d’architecture. Elles sont réalisées par le photographe du bureau d’études afin d’illustrer deux chantiers d’ouvrages, à savoir un pont et un barrage, achevés en France dans deux départements différents, l’Aisne et la Manche Elles font partie d’un album destiné à suivre l’évolution du chantier. La photographie de ces chantiers permet à la fois d’appréhender les conditions de travail des ouvriers à cette époque et de comprendre l’enjeu de la photographie pour les entreprises. Elle constitue une typologie documentaire immédiate mais d’emblée orientée par la technique du procédé et les objectifs du patron. Elle doit être complétée par d’autres sources comme les images animées, les rapports d’inspection du travail, les registres d’accident du travail et les documents de revendications du personnel.
III-18/ Antonio Gramsci, les grèves à la FIAT et les conseils d’usine durant le bienno rosso :
(p. 257-268)
Frédéric ATTAL (Professeur d’histoire contemporaine, Université Polytechnique des Hauts de France, CRISS)
Bien que non signé, l’article « In linea » publié le 14 avril 1920 dans l’Avanti ! quotidien du Parti socialiste italien, a très probablement été écrit par Antonio Gramsci. Il fait partie des nombreuses publications de l’un des futurs cofondateurs du Parti communiste d’Italie, exhumées dans un ouvrage récent recensant tous les articles, éditoriaux, entrefilets et autres écrits non signés mais attribués avec certitude à Antonio Gramsci. Pour ce dernier, Agnelli et les patrons métallurgiques, par leur politique productiviste à outrance, de concentration industrielle, leur rôle d’accélérateur de la transformation sociale (déclin du monde rural, généralisation du salariat, prolétarisation) sont les instruments inconscients de la révolution ouvrière. La division d’un monde ouvrier plus hétérogène qu’il n’y paraissait (différences régionales) et les conflits politiques entre réformistes et révolutionnaires ont empêché que les rêves de Gramsci de déstabilisation de l’ordre capitaliste se réalisent. Tout au contraire, la peur des soviets, bien que le danger soit écarté, crée les conditions de l’arrivée du fascisme au pouvoir.
III-19/ La « Loi sur l’organisation du travail national ». Un nouveau monde du travail sous le Troisième Reich ?: (p. 269-284)
Charlotte SORIA ((Doctorante à Sorbonnne Université, Sirice)
La loi sur l’organisation du travail national (Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit), adoptée par le cabinet du chancelier Adolf Hitler, le 20 janvier 1934, entra en vigueur le 1er mai 1934, jour officiel de la « fête nationale du travail » depuis 1933. Dès cette année, le monde du travail allemand avait radicalement changé et le droit du travail joua un rôle structurant dans la formation du projet social national-socialiste qui visait la création d’une « Communauté du peuple » nationale-raciste libérée des conflits de classe. Plus fondamentalement, la question que pose cette analyse est celle du primat à donner dans cette évolution à l’économique ou au politique. Or, il nous faut souligner que, si les acteurs décisionnels du droit du travail national-socialiste, furent favorables aux employeurs, ils ne le furent que dans la mesure où ces derniers servaient les objectifs politiques du Troisième Reich, le réarmement et l’autarcie jusqu’à 1939, la création d’une « Communauté du peuple » nationale-raciste au sein d’un vaste « espace vital » par la suite. Des objectifs qui faisaient alors consensus à la tête de l’État. Adopter une lecture faisant du nazisme un fascisme asservi aux intérêts de la grande industrie allemande pour en analyser les origines et le développement aboutirait donc à en atténuer la charge idéologique, tandis qu’une interprétation totalitaire effacerait la polycratie au cœur du régime et à l’œuvre dans sa radicalisation. Enfin, si la Politique fut au cœur de la dynamique sociale du régime, cela signifie que des pans entiers de la société allemande adhérèrent ou participèrent au projet de Volksgemeinschaft.
III-20/ L’impact des conventions collectives sur la condition ouvrière et les relations industrielles : l’exemple du Front populaire : (p. 285-298)
Laure MACHU (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université de Paris-Nanterre, IDHES)
Dans ce mouvement d’ensemble, la convention collective de la métallurgie parisienne est importante à plusieurs titres. Premier texte signé, quelques jours à peine après l’Accord Matignon, elle est envoyée par le ministère du Travail à ses inspecteurs, et, de fait, de nombreux textes s’en inspirent. Elle fait ainsi figure de convention modèle d’autant que la puissante Union des Industries métallurgiques et minières, dont le Groupe des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne est membre, définit la ligne de l’ensemble du patronat en matière de politique sociale. Revenir sur le texte conclu dans la métallurgie, le 12 juin 1936, permet donc de comprendre la manière dont les acteurs se sont saisis de la convention collective, ainsi que la portée des accords conclus. L’analyse de la convention collective de la métallurgie permet de comprendre la signification et la portée des accords conclus durant le Front populaire. En décalage avec les attentes manifestées par certains, la convention échoue à instaurer le contrôle ouvrier sur les conditions de travail comme à pacifier les relations industrielles. Relevant les salaires, elle marque une nette amélioration des conditions de travail. Mais elle n’élimine pas la fatigue que représente l’intensification du travail. La contribution la plus sûre et la plus durable demeure la construction d’un ordre salarial fondé sur la qualification, le sexe et l’âge.
© Les Clionautes (Jean-François Bérel pour La Cliothèque)