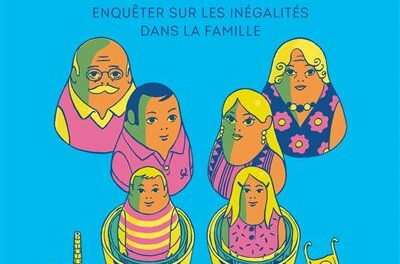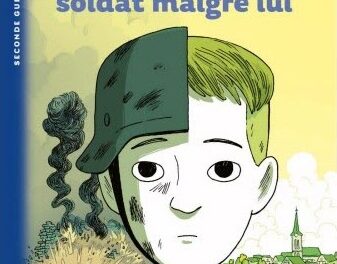Ce livre est en fait une description des dernières évolutions de la théorie économique, qui précisent tel ou tel point du libéralisme et notamment la gestion de « la lutte des classes » par la démocratie. Son mérite est de l’exposer de manière simple. On peut être d’accord ou non, mais sa lecture est utile à la réflexion sur les mécanismes à long terme de notre économie et de celle du monde. Les allergiques au terme « libéral » peuvent sauter les deux premières parties et aller directement à la « théorie des institutions », voire à celle sur les universités.
L’ouvrage commence par un rappel des catastrophes engendrées par les mauvaises politiques économiques, comprenez communistes, socialistes ou hyper dirigistes, et dont la liste est très longue, alors qu’à l’inverse les « bonnes politiques économiques » ont permis la reconstruction de l’Europe de l’Ouest puis celles de l’Inde, de la Chine, sans parler du Japon, de la Corée, de la Turquie,…
Le libéralisme contemporain
L’essentiel de la théorie libérale a été élaboré avant les années 70 et a bien préfiguré ce qu’ont été leurs applications et leurs succès d’ensemble à partir de 1980. En fait les critiques du libéralisme viennent d’un malentendu ou d’une ignorance sur le terme, ce qui est attaqué n’étant pas ce qui se pratique ou devrait se pratiquer. Plutôt que de se battre sur le mot « libéralisme » il vaudrait mieux utiliser la formule « ordre spontané » s’opposant à un « ordre décrété » qui ne peut faire face à la complexité du monde. L’Etat ou les institutions internationales se devraient donc se borner à être garants des règles, ce qui est déjà un rôle considérable. Des discussions sérieuses ont maintenant lieu à l’intérieur du système libéral et non plus à propos d’éventuelles alternatives. On ne voit pas bien lesquelles d’ailleurs.
Travailler plus …
Concernant les dernières évolutions de la théorie, Guy Sorman présente celle d’Edward Prescott, américain prix Nobel 2004, qui insiste tout bêtement sur l’importance de la quantité de travail : l’Europe a rattrapé les États-Unis après la deuxième guerre mondiale en travaillant plus qu’eux, et se fait de nouveau distancer par eux en travaillant moins. La cause de ce moindre choix pour le travail vient du fait que l’imposition des Européens a été plus faible, puis plus forte que celle des Américains pendant cette période. Prescott remonte pour cela à Jean-Baptiste Say, précurseur de la théorie de l’offre. Plusieurs exemples sont proposés, du financement des retraites, à la prolongation de la crise de 1929 par Roosevelt via le « New Deal », et en France par Léon Blum, avec les mesures du Front populaire. Disons que ces deux points, qui peuvent mériter discussion, ne figurent pas vraiment dans les programmes français.
La théorie des institutions
L’auteur passe alors à une autre « avancée », celle peaufinant la « théorie des institutions » : la croissance à long terme vient de la nature des institutions, particulièrement celles mises au point en Europe et Amérique (évoquées dans ce livre par le terme « État de droit »). Inde et Chine s’en inspirent aujourd’hui (très partiellement dans ce dernier cas), longtemps après les Japonais. Dans tous les cas, c’est l’histoire longue qui détermine la richesse ou la pauvreté, via les valeurs religieuses pour les uns, via l’histoire plus matérielle pour les autres, et notamment les héritages institutionnels (positifs dans ce contexte) de la colonisation.
Un exemple tout à fait intéressant, est celui des institutions commerciales et étatiques mis en place par les Génois dans leur commerce avec les musulmans : ayant le même problème à traiter, les commerçants du nord on choisi la voie institutionnelle, alors que ceux du Sud en sont restés à la solidarité familiale, notion sympathique mais qui paralyse aujourd’hui l’Afrique subsaharienne. Autrement dit, en économie, mieux vaut des individus librement liés entre eux par des contrats que des communautés soudées par le sang.
Le rôle de la démocratie
Les institutions sont historiquement influencées par la « lutte des classes ». La façon dont cette lutte est arbitrée, par exemple en démocratie, explique le plus ou moins grand succès économique. L’histoire de l’Angleterre et sa démocratisation progressive n’est qu’une suite d’arbitrages fait par les élites entre leurs intérêts propres et les « sacrifices » à faire en accordant plus de libertés, et donc d’avantages matériels, aux moins favorisés. Inversement la « dé-démocratisation » de l’Argentine explique le recul de ce pays qui était il y a un siècle plus riche que l’Europe. Les exemples de Singapour, du Chili, de l’île Maurice, éclairent le débat. Si le développement peut avoir lieu dans un système autoritaire aussi bien que démocratique, ce dernier redistribue plus largement le bénéfice du développement (Corée contre Chine par exemple). Un essai de quantification de cette théorie des institutions par la Banque Mondiale montre que le développement vient à 57% l’Etat de droit et à 37% de l’éducation. Les résultats de cette mesure sont en corrélation avec l’observation courante, avec la Suisse au sommet et le Nigeria en queue. Une autre formulation est « qu’il n’y a pas d’économie de marché sans garant, et que le meilleur garant est l’Etat. Mais qu’il convient que ce coût de l’Etat soit le moins élevé possible, du fait de ses dépenses et surtout du fait de ses erreurs ».
L’auteur rappelle que la grande réussite du F.M.I est la création quasi universelle de banques centrales indépendantes, tandis que son échec relatif est celui de banquier pour nations en péril, accordant des prêts politiques permettant à des régimes inefficaces de survivre plus longtemps. L’exemple le plus célèbre est celui de l’URSS de 1986. À cette occasion, on trouve un passage intéressant sur le rôle, ou plutôt l’absence de rôle, de la « force » ou de la « faiblesse » d’une monnaie. Cela donne un autre éclairage de la catastrophe argentine, tout à fait complémentaire du premier.
L’auteur affirme également que si le Yuan ne remplace pas le dollar, c’est tout simplement qu’il n’est pas convertible. La Chine pourrait le faire, mais elle donnerait ainsi la liberté de placement de l’épargne à ses citoyens dans le monde entier, ce à quoi elle ne tient pas, pour des raisons de contrôle politique.
La mondialisation
Vient une analyse récente la mondialisation, cette fois par un Américain d’origine indienne, Jagdish Bhagwati. Ce dernier commence par minimiser l’effet négatif de la fuite des cerveaux, qui suscitent des communautés qualifiées en exil, accumulant des savoirs et créant des réseaux. Les pays de départ en profitent et, lorsqu’ils adoptent une bonne politique, on voit revenir les dits « cerveaux » au pays natal : voir les exemples indiens et chinois.
Malgré l’échec répété de tous les pays qui ont quitté le libre commerce mondial, les mythes hostiles au libre-échange persistent. Le «péril jaune », chinois cette fois, revient comme en 1930 où l’on disait que le Japon allait ruiner l’Europe. Comme pour le libéralisme en général la discussion entre économistes vise les modalités de la mondialisation et non pas son principe, dont le résultat est indiscutable.
Innovation, idées, enseignement
L’auteur traite enfin de l’innovation et plus généralement de la production des idées. Le rôle fondamental est initié des Etats-Unis du fait de la qualité de leurs universités, et d’autres institutions fondées sur l’innovation, qu’elle soit publique ou privée. L’inconvénient de ce succès américains est que ces derniers ont tendance à confondre ce qui est américain avec ce qui est universel et à négliger l’originalité des autres parties du monde.
La domination américaine sur le marché de l’innovation vient la concurrence entre universités, étudiants, enseignants. En particulier ce sont ces derniers qui reçoivent des subventions et, une fois dotés des dites subventions ils choisissent leurs institutions d’accueil. Les universités allemandes et françaises qui dominaient naguère la recherche sont extrêmement loin de ce modèle. Ce qui explique leur déclin. Heureusement quelques réactions en France et de plus importantes en Inde et en Chine, sont peut-être l’amorce d’une évolution.
En conclusion
Toutes ces considérations, qui, rappelons le, visent le très long terme, sont d’un grand optimisme, qui paraît un peu décalé en période de crise, notamment concernant le résultat « historique » d’une croissance mondiale de 5% (jusqu’en 2007). On pourrait objecter qu’une partie de ces 5% était un peu « virtuels » et que de faux actifs ont été comptabilisés à cette époque, qui sont déflatés aujourd’hui. Cette nuance n’est rien par rapport aux éternelles critiques « de fond » du libéralisme auxquelles « la crise » a redonné une audience. Mais l’auteur rappelle qu’en « temps de crise la pensée magique souvent ressurgit et balaye la raison acquise; ce que la science économique enseigne, un vent de panique et de démagogie peuvent l’annuler. »