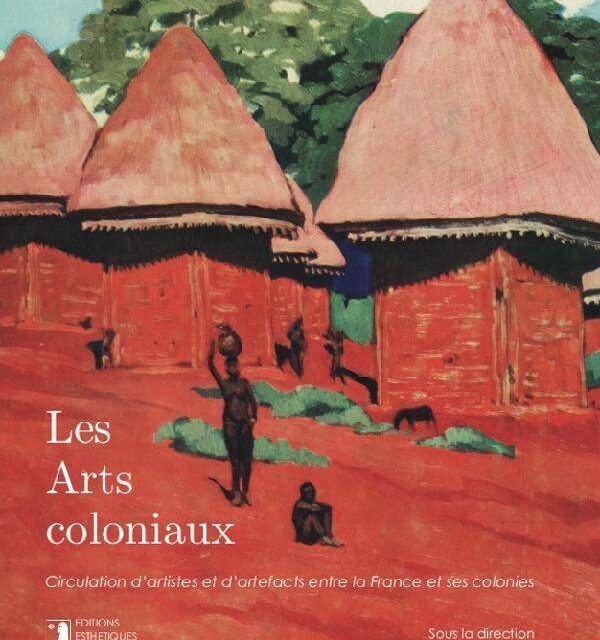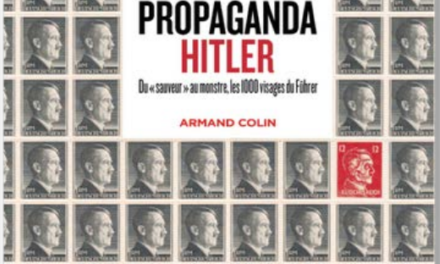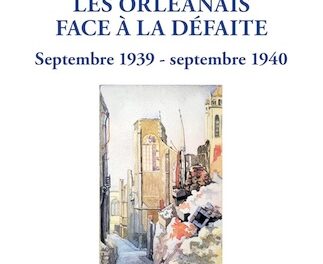« Le « colonial » est exotique, mais l’exotisme dépasse puissamment le colonial ».
Victor Segalen
Les Éditions Esthétiques du Divers se fondent, avant même la nécessaire reconnaissance de la diversité culturelle, sur le plaisir de sentir le divers.
Fondée en 2008, ces Éditions ont deux champs de spécialité : des essais en histoire de l’art et en anthropologie, et des recherches sur le patrimoine et les identités culturelles. Il s’agit de mettre en dialogue les disciplines nécessaires à toute compréhension de l’art de l’Autre et à l’étude de ses représentations, aujourd’hui comme hier.
Le directeur, Dominique Jarrassé réunit dans cet ouvrage, une quinzaine de contributions émanant d’historiens de l’art, de chargés de recherche au CNRS et de conservateurs de musées, qui soutiennent l’intérêt des collections des arts coloniaux.
Ce catalogue collectif comprend deux parties, un premier temps sur les circulations des images et leur appropriation dans les expositions puis des essais sur les collections d’œuvres, vues comme une transmission parfois occultée avec une visibilité retrouvée aujourd’hui.
Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bordeaux-Montaigne, Dominique Jarrassé a soutenu sa thèse (Paris IV) sur L’architecture thermale en France entre 1800 et 1850 et son HDR (Paris IV) sur L’Architecture des synagogues en France au XIXe siècle. Il a ensuite publié de nombreux livres en Histoire de l’art, notamment L’art Juif aux Éditions Mazenod.
Dans son dernier ouvrage, Existe-t-il un art juif ? (Biro éditeur, 2006), ce chercheur s’intéresse à l’influence de l’identité comme source essentielle de l’expression artistique.
En ouverture, Dominique Jarrasé s’interroge sur la collecte des œuvres à l’occasion de l’exposition organisée par le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, dédiée aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Cette exposition, nommée Peintures des lointains dans la collection du musée du quai Branly – Jacques Chirac, interroge sur les conditions de collecte, puis de la relégation de certaines œuvres. Ce processus patrimonial complexe implique la présence d’une idéologie qui a présidé, il y a presque un siècle, à leur entrée dans une collection de musées et plus tard entraîné leur relégation.
Leur visibilité marque un tournant mais cela implique la nécessité de comprendre des œuvres rassemblées en une collection supposée avoir une cohérence alors qu’au contraire la forme plastique, l’iconographie, la diffusion, et la réception, induisent une diversité. La notion de circulation apparaît comme un ancrage d’analyse pour saisir la complexité des arts dans cette période coloniale.
Dans un colloque en 2018, cette perspective a été envisagée en collaboration avec le musée du quai Branly et l’établissement public du Palais de la Porte Dorée.
Cet ouvrage rassemble des études présentées au colloque. D’autres inédites entendent apporter des éclairages nouveaux sur ce pan de l’histoire de l’art souvent négligé.
Comment aborder les arts coloniaux sans les confronter aux savoirs des disciplines des sciences humaines ?
Il va sans dire que l’approche de l’objet artisanal ou ethnographique, considéré comme art aujourd’hui, ne peut être commenté sans un « trésor de connaissances et de subtilités ». Il s’agit de dépasser les idéologies construites au temps du colonialisme et de réactiver les analyses par une approche dite décoloniale, puis actuelle. Aborder l’art colonial signifie à la fois pratiquer des monographies mais aussi chercher à inventorier, d’où l’accent nécessaire porté sur la constitution des collections dont la transmission a été souvent complexe.
Dominique Jarrassé espère, par la réunion de ces essais, fournir un large éventail des productions dites indigènes en situation coloniale mais aussi présentes dans les expositions coloniales sous l’influence des modèles occidentaux, à la base de la formation des artistes.
Cette histoire de l’art est complexe. Le processus d’acculturation, d’appropriation au cœur du fait colonial, s’avère à double sens. Si le colonisateur s’approprie des pratiques dites primitives, il en est lui-même transformé. Le colonisé subit, souvent par la violence du pouvoir dominateur, mais il intègre des pratiques occidentales et il participe donc à une culture en voie de globalisation.
Les différentes contributions montrent ce qui se joue à travers ces arts coloniaux. Une analyse critique des artefacts (mot utilisé pour éviter la terminologie de l’histoire de l’art) collectés demeure à poursuivre, à partir de documents de la période coloniale, mais aussi de sources d’époque, d’auteurs métropolitains en situation coloniale.
L’émergence des arts coloniaux dans la circulation des artistes et des artefacts procède d’une première phase de mondialisation
En premier lieu, Dominique Jarrassé présente les conditions de la circulation des arts et des artistes coloniaux qu’il conçoit comme les prémisses d’une mondialisation privilégiant l’acculturation des artistes indigènes et la banalisation des objets. Il critique même le terme d’arts coloniaux puisque les productions proviennent d’horizons lointains et de créations si diverses. S’éveillent des artistes à part entière, s’exhortant de l’œil occidental. L’auteur préconise donc une requalification de ce champ des arts et une reconnaissance des artistes de cette époque.
Le portrait à Saint-Domingue
Le chapitre deux, rédigé par Carlo A. Celius, évoque l’évolution du portrait à Saint-Domingue, le genre le plus prisé dans la colonie française.
Éduquer et séduire, les arts coloniaux dans les images scolaires (1871-1958).
Sophie Leclerc a présenté cette contribution aux RDV de Blois en 2018 dont voici le résumé :
L’iconographie scolaire des colonies de 1880 aux années 1950 : ÉDUQUER et SÉDUIRE
Les expositions artistiques de l’Afrique française (1928-1939)
Marion Lagrange revient sur l’identité africaine et l’idéologie coloniale dans les expositions artistiques de l’Afrique française (1928-1939). Vingt-deux expositions furent probablement programmées entre 1928 et 1956. Il s’agissait à l’époque d’établir une école africaine. L’auteur parle de la fabrique d’un certain regard, et montre l’émergence d’artistes dit indigènes. D’ailleurs, il faut attendre l’après-guerre pour que ces artistes soient plus nombreux à rompre avec la tradition orientaliste des paysages et des scènes de genre. Ils ont contribué à consolider un imaginaire orientaliste. L’injonction politique était claire. La scène artistique coloniale devait demeurer le creuset d’une identité spécifique. Cette conception trouvera certains prolongements dans la construction d’une histoire de l’art post-coloniale.
Au service de l’Empire
Laurent Houssais s’intéresse dans cet essai à la promotion des arts coloniaux dans les salons de la France d’outre-mer. En effet peu d’historiens de l’art ont été attentifs à ces manifestations déclinées en trois éditions. Quels rôles ont les arts dans cette vaste entreprise de promotion de l’Empire français ?
Ces jalons constituent une instrumentalisation des arts coloniaux au profit de l’Empire. Les organisateurs ont choisi de se concentrer sur la France africaine ou asiatique, témoins de l’art de la France d’outre-mer. Les œuvres exposées, s’inscrivent dans le registre traditionnel des paysages, des scènes de genre, puis des portraits de figures marquantes.
Y a-t-il un art à Madagascar ?
Alexandre Girard-Muscagorry étudie la circulation et la réception de la création malgache en France durant la période coloniale. Dans les années 30, les critiques parlent de Madagascar comme un pays sans passé, un pays neuf. L’île n’aurait pas connu de grandes civilisations, ce qui expliquerait une pauvreté de l’art malgache. De telles assertions s’expliquent par la puissance coloniale exercée sur Madagascar.
Dans cet essai, l’auteur tend à montrer l’évolution du regard porté sur la création malgache, surtout les objets artisanaux, désignés sous les vocables d’art décoratif ou d’art indigène, une production en creux en marge des arts dit officiels. Il s’agit d’artefacts vendus au grand marché du vendredi à Tananarive, ou de pièces d’artisanat dit rénové souvent en bois, qui s’inscrivent dans « un goût de mise en souvenir de l’exotisme », par le choix des thèmes iconographiques codifiés conformes aux représentations occidentales de l’île.
Le programme de transformation de l’artisanat s’inscrit dans une forme de mission civilisatrice mais aussi un outil de promotion touristique. Il a fallu donc inventorier de 1900 à 1925, puis largement diffuser dans des manifestations comme l’Exposition coloniale de 1931. L’artisanat dit rénové gagne en visibilité et en reconnaissance, ce qui fait rentrer des objets dans les collections de musées parisiens. Alors que le musée d’ethnographie du Trocadéro possédait déjà un fonds d’objets malgaches conséquent, depuis 1880, le musée acquiert une trentaine d’objets à l’Exposition coloniale. Ensuite une salle spécifique sera dédiée à l’île sous la direction de l’ethnologue Jacques Faublée. Les objets sont mis en contexte par des photographies et des notices expliquant la technique et l’usage des pièces exposées. Il ne faut pas s’y tromper, on parle d’artisanat rénové qui sert un discours où il est question d’élever l’art indigène lorsque celui-ci est guidé, témoin de la politique culturelle menée par le pays.
Après la 2de guerre mondiale et les indépendances, ces objets sont jugés inauthentiques et peu valables, frappés du sceau colonial. Il faut attendre la grande exposition, Madagascar, art de la grande île organisée par le musée du quai Branly – Jacques Chirac en 2019, pour que les artefacts soient inscrits dans une histoire plus large de l’art malgache.
Les arts du Cameroun vus par Suzanne Truitard
Isidore Pascal Njock Nyobe fait découvrir, une illustratrice d’exception, Suzanne Truitard qui rencontre son mari à Madagascar. Administrateur colonial, Léon Truitard représente un modèle d’implication dans la propagande en faveur de l’expansion française appréciée dans les milieux coloniaux.
Grâce à une collection conséquente, qui émane de nombreux séjours sur les terres d’outre-mer, le couple assure la promotion des arts dits coloniaux, surtout les arts du Cameroun, cette colonie autrefois allemande devenue terre française après la Grande Guerre. Suzanne Truitard est l’une des premières à tomber amoureuse des arts bamoun et bamiléké. Alors qu’on a souvent dit que la compréhension de l’art africain relevait des ethnologues comme Marcel Griaule, dans l’entre-deux-guerres, l’auteur de cet essai montre que les arts du Cameroun étaient déjà promus par des passionnés. Intéressée par les modes de vie des populations indigènes, l’artiste puise ses sources d’inspiration dans ses voyages.
Plus largement, cette illustratrice, issue de l’école de dessins ABC de Paris, a été souvent sollicitée, afin d’agrémenter différentes publications de ses œuvres pour la promotion du monde colonial, des affiches largement inspirées de ses deux années passées au Cameroun. A son engagement pour la promotion des arts coloniaux en métropole, Suzanne Truitard ajoute celui de la cause féministe. Elle utilise les expositions, pour souligner la condition des femmes, notamment la femme noire, qui vit en état d’infériorité vis-à-vis de son mari comme la femme française privée du droit de vote.
De plus, étudier cette artiste, permet de comprendre les conflits d’intérêts que pouvait subir une terre convoitée par deux puissances coloniales. Le Cameroun entre les deux guerres, constitue un laboratoire d’observation de l’irrédentisme de la puissance allemande et de la riposte propagandiste la métropole française.
La création de l’école des arts appliqués de Fort-de-France et les graines de la rébellion esthétique 1943 – 1945
Christelle Lozère étudie la période du régime de Vichy, au moment où l’oppression coloniale est au plus fort sur les Antilles.
La réforme de l’enseignement technique en 1939, répond à la volonté de développer dans « deux anciennes colonies » l’enseignement des arts et de l’artisanat dans des écoles spécialisées. En 1943, Georges-Louis Ponton, gouverneur en Martinique met un point d’honneur à faire rayonner l’art antillais dans une île nouvellement ralliée à la France libre. Très vite, cette école fera l’objet, de 1943 à 1945, de menaces incessantes car elle est perçue comme un foyer de contestation du pouvoir colonial local.
Cet article, à travers les archives privées du gouverneur, cherche à analyser les enjeux politiques et identitaires autour de la création de cette école.
Cependant, après 1944, cet art n’est pas considéré comme antillais, car il est ressenti comme trop artificiel, assimilé, dégagé de la sensibilité ethnique propre au peuple antillais.
Une autre vision artistique s’oppose à l’art issu d’une esthétique française, qui émane d’artistes voyageurs, souvent formés dans les écoles d’art de la métropole ayant foi dans la politique assimilationniste et républicaine. En revanche, les artistes de la négritude (Césaire, Senghor) influencés par le surréalisme, prônent une réappropriation de « l’identité nègre ».
A Fort-de-France, une première exposition officielle de l’ensemble des travaux des élèves de l’école des arts appliqués séduisent le public. Ils s’avèrent être un foyer d’incubation des grands artistes antillais contemporains, qui dépassera les fractures esthétiques pour devenir un enjeu mémoriel et revendicatif.
La seconde partie de cet ouvrage compile un ensemble d’essais sur les collections des arts coloniaux qui se sont constitués.
Sarah Ligner s’interroge sur la terminologie appliquée aux collections de musées en fonction de la formation des Empires, de la temporalité et de leur expansion territoriale. L’épithète colonial doit interroger sur les provenances des objets, sur le contexte de leur création et sur leur mode de réception.
Les musées font face à une nouvelle mission, celle de nourrir une réflexion sur les ressources, dans un enrichissement culturel de tous les publics. Il s’agit par le prisme de l’histoire de la colonisation, d’étudier les modes d’acquisition dans un pays colonisé et sa part d’illégitimité si nécessaire.
Dans le cadre de l’exposition présentée en 2018, Peintures des lointains dans la collection du musée du quai Branly – Jacques Chirac et celui du colloque organisé à cette occasion, une réflexion critique sur l’histoire des fonds, née d’une volonté idéologique, s’est engagée et elle propose de distinguer le contexte de création et de réception de chaque artefact. De ce fait, il s’agit de redéfinir les contours d’une collection, de s’interroger sur l’histoire coloniale à partir des collections muséales.
Hélène Bocard retrace l’histoire d’un palais colonial, le palais de la Porte Dorée, un bâtiment conçu pour abriter des collections qui l’ont en partie déserté. Chef du service de la conservation architecturale au palais de la Porte Dorée, elle pose la question de la fréquentation du public. La majeure partie des visiteurs se rend à l’aquarium tropical, à l’exposition permanente de l’histoire de l’immigration ou à des événements dans le cadre de la programmation culturelle. L’évocation de l’art déco dans sa forme coloniale est peu souvent étudiée. Une question reste en suspens, savoir si un musée de l’histoire de l’immigration a sa place dans un palais colonial.
Une communication de Florence Hudowicz présente les difficultés posées par les héritages coloniaux dans une présentation muséale. A Montpellier, un projet de musée n’a pu voir le jour malgré une collection de peintures conséquente. Une telle entreprise avait été décidée pour illustrer les liens entre la France et l’Algérie. Les musées nationaux avaient accepté de déposer des œuvres dans la future institution. Le projet ici résumé entend poser une future pierre pour appréhender l’évolution de la peinture en Algérie pendant et après la colonisation. Si rien n’a été possible physiquement, des bases de données virtuelles existent pour nourrir des recherches futures.
Claire Poirion présente les collections d’art colonial du musée des Années Trente à Boulogne – Billancourt. Cette institution muséale dispose d’un matériel encore largement inexploré et inexploité. Son étude par des disciplines transversales et complémentaires, permettrait de mettre en valeur des artistes injustement écartés pour leur appartenance à cette époque coloniale, liée aux années 30 ainsi que des fonds d’archives privés également incontournables.
Par l’étude de dessins d’écoliers dans les colonies françaises, Mathilde Allard montre les intentions de la mission civilisatrice de la nation française. Cette dernière parle de « réveil des arts indigènes » par l’apprentissage du graphisme, destiné à mettre en valeur les échanges économiques avec la métropole.
L’école se présente comme un système témoin de l’entreprise qui se mesure bien au-delà de l’enseignement primaire. Des modèles pédagogiques répondent à un besoin de justification et l’apprentissage du dessin se plie à merveille à un autre dessein qui est celui de la politique française.
En Bretagne, Gwenaëlle Ben Aissa a travaillé sur les interactions entre les arts missionnaires et les arts coloniaux. Les collections rassemblées par les congrégations missionnaires chrétiennes demeurent souvent absentes de l’histoire des collections françaises. Si l’échelle temporelle est plus importante pour la mission que pour la colonisation, les collections relèvent d’un imaginaire et d’une conscience missionnaire. Une grande partie de la production a été commanditée. D’ailleurs, dans son désir d’exposition une volonté de partage de l’action missionnaire est visible.
Cet ouvrage rassemble des essais comprenant une source inestimable de « matériel visuel essentiel » et une réflexion novatrice qui nourrit une meilleure compréhension de l’histoire des colonies. Il contribue à alimenter des mémoires chargées de non-dits.
Il sera d’une grande utilité au professeur de 4e mais aussi de Première et de Terminale ou en HGGSP. Une collaboration utile avec le collègue de philosophie alimenterait un échange fructueux sur la qualification, la réception et la place des Arts en situation coloniale.