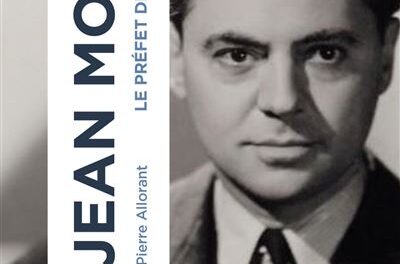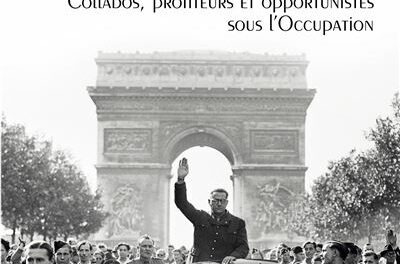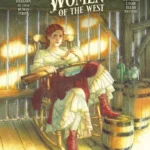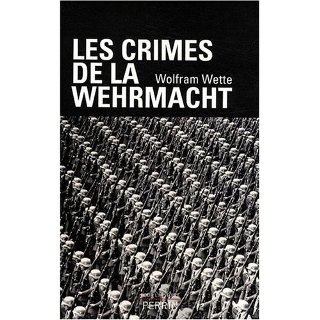
Il y a peu de travaux traduits en français sur le sujet , le plus connu étant l’Armée d’Hitler de l’historien anglo-saxon Omer Bartov. Tandis que certains historiens français tels Benoit Lemay revisitent les biographies de Rommel et Manstein en révélant leurs liens avec le régime.
Les éditions Perrin nous proposent la traduction d’un ouvrage de Wolfram Wette publié en 2002 outre-rhin. L’auteur, qui enseigne à l’université de Fribourg, nous livre ici une intéressante étude sur le comportement criminel de la Wehrmacht. L’ouvrage essaye de comprendre ce qui est à l’origine d’un tel comportement, et les raisons de l’image « propre » de la Wehrmacht.
Des préjugés racistes tenaces
Les deux premiers chapitres de l’ouvrage s’attellent à nous montrer quelle était la représentation qu’avaient les Allemands de ceux qui furent leurs principales victimes, les Juifs et les Russes. L’auteur montre que c’est un à priori ancien, largement négatif, habilement exploité par Hitler, qui explique la quasi absence de résistance de l’armée vis-à-vis des politiques mises en place.
La réalité de la Russie soviétique était méconnue des Allemands. Pour de grandes parties de la population allemande, les Russes étaient avant tout un peuple de slaves menaçant leur frontière orientale, avec tout le mépris que pouvait recouvrir le terme slave. Une image relativement semblable à celle qu’en donnaient déjà les nationalistes allemands en 1914.
La révolution bolchevique de 1917, puis les mouvements spartakistes et les combats entre corps-francs et Armée rouge dans les pays baltes ne firent que renforcer ce préjugé négatif à l’égard des Russes. Ils facilitèrent même la diffusion d’une équation simpliste dans laquelle le Russe était aussi Bolchevik et Juif.
Chez les élites politico-militaires, la vision était à peine plus nuancée. Si les dirigeants communistes allemands voyaient dans l’Union soviétique le modèle à suivre. Les socialistes du SPD craignaient et repoussaient la vision autoritaire et antidémocratique qu’elle représentait mais refusait tout préjugé raciste à l’égard de la Russie. Par contre, dans la bourgeoisie allemande, le choc provoqué par la révolution bolchevique avait fait disparaître l’idée qu’il pouvait exister une culture russe digne de ce nom. Dans les élites militaires, la coopération des années 20 avait provoqué une certaine estime pour ce qu’était en train de devenir l’armée Rouge. Celle-ci disparut avec la fin de cette coopération et la disparition des élites militaires soviétiques lors des purges des années 30.
Un antisémitisme ancien
Wette montre également que l’antisémitisme est présent dans l’armée allemande dès l’époque impériale. Les Juifs étaient systématiquement exclus de toute possibilité d’accession aux grades élevés. La Première guerre mondiale fut même l’occasion d’un recensement des Juifs combattants dont l’objectif était de démonter qu’ils ne faisaient par leur devoir, objectif non atteint.
La défaite de 1918, et les mouvements révolutionnaires qui la suivirent ne firent que renforcer une grande partie du haut commandement allemand dans ses préjugés antisémites. De nombreux ex-officiers prirent part aux violences contre-révolutionnaires et aux assassinats politiques et antisémites des premières années de la république de Weimar.
La Wehrmacht se distingua par son empressement à exclure les Juifs de l’armée. Et quand le rétablissement du service militaire entraîna l’appel sous les drapeaux d’hommes issus de parents de confessions différentes et considérés comme « quart » ou « demi » juifs selon les critères raciaux des nazis. Si la plupart servirent dans l’armée, ce fut non par mansuétude mais parce que leur éviction se révélait impossible à mettre en pratique dans un pays en guerre.
Crimes de guerre et crimes contre l’humanité
La militarisation de la société allemande réalisée par les nazis correspondait largement aux aspirations des élites de l’armée. Celles-ci étaient acquises à l’idée que seul un régime fort et une politique extérieure agressive permettrait de préserver l’Allemagne. La guerre et l’emploi de la force leur apparaissaient naturels et conformes à leurs traditions.
L’invasion de l’Union soviétique en 1941 apparaît souvent comme le moment où l’armée est informée de la volonté d’Hitler de conduire une guerre totale raciste et idéologique. L’ordre sur les commissaires ou les accords de partage de compétence entre la Wehrmacht et les Einsatzgruppen en sont les exemples les plus fréquents.
Pourtant, dès l’invasion de la Pologne, la Wehrmacht avait pu assister aux premières exécutions et ce sans réaction. Elle se tint à distance, en simple spectateur. Elle le fit lors des premiers pogroms suscités par les nazis lors de leur entrée en Union soviétique et en particulier dans les pays Baltes.
Cette attitude ne dura pas, les Juifs sont rapidement désignés par la Wehrmacht elle-même comme des ennemis mortels à abattre, sans que l’on précise s’il faut se limiter aux hommes.Les unités de l’armée prêtèrent leur concours aux opérations d’extermination, en particulier au grand massacre de Babi Yar (plus de 30 000 victimes en septembre 1941) . De même, l’extermination de la population juive de Serbie fut largement organisée et réalisée par les unités de la Wehrmacht.
La lutte contre les partisans en Russie servit également de prétexte aux massacres de civils. Tout civil pouvait être considéré comme partisans, nombreux furent les villages rasés, les victimes exécutées comme partisans quelque soit leur âge ou leur sexe. Ils périrent victimes du racisme des nazis qui ne voyaient en eux, au mieux, que des sous-hommes slaves. Comme périrent également plusieurs millions de prisonniers de guerre soviétiques laissés sans nourriture et sans abri par l’armée allemande dès 1941.
L’auteur montre le consentement du soldat allemand à cette politique. il n’y a pas de remise en cause des ordres reçus ou de refus d’obéissance. Les quelques 18 millions d’Allemands amenés à servir sous l’uniforme le firent sans états d’âme et ce jusqu’à la fin. Les rares études de leurs correspondances révèlent une large adhésion aux idéaux du régime et une préoccupation majeure, celle de ne pas décevoir le groupe auquel ils appartiennent.Les seuls objecteurs de conscience sont les témoins de Jéhovah qui le payèrent de leur vie.
Et même si le nombre de déserteurs fut important dans les derniers mois de la guerre et si le nombre d’exécutions est très élevé (30 000 condamnations à mort), il n’y eut pas d’effondrement de l’armée comme en 1918. La militarisation à l’extrême de la société avait atteint son but, la nation toute entière aurait du disparaître héroïquement les armes à la main comme le voulait la mise en scène nazie.
Le dernier succès de la Wehrmacht : son image « propre »
Pourquoi durant des années la Wehrmacht est-elle apparue comme une armée classique ? Les crimes commis étant attribués à la SS.A cette interrogation, l’auteur répond en mettant en avant un certain nombre de facteurs.
D’abord, le fait que l’information tout au long du conflit ait été cloisonnée, on ne révélait aux officiers subalternes et aux soldats que ce qu’ils avaient besoin de savoir et en des termes camouflés (la référence systématique aux « partisans » par exemple). Les documents officiels usant également des mêmes méthodes. Ainsi le caractère systématique des crimes commis reste dissimulé. De même l’ultime communiqué de l’amiral Doenitz du 9 mai 1945, insiste sur le fait que le sacrifice et la conduite honorable de la Wehrmacht ne peuvent que lui valoir le respect des vainqueurs.
Dès les procès de Nuremberg, les généraux allemands tirèrent parti de l’absence de condamnation de la Wehrmacht comme organisation criminelle. Pour eux c’était la preuve de leur innocence. Alors que pour les juges cela signifiait seulement les poursuites seraient exercées contre des individus et non contre toute l’institution dans son ensemble.
La guerre froide facilita ensuite les choses. La nécessité de ménager l’Allemagne, de reconstruire son armée, et de préparer son entrée dans l’Alliance Atlantique influença les procès suivants. En 1949, l’image qui se dégagea du procès Manstein fut celle d’un héros militaire et non celle de l’officier ayant approuvé les exécutions de Juifs dans la zone sous son commandement. Tandis qu’en 1951 Eisenhower établissait une distinction entre Hitler et son groupe criminel d’une part, et les soldats et officiers allemands d’autre part…
La clémence des alliés se retrouva également dans la possibilité offerte aux officiers allemands prisonniers de guerre d’écrire la version allemande de la guerre. Ce qui devint de fait, la guerre vue par le haut commandement de la Wehrmacht, la rédaction de l’ouvrage se faisant sous la direction de l’ancien chef d’état-major le général Halder. Celui-ci put orienter les témoignages et récits, sélectionner les documents à garder ou à faire disparaître, et ainsi forger l’image « propre » de la Wehrmacht. Une image reprise ensuite dans les mémoires publiées par les anciens généraux et officiers.
Les Allemands eux-mêmes refusèrent de voir leur passé en face, un consensus se dégagea rapidement pour mettre un point final à toutes les procédures en cours dès les années 50. Les rares procédures qui suivirent distinguèrent les crimes de guerre (amnistiés) des crimes nationaux-socialistes qui ne l’étaient pas, épargnant ainsi la Wehrmacht.
Un réveil brutal
Ce n’est qu’à partir des années 70-80 que fut remise en cause cette vision traditionnelle. En partie grâce aux travaux sur le sort des prisonniers de guerre soviétique ou sur le comportement criminel de l’armée envers les slaves.
Ce réveil eu des conséquences jusque dans la Bundeswehr. En tant qu’institution militaire, celle-ci accordait une grande importance à la tradition, et pour elle la Wehrmacht faisait partie de son patrimoine ; les casernes gardant souvent leur nom d’avant-guerre ou prenant celui de généraux de la Wehrmacht. Les débats furent vifs sur la place à accorder aux auteurs de l’attentat du 20 juillet 1944 entre réformistes qui voyaient en eux les modèles à suivre et traditionnalistes qui au contraire n’y voyaient que des hommes ayant failli à leur serment de fidélité.
Ce fut réellement l’exposition itinérante sur les crimes de la Wehrmacht qui se déroula de 1995 à 1999 qui mit le débat sur la place publique. Des millions de personnes la virent, et ce fut un choc pour le pays tout entier. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Durant la Seconde guerre mondiale la Wehrmacht fut la société allemande, toute famille ayant un ou plusieurs membres mobilisés, ceux-ci transmirent ensuite l’image traditionnelle de la Wehrmacht au blason sans tâche.
Les débats furent vifs, mais désormais l’image qu’ont les Allemands du comportement de leur armée durant la Seconde guerre mondiale correspond davantage à la réalité. Signe de l’évolution, en 2000, pour la première fois, le nom d’un soldat allemand condamné à mort pour avoir sauvé des Juifs fut donné à une caserne allemande. Point de départ d’une nouvelle tradition ?
En conclusion
L’ouvrage de Wolfram Wette ne dresse pas une liste des crimes commis, il permet de faire le point sur l’historiographie de la Wehrmacht. Son ouvrage fait surtout référence aux crimes commis à l’Est, et il s’en justifie car c’est là qu’ils ont été les plus nombreux, et pour ceux qui voudraient une étude comparative du comportement sur les différents fronts, il donne de nombreuses pistes bibliographiques.
L’ouvrage met en évidence la part de l’héritage dans ce comportement et dans cette mémoire. Il reconnait que malgré les progrès de la recherche, il reste encore de nombreuses pistes à explorer sur la manière dont la Wehrmacht a participé à la mise en œuvre de la solution finale ou sur la mémoire de la Wehrmacht dans l’Allemagne de l’Est.
Les Français ne sont pas les seuls à avoir eu du mal avec un « passé qui ne passe pas. »