Professeur des Universités en histoire contemporaine à l’Université-ESPE de Rouen, Rémi Dalisson est un historien spécialiste des sociabilités et politiques symboliques des XIXe et XXe siècles. Les fêtes sont son objet d’étude principal, notamment les fêtes républicaines, ainsi que leur rôle historique et les diverses utilisations de celles-ci par le politique.

Le présent ouvrage est une étude des « fêtes de guerre », définies comme étant « les célébrations organisées pendant et après les combats », qu’il s’agisse des fêtes nationales (comme le 11 novembre ou le 8 mai), ou des fêtes locales (comme les inaugurations de monuments aux morts par exemple), sur la période s’étendant de 1870 à nos jours. Cette étude montre que « l’ensemble de ces fêtes de guerre forge une représentation collective, une mémoire nationale, socle d’une identité fantasmée autant que vécue ». « En magnifiant la Revanche, la République, la paix, la Résistance, l’héroïsme des guerriers et des peuples voir de l’Europe, elles ont structuré l’idée d’une nation éternelle », une identité nationale.
L’ouvrage comporte trois grandes parties composées chacune de trois chapitres ; les titres et les sous-titres sont apparents, ce qui facilite la clarté de la démonstration. Les 50 dernières pages proposent une quinzaine de documents annexes, une bibliographie et un index.
Inventions : les fêtes de la Revanche (1871-1914)
Commémorer une défaite, commémorer un régime
Jusqu’alors, les simples combattants étaient la plupart du temps abandonnés sur les champs de bataille ou inhumés anonymement dans des fosses communes. Dès la fin de la guerre de 1870, sont construits les premiers monuments honorant les « Morts pour la France », financés par les communes, puis par des souscriptions, tandis que l’État prend en charge la construction de nécropoles nationales. À l’occasion du premier 14 juillet, en 1880, le régime républicain lance une politique de la mémoire revancharde de grande ampleur, pour esquisser son « roman national ». Dès lors, le nombre des inaugurations de monuments augmente nettement et le mouvement gagne tout le pays. Le gouvernement intervient par le biais de multiples associations, ainsi que par l’école et les sociétés gymniques ou patriotiques « qui républicanisent la mémoire de guerre par leur seule présence ». La Ligue des patriotes, alors républicaine, et la Ligue de l’enseignement, bénéficient de l’appui de l’État et de la franc-maçonnerie. La loi de 1901 sur les associations amplifie encore le mouvement en facilitant les créations de sociétés d’anciens combattants, la principale étant le Souvenir français, chargé d’entretenir la mémoire du conflit et de financer ses monuments.
« En l’espace d’une vingtaine d’années, toute une nébuleuse associative et culturelle se met en place pour bâtir, diffuser et enjoliver la mémoire de la guerre à chaque inauguration et commémoration. Ces passeurs de mémoire sont les associations de combattants, d’Alsaciens-Lorrains et de tir, mais aussi l’État, l’École, l’Armée et les intellectuels. S’y ajoutent les médaillons les chansons patriotiques qui bâtissent une nouvelle mémoire de guerre pour panser les blessures nées de la défaite. »
Fêter la Revanche au village
Les associations, l’École et l’État forgent une représentation héroïsée du conflit : la défaite de 1870 devient une victoire morale, et la catastrophe, un succès potentiel. Le pouvoir choisit pour se légitimer d’utiliser 1870 comme symbole fédérateur d’une guerre. Pour cela il faut aller plus loin que la seule célébration du deuil. Il faut entretenir la flamme de la Revanche par des cérémonies complétant l’action scolaire, associative et culturelle de la République : « Les fêtes de guerre deviennent la synthèse du conditionnement culturel qui règne depuis 1871 ». La fête de guerre n’est pas seulement recueillement, mais commémoration joyeuse : une véritable fête. L’auteur en étudie la scénographie qui en révèle la signification, et montre que « le patriotisme de l’inauguration est totalement assumé, comme la mystique revancharde ». On demande aux enseignants, surtout du primaire, d’expliciter le sens des inaugurations, la mise en scène se transforme en propagande.
Mémoire et fêtes de guerre : la question nationale
Les monuments aux morts de la guerre de 1870 imposent une représentation ou la République incarne par nature la Revanche. Populaire et militarisée, cette culture républicaine de la Revanche est sous-tendue par le patriotisme qui légitime la violence, y compris des armes modernes. « Ce patriotisme absolu et absolument républicain conduit au nationalisme souvent agressif (…) Et le discours scolaire, associatif et commémoratif nourrit le nationalisme, qui lui-même entretient ce discours officiel et médiatique. Les valeurs ainsi diffusées, la patrie, le souvenir, l’héroïsme, le sacrifice, l’honneur, la mort glorieuse, le dépassement de soi et l’obéissance forgent des représentations ambivalentes que l’on peut qualifier de nationales. Ce nationalisme va croître et évoluer jusqu’à l’accomplissement de la Revanche, au point de structurer la société et poser la question de l’identité française. »
Jusqu’à l’affaire Dreyfus, si la patrie mutilée et humiliée engendre un nationalisme virulent, c’est d’un nationalisme d’adhésion qu’il s’agit, « un nationalisme ouvert », celui d’une République qui intègre les individus de tous horizons à la seule condition qu’ils acceptent les valeurs de 1789. Avec la conquête coloniale, et plus encore avec l’affaire Dreyfus, une partie des nationalistes refuse que l’on détourne la Revanche de son but et en accuse des institutions faibles et corrompues. Le nationalisme mue et donne naissance à un avatar où il n’est question que d’élan vital et d’identité rénovée par une nouvelle révolution, d’homme fort et de sauveur de la nation menacée par la décadence. « L’affaire Dreyfus a sonné la fin du nationalisme ouvert des premières fêtes de guerre et à laissé place au nationalisme fermé, à l’idée d’une nation assiégée et minée de l’intérieur, en pleine décadence. » Seule la terre des morts héroïques et des ancêtres purs garantit l’appartenance à une nation qui se réduit à une race au sang pur. Ce « nationalisme intégral », celui de Charles Maurras, rejette tout héritage révolutionnaire et républicain et tente de capter la mémoire de guerre. Au début du XXe siècle les récits de la guerre des Boers enflamment les nationalistes et lors des cérémonies de guerre « c’est la pureté originelle de la race qu’on exalte pour populariser une identité essentialisée, biologique et éternelle ».
Évolutions : fêtes de guerre, 11 novembre et nation (1914-1944)
La Grande Guerre : combattre et célébrer (1914-1918)
Pendant le conflit, les fêtes nationales perdurent à l’arrière comme au front, essentiellement le 14 juillet, dont le but principal est de retisser les liens de l’identité républicaine. Les fêtes de guerre persistent également, mais il ne s’agit plus d’honorer la seule mémoire de la guerre, il s’agit de célébrer les combattants et leur héroïsme. Les fêtes évoluent donc : les quêtes pour les soldats ou les familles remplacent les danses, les chansons sont moins joyeuses et plus funéraires. La trilogie des généraux Foch, Joffre et Pétain remplace les figures de Pasteur, Gambetta ou Ferry. De nouveaux outils servent les fêtes de guerre : la Croix de guerre et le diplôme d’honneur : « Aux morts de la Grande Guerre, la patrie reconnaissante. »
Très vite on invente de nouvelles fêtes de guerre, la première consistant à célébrer la bataille de la Marne. Cette fête rapproche l’Église de la République, car pour l’Église et de nombreux Français, c’est la « Vierge des Poilus », mentionnée par Péguy la veille de sa mort, qui a fait basculer le sort de la bataille. Les sonneries de cloches et la célébration d’une messe modifient donc la scénographie, ainsi que l’instauration d’une minute de silence et la participation active des « enfants des écoles ». Cette mise en scène préfigure celle des futurs 11 novembre.
En 1915, le gouvernement instaure des « Journées de guerre » pour compléter le 14 juillet ou la fête de la Marne. Elles sont d’abord une propagande puisqu’elles servent à diffuser la foi dans la patrie et à conforter son identité guerrière qui assurera la victoire. Chaque aspect du conflit se voit doté d’une Journée : Journée du poilu, Journée de l’armée coloniale, Journée des prisonniers de guerre, Journée des Alliés, Journée des orphelins, Journée du canon de 75, Journée de l’Afrique, Journée des pupilles, Journée des régions libérées, Journée des mères de famille etc. Ces « Journées » « dessinent les contours d’une communauté nationale rêvée, blanche, fière et unie autour d’un corpus identitaire aussi ancien (les valeurs républicaines, les petites patries) que nouveau (la mystique du sang versé, les Alliés, la fécondité). »
Le poids d’une mémoire victorieuse (1918-1939)
L’expérience des fêtes de la Revanche et des monuments de 1870 va servir aux nouvelles cérémonies de guerre. En un peu plus de cinq ans, plus de 36 000 monuments sont élevés dans chaque commune, soit plus de 16 par jour. C’est un mouvement de masse. Mais l’aide de l’État reste modeste, une nouvelle fois ce sont l’opinion locale, les familles et les conseils municipaux qui poussent à la construction. Les quelques monuments pacifistes, voire antimilitaristes, sont une particularité de la Grande guerre.
Le pouvoir entend poursuivre l’effort civique de la guerre pour conforter l’identité républicaine et nationale par la célébration. Pour les anciens combattants, il est hors de question de célébrer la force, la brutalité et l’armée qui triomphe dans le sang La future cérémonie ne doit célébrer ni la guerre, ni la victoire des institutions républicaines. Elle ne doit être l’occasion d’aucune parade militaire et d’aucun discours du chef de l’État. Pour le pouvoir qui entend rassembler autour d’un symbole fédérateur, ce projet est inacceptable. Par la loi du 24 octobre 1922, c’est le 11 novembre qui va émerger comme la grande fête de guerre nouvelle, fête de guerre fériée et chômée, qui prend place dans le corpus cérémoniel de la République à côté du 14 juillet et de la fête de Jeanne-d’Arc créée en 1920. Le 11 novembre devient immédiatement la cérémonie des soldats morts pour la patrie par devoir plus que par passion républicaine.
Plusieurs pages sont consacrées au 11 novembre, à propos duquel l’auteur vient d’ailleurs de publier un livre (11 novembre. Du souvenir à la mémoire, Armand Colin, 2013). Il en étudie les programmes, les discours et les déroulements et montre que « l’anniversaire de l’armistice fonde une scénographie qui permet de communier dans le culte de la mort héroïque et le retour des provinces perdues à la patrie » et que « dès lors, la question de sa mise en scène sur le terrain communal devient capitale. »
Dès la fin de la guerre, trois fondements de l’identité nationale qui véhiculent chacun leur imaginaire national s’affrontent à propos des célébrations : celui des nationalistes maurrassiens, fondé sur la xénophobie, l’antisémitisme le rejet de la République ; celui du jeune parti communiste qui affirme sa foi dans l’avenir socialiste du pays par la révolution, le rejet de la République bourgeoiseet de la guerre capitaliste ; celui enfin des pacifistes qui rejettent les deux camps précédents et imposent une réflexion inédite à l’identité nationale. Il n’y a plus de consensus sur la mémoire de guerre « et les fêtes des années 1930 illustrent le désarroi identitaire grandissant ».
Les fêtes de guerre, entre vichysme et résistance
Vichy va habilement conserver les grandes dates festives d’antan et en créer de nouvelles pour mieux imposer son identité conservatrice, pour faire table rase du passé républicain et reconstruire l’identité nationale. Dès le 25 juin 1940, Pétain décrète une journée nationale d’hommages aux morts de 1940 et à l’armistice. En 1942, il crée une journée d’hommage aux victimes des bombardements. « Ces deux journées placent le régime sous le sceau de l’expiation, du sacrifice exemplaire, de la solidarité nationale et doivent acculturer les populations en utilisant des cérémoniaux festifs toujours populaires.» Le pouvoir conserve l’anniversaire de l’armistice et le 14 juillet, rebaptisé néanmoins « cérémonie en l’honneur des Français morts pour la patrie ». Les rituels sont compassés et lugubres, la défaite est une punition méritée qui sanctionne les errements du pays depuis 1789.
La fête du 11 novembre rebaptisée « cérémonie en l’honneur des morts de 1914-1918 et de 1939-1940 », n’est pas fériée et doit être discrète en zone Nord. La célébration doit faire le lien entre 1940 et la Grande guerre : La France a été deux fois sauvée par Pétain, et il n’est pas déshonorant d’avoir perdu en 1940 puisque l’on a été trahi par les élites juives et franc-maçonnes qui ont mené la guerre. La souffrance rédemptrice, le deuil, permettront la renaissance. La mise en scène est effectuée par l’Union nationale des combattants et le Souvenir français au nord, par la Légion française des combattants en zone Sud. La population n’adhère guère car elle est germanophobe et les Allemands sont méfiants, d’autant que la Résistance a vite fait de s’en emparer. Vichy crée donc une nouvelle cérémonie de guerre pour incarner l’avenir de la Révolution nationale, l’anniversaire de la Légion, dont les rituels s’inspirent des cérémonies païennes et martiales qui impressionnent tant les hommes de Vichy et les collaborateurs.
La Résistance s’empare de l’arme culturelle des fêtes de guerre pour affirmer sa propre identité et invente ses propres célébrations de guerre. Pour elle, le 11 novembre incarne l’attachement à une longue histoire nationale faite d’actes de résistance, de combats d’un peuple héritier des soldats républicains de l’an II. Dès le 11 novembre 1940, les incidents se multiplient et des tracts démontrent le poids de l’identité républicaine. La symbolique républicaine conserve son pouvoir subversif, le 11 novembre devient partout le point de ralliement des opposants. Les protestations sont pleines de référence à la Révolution française, preuve « du poids de la culture identitaire républicaine pour une génération marquée par la Grande Guerre ». C’est autour des monuments aux morts que la Résistance appelle à manifester et à chanter La Marseillaise. La Résistance célèbre également la fondation de la République le 10 août 1792 et plus encore, l’anniversaire de la victoire de Valmy.
De nouveau chômé et férié, le « 11 novembre de la liberté » retrouve en 1944 sa vocation fédératrice « en y ajoutant une dimension résistancialiste eschatologique ». La fête parisienne réunit plus d’un million de personnes qui remontent les Champs-Élysées pendant cinq heures après les cérémonies du matin. Désormais les 11 novembre ont un triple objectif : honorer les libérateurs, alliés ou résistants, rendre hommage à la Grande Guerre et incarner une France rénovée. Mais « deux identités nationales se font déjà face dans ces cérémonies, l’une capitaliste et libérale et l’autre communisante et étatique (…) Seule identité républicaine classique reste tolérable, à condition qu’elle soit revue par les déterminants gaullistes et communistes ».
Mutations : enjeux mémoriels, guerres oubliées et identités (de 1945 à nos jours)
Célébrer une nouvelle mémoire de guerre (1945-1958)
La France continue d’accorder à la mémoire de guerre et aux commémorations une grande valeur identitaire. Mais dans le nouveau contexte politique, une compétition commémorative s’engage entre trois protagonistes : le gouvernement « aux représentations républicaines classiques qui tentent d’en revenir aux fondamentaux identitaires des fêtes de guerre », les gaullistes et les communistes. Avec la journée de commémoration du 18 juin 1945, s’ébauche « une sorte de culte gaulliste unissant le pays autour de l’homme providentiel, sauveur de la République ». Le premier 11 novembre de paix est rebaptisé « commémoration des morts civils et militaires de 1939-1945 ». De Gaulle exige une cérémonie exemplaire et grandiose autour de quatre lieux emblématiques de la Grande Guerre : l’Arc de Triomphe, la statue de Clemenceau, le monument Foch et les Invalides. Ce que De Gaulle appelle la « Guerre de 30 ans » est symbolisée par la translation au Mont-Valérien de 15 corps amenés en trois cortèges des portes de Paris aux Invalides, puis portés à l’Arc de Triomphe.
La résistance devient « le marqueur des nouvelles célébrations de guerre dont chaque camp s’arroge le monopole ». Des lieux incarnent cette querelle : pour les gaullistes, c’est le Mont-Valérien ; pour les communistes, ce sont le Mur des Fédérés ou le cimetière d’Ivry ; pour tous, l’Arc de Triomphe. Les scénographies aussi s’opposent. À partir de 1947, « communistes et gaullistes tentent plus que jamais de renforcer leur audience par une interprétation partisane des fêtes et mémoires de la résistance ». La tension est à son comble lors des cérémonies du 11 novembre 1947, « faisant voler en éclats l’identité d’une nation soudée par un passé et un destin communs ». Ces divisions se maintiennent dans les années suivantes.
Au milieu des années 50 des éléments nouveaux influent sur les pratiques identitaires : la fin de la guerre d’Indochine et le début de la guerre d’Algérie, la construction de l’Europe et la querelle de la Communauté européenne de défense, la remise en cause de l’unicité de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale avec les revendications commémoratives des déportés. Une loi d’avril 1954 crée « la Journée nationale des victimes et des héros de la déportation ». Cette célébration se veut fédératrice : c’est la nation entière qui honore la mémoire de tous les déportés, raciaux compris, sans oublier les survivants. Mais elle ouvre la voie à la reconnaissance de la singularité de la déportation raciale.
Les colonies sont alors systématiquement conviées aux fêtes, à la seule condition de ne pas évoquer les conflits en cours. Les troupes coloniales défilent à chaque célébration parisienne et les discours célèbrent l’union de la France et de ses colonies. Mais cette représentation idyllique se brouille avec les débuts de la guerre d’Algérie.
Le chant du cygne des fêtes de guerre unitaires (Années 1960-1990)
« De Gaulle, marqué par la doxa festive de l’avant-guerre, perçoit tout le profit qu’il peut tirer de belles célébrations pour promouvoir sa geste fédératrice. Elle doit servir à retrouver les racines d’une France unie dans laquelle il réalisera les changements politiques et institutionnels auxquels il aspire ». L’État multiplie les constructions de musées dédiés à la résistance et augmente considérablement les crédits alloués aux commémorations. En 1964, le syncrétisme de cette politique gaullienne est illustré par le cinquantenaire de 1914 et par le 20e anniversaire de la Libération de 1944. Mais les fêtes de guerre peinent de plus en plus à être une fabrique identitaire. « La vision unanimiste et héroïque ne fait plus consensus dans une société de consommation travaillée par l’hédonisme ».
« Au tournant des années 1970, la question de la place de la mémoire juive dans la mémoire nationale de guerre se pose avec une acuité nouvelle depuis la guerre des Six jours et le procès Eichmann. En outre, de nouveaux travaux ébrèchent le mythe unitaire de la résistance et érodent le résistancialisme gaulliste et communiste ». Le président Giscard d’Estaing initie une nouvelle politique mémorielle et festive, afin de modeler une nouvelle identité nationale. Il met fin à la commémoration de la victoire alliée le 8 mai et propose de remplacer cette journée par une journée de l’Europe, tout en faisant du 11 novembre une grande journée nationale du souvenir regroupant les mémoires de toutes les guerres. Il tire ainsi un trait sur l’héritage de la résistance et de la lutte contre le nazisme qui fonde l’identité française. La majorité de la classe politique, gauche et droite confondues, et une large partie de l’opinion publique s’indignent. En voulant populariser sa vision d’une double identité française et européenne, le pouvoir a définitivement brouillé la fonction des fêtes.
Avec les années 1980 l’obsession commémorative se fait jour, les représentations identitaires se fragmentent et les « Journées mémorielles » font leur apparition. L’assemblée vote à l’unanimité le rétablissement du 8 mai comme fête nationale, chômée et fériée. Lors des commémorations de 1984, les cérémonies évoquent largement l’ouverture à l’Europe et l’identité européenne. L’européanisation des fêtes de guerre est de plus en plus forte, tandis qu’un conseil européen, en 1985, fait du 9 mai une « Journée de l’Europe » en mémoire du discours fondateur de Robert Schuman, le 9 mai 1950. En 1995, pour la première fois, des Allemands sont conviés au 8 mai. Éclipsé par le 8 mai, le 11 novembre paraît désormais étriqué et national.
Mutations et concurrences des fêtes de guerre (Années 1990 à nos jours)
« Mémoire et histoire saturent l’espace public et, si les commémorations sont l’objet de toutes les attentions, elles hésitent entre références unitaires héritées de la mémoire républicaine du 11 novembre, voir en partie du 8 mai et celles, plus éclatées, des mémoires particulières et des identités de groupes. ».
Les « Journées mémorielles » véhiculent un nouveau régime mémoriel et identitaire. La « Journée » est une cérémonie d’État organisée par le préfet. Mais elle n’est pas réellement nationale, car elle est surtout prise en charge par des associations de victimes ou de combattants. Les victimes y sont honorées en tant que groupe particulier et non pas en tant que collectivité indifférenciée. Si ces groupes appartiennent à la nation, leurs membres ont péri à cause de leur particularisme, alors que les morts indifférenciées de 1870, 1914 ou 1940 sont tombés au nom de la France. Un historien a pu dire que les victimes honorées par les Journées ne sont souvent pas « mortes pour la France, mais à cause de la France ». Le choix d’une simple Journée permet de satisfaire les associations et les tenants d’une mémoire particulière, mais aussi l’État qui rend hommage à une catégorie particulière qui semble ainsi être liée à la nation. Ces journées ne sont ni fériées ni chômées, elles ont par ailleurs une bien moindre « visibilité médiatique ».
L’auteur retrace la genèse de ces journées dont il souligne pour chacune la signification et les enjeux : « Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France », fixée au 16 juillet ou au dimanche suivant par la loi du 10 juillet 2000 ; « Journée des mémoires de la traite négrière et de l’esclavage », fixée au 10 mai par la loi du 10 mai 2001 ; « Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres de formations supplétives » fixée au 25 septembre par un décret du 31 mars 2003 ; « Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et Tunisie », fixée au 5 décembre par un décret du 26 septembre 2003 ; « Journée d’hommage au morts pour la France en Indochine », fixée au 8 juin par un décret du 26 mai 2005 ; « Journée nationale de l’appel du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat », fixée aux 18 juin par un décret du 10 mars 2006 ; « Journée nationale du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie », fixée aux 19 mars par la loi du 8 novembre 2012.
Conclusion
La France des Journées mémorielles du début du XXIe siècle n’est plus celle de la IIIe République « et semble ne plus adhérer au message patriotique et identitaire des célébrations de guerre comme le montre leurs affluences en berne. Pourtant, ces cérémonies majoritaires dans le corpus festif actuel résistent assez bien, du moins dans les calendriers » et demeurent importantes dans l’imaginaire national. « Chacune de leur remise en cause déclenche un tollé des associations, des historiens et des politiques. Ces réactions montrent que le pays se cherche toujours un projet collectif fédérateur pour combattre son trouble identitaire, symptôme de sa dilution dans la globalisation et le projet européen (…) Pour la République, l’heure est venue de choisir ce qu’elle veut faire de ces célébrations de guerre. Mais elles ne produiront jamais de consensus, à plus forte raison identitaire, si les Français n’y sont pas associés par des débats mieux préparés que celui sur l’identité nationale, ou par l’enseignement de l’histoire. Or, les tendances à la réduction de cette matière dans les programmes scolaires (…), et l’autoritarisme de l’État en matière commémorative ne poussent pas à l’optimisme ».

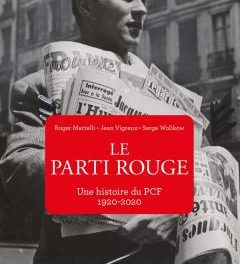

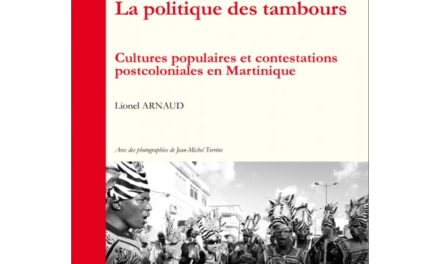
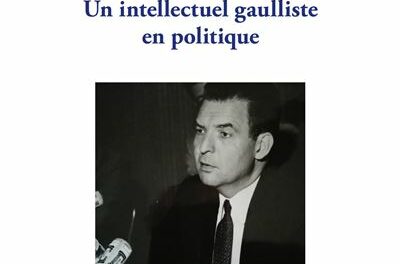









Trackbacks / Pingbacks