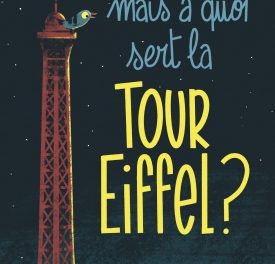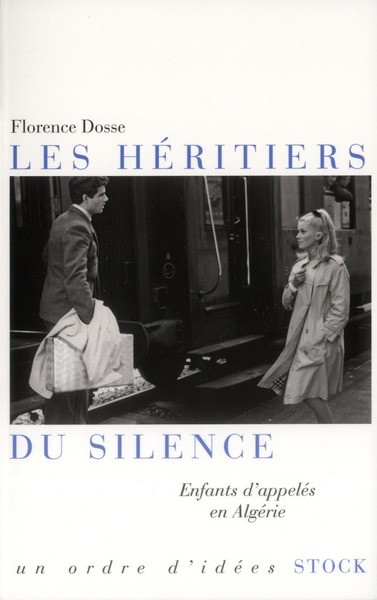
Je viens de remettre la main sur un ouvrage qui m’avait marqué, il y a trois ans, quand il est sorti. Il se trouve que je suis, comme Florence Dosse, l’un de ces héritiers du silence, comme des milliers d’autres, fils et filles des deux millions d’appelés en Algérie. Comme elle, j’ai été (nous avons, plutôt) été confronté à cette parole peu diserte sur ce qui s’y est déroulé. Ce n’était pas, dans le cas de mon père, un silence total. Les vingt-sept ans pendant lesquelles j’ai pu vivre à ses côtés ont été constamment ponctuées de références à ses vingt-sept mois en Algérie, jusqu’en janvier 1959. Mais il s’agissait d’anecdotes sur les opérations, sur la vie des paysans kabyles, sa seule permission en métropole, sur le massacre de Palestro (il a été affecté dans les parages de cette petite localité près d’un an après le drame, mais le souvenir en était encore très vif dans la région), les rappelés, les harkis, les gardes nocturnes dans les tours fortifiées construites au bord de l’Isser, etc. Des éléments relativement banals qui donnaient à comprendre un certain danger, tout en étant le fait saillant de sa vie, réveillés par de nombreux prétextes, qui ne camouflaient même pas son hostilité et sa rancune à l’égard de l’autorité militaire (et de l’autorité tout simplement), un mélange de compréhension et de répulsion à l’égard des Algériens, selon qu’ils étaient victimes ou fellaghas, et la fascination pour ce pays que beaucoup d’autres ont racontée… Mais je ne m’étais jamais interrogé sur la violence rentrée que je ne voyais pas, qu’exprimait son visage parfois très dur et son irritabilité explosive. C’était une guerre : même j’avais du mal à m’en représenter la réalité, avec les images des deux conflits mondiaux à l’esprit, je supposais inconsciemment que c’était difficile, d’autant qu’il n’est pas revenu chez lui pendant toute cette période.
Beaucoup plus tard, une dizaine d’années après sa disparition, le documentaire de Patrick Rotman, L’Ennemi intime. Violence dans la guerre d’Algérie (2002), le film de Florent Emilio Siri, L’Ennemi intime (2007), et ce que j’ai pu lire sur les exactions commises par l’armée française qui m’ont amené à me demander ce que mon propre père avait vraiment fait là-bas. Car jamais il n’avait évoqué ces faits-là devant moi, y compris au cours des occasions où il parlait de l’Algérie avec ceux qui y avaient été envoyés et que j’écoutais. L’impossibilité de retrouver ceux qui étaient dans son unité (soit parce qu’ils ne répondaient pas à mes courriers, soit qu’ils était morts), dont il citait le nom de temps en temps, en regardant des photographies, a empêché de lever ces interrogations. Même s’il était revenu presque physiquement indemne de cette guerre, j’avais pris conscience qu’il en était l’une des victimes.
Or, Florence Dosse a mené une véritable enquête pour comprendre elle aussi, mais en dépassant le cas de son père. Son histoire était sensiblement la même que la mienne : née la même année que moi, elle a entendu de nombreuses anecdotes, mais dont la banalité, dans son cas, l’ont conduite à se désintéresser de cette période. Le compte rendu d’un livre sur les appelés et la lecture de celui-ci (Claire Mauss-Copeaux, Les Appelés en Algérie. La parole confisquée, Hachette, 1999) l’ont subitement réveillée : les anecdotes ont alors été rattachées à une histoire collective beaucoup plus prégnante dans sa gravité. Elle a alors recueilli non seulement le témoignage d’appelés, d’enfants d’appelés, mais aussi celui des épouses et des petits-enfants, entre 2004 et 2007, dans plusieurs régions (Limousin, région parisienne) et dans plusieurs catégories sociales.
Quels que soient les lieux d’affectation et la période, elle a fait le constat que le silence de son père caractérise la majeure partie des appelés qu’elle a rencontrés. Mais il s’agit d’un « silence sédimenté », selon son expression, fait d’anecdotes ressassées, à peu près semblables quelles qu’aient été les conditions et les circonstances, réveillées par des événements médiatiques : la révélation de cas de torture (Massu, Le Pen, Aussaresses…), le procès Papon (17 octobre 1961), la reconnaissance très tardive de ce que les opérations de maintien de l’ordre étaient bien une guerre (1999), etc. Et domine également la volonté de revenir à une vie « normale » au retour dans la métropole, à quoi s’ajoute la réprobation des anciens combattants, qui, par incompréhension, avaient le sentiment d’avoir vécu, eux, de véritables guerres (et de les avoir gagnées). De là, la réaction des appelés a été de n’en parler qu’entre eux, à l’écart de ceux qui ne peuvent pas comprendre ou ne voulaient pas savoir, un entre-soi qui était la poursuite d’un récit commencé durant la guerre.
Les femmes ont eu une attitude plus ambiguë. Si elles ont vu leurs maris chercher à parler de l’Algérie, elles ne les y ont guère encouragés, soit par respect pour une douleur qu’elles avaient deviné et ne voulaient pas aviver, soit par incompréhension. Témoins du silence, elles ont globalement contribué au refoulement. En cela, elles rejoignent l’attitude de la majeure partie des Français, qui, après 1962, voulaient tourner la page d’une guerre mal renseignée par les médias et l’État, finalement très lointain géographiquement et mentalement, et cherchaient à rejeter tout ce qui pouvait y ramener. Ce constat rejoint l’enquête menée par les correspondants de l’IHTP (Raphaëlle Branche, Sylvie Thénault (dir.), La France en guerre. 1954-1962. Expériences métropolitaines de la guerre d’indépendance algérienne, éd. Autrement, coll. « Mémoires/Histoire », 2008, 501 pages), à savoir que la société refuse d’assumer ce passé-là.
Les enfants ont parfois cherché à comprendre davantage, mais sans réellement apprendre du père, sans approcher leur part intime et sensible. Ils n’ont alors pas oser pénétrer (ou n’ont pas compris comment le faire) dans un domaine dont ils sentaient confusément qu’il ne fallait pas franchir les limites, peuplé de non-dits, peut-être de honte enfouie.
La troisième génération est celle de la dernière chance : la parole du grand-père peut trouver en elle un réceptacle. C’est la seule à avoir bénéficier d’un enseignement scolaire sur la guerre d’Algérie, depuis 1983, même très restreint et imbriquée dans des questions plus larges. Mais là encore, Françoise Dosse constate que cette parole ne parvient que très difficilement à franchir le mur du silence. Elle fait l’analogie avec les déportés, dont on a pensé qu’ils avaient voulu se taire et rapporte les propos de Simone Veil à Annette Wieviorka : « personne n’avait envie de nous entendre […]. Il est vrai que la bêtise de certaines questions […], le doute parfois exprimé sur la véracité de nos récits […] nous ont incités à la prudence et à choisir nos interlocuteurs ». Il n’empêche que les enfants des appelés sont les héritiers du silence de leur père, et en même temps d’un conflit longtemps refoulé par la mémoire collective. Ils sont les porteurs d’une « mémoire seconde », indirecte, avec tout ce que cela suppose d’impensé et de traumatisme.
Le résultat de tout cela est une mémoire assez ambiguë sur la guerre d’Algérie : à la fois peu précise, et de plus en plus documentée (films, livres…).
Peu précise, car la période fait l’objet d’une certaine concurrence des mémoires, chacune s’estimant la seule à être légitime : celle des combattants algériens, celles des harkis, celle des appelés, celle de ceux qu’on a désigné sous le nom de pieds-noirs, celle des contemporains restés en métropole, celle de leurs descendants, aussi multiples que les groupes auxquels ils se rattachent, sans oublier la mémoire officielle, qui se subdivise en deux (France, Algérie), etc.
De plus en plus documentée, car la production sur cette période s’amplifie. L’ouverture (difficile) des archives a permis aux historiens de poser leurs questions et d’émettre des réponses, qui ont pu se diffuser dans les collèges et lycées à la faveur d’un intérêt grandissant dont rendent compte les programmes officiels. Des ouvrages toujours plus nombreux ont paru (romans, témoignages, bandes dessinées…), notamment à l’occasion des « anniversaires» du début ou de la fin de la guerre, et des films, documentaires ou de fiction, ont permis à un public plus large d’approcher ce qui s’est passé là-bas, non seulement pendant le conflit mais depuis le début de la