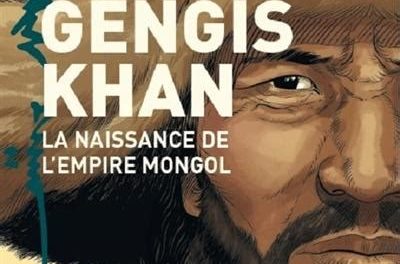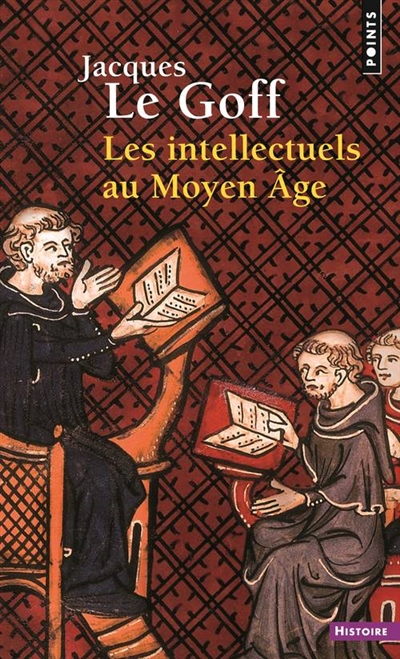 2014. Elève puis successeur de Fernand Braudel, en 1972, à la tête de la VIe section de l’École Pratique des Hautes Études qu’il transforme en École des Hautes Études en Sciences Sociales en 1975. Jacques Le Goff est considéré comme l’héritier de l’École des Annales et travailla toute sa vie au développement de l’anthropologie historique.
2014. Elève puis successeur de Fernand Braudel, en 1972, à la tête de la VIe section de l’École Pratique des Hautes Études qu’il transforme en École des Hautes Études en Sciences Sociales en 1975. Jacques Le Goff est considéré comme l’héritier de l’École des Annales et travailla toute sa vie au développement de l’anthropologie historique.Le XIIe siècle : la naissance des écoles urbaines et de l’intellectuel
L’ouvrage s’ouvre sur un présupposé historiographique : celui de renaissance au XIIe siècle. L’existence de cette renaissance est débattue. Sur ce point, la lecture de l’ouvrage de Jacques Verger (La renaissance du XIIe siècle, Paris, Cerf, 1996) est indispensable. L’ouvrage présente cette période comme une rupture. Or, si elle marque des renouveaux, révèle du nouveau, elle est également une période de transition et de contradictions. La démarche intellectuelle du XIIe siècle est tout autant monastique que cathédrale.
Jacques Le Goff a proposé Pierre Abélard comme premier intellectuel. Abélard n’appartient pas au milieu monastique et fait profession de maître. Il répond en cela à la définition de l’intellectuel selon Le Goff. De plus, il a la particularité de proposer à la fois une logique et une éthique (Ethica seu Scito te ipsum/Connais toi toi-même). Il se montre original en insistant sur la notion d’intention. Là où Jacques Le Goff s’est trompé, c’est en affirmant que « nul plus qu’Abélard n’a réclamé l’alliance de la raison et de la foi ». Aucun penseur médiéval n’utilise pas la raison pour penser sa foi.
Par sa définition de l’intellectuel, Jacques Le Goff a écarté de nombreux penseurs médiévaux : Pierre Damien, Lanfranc de Pavie, Bérenger de Tours ou encore Anselme de Cantorbéry. Certes, ces penseurs sont des moines et vivent et rédigent avant la renaissance du XIIe siècle. Mais Jacques Le Goff a écarté aussi Bernard de Clairvaux. Or, Bernard, en défendant un retour à Augustin, participe lui-aussi à la renaissance du XIIe siècle. Il propose une théologie nouvelle qui combine de manière originale deux thèmes apparemment contradictoires : l’humilité et la déification. Son influence sur les penseurs postérieurs, tel Bonaventure, n’est plus à minimiser. L’introduction à ses œuvres complètes (Introduction générale aux œuvres complètes : histoire, mentalités, spiritualité, Paris, Cerf, 2010) est à consulter.
L’ouvrage rappelle l’importance des écoles urbaines cathédrales. Celle de Chartes participe à la renaissance du XIIe siècle. Intéressée par les sciences, développant une théorie naturaliste posant de manière nouvelle le rapport de Dieu et de la nature, cette école s’illustre par ses maîtres : Thierry, Guillaume… Si l’école de Chartres participe bien à cette renaissance, l’école de Saint-Victor, importante elle aussi n’est pas présentée. Les travaux de Patrice Sicard (Hugues de Saint Victor et son école, Turnhout, Brepols, 1991 ; Théologies victorines, Paris, Parole et Silence, 2008) ont depuis révélé l’importance de ses maîtres et notamment d’Hugues.
Le XIIIe siècle : la naissance de l’université et la transformation de la figure de l’intellectuel
Jacques Le Goff a insisté sur le XIIIe siècle. Le cadre institutionnel évolue : les écoles urbaines se rassemblent en université, les maîtres forment désormais des corporations. L’intellectuel s’insère dans un cadre institutionnel plus organisé, plus hiérarchisé. Il est lui-même le produit de ce cadre qui le forme. L’intellectuel est un universitaire.
Jacques Le Goff a présenté les grandes transformations apportées par l’enseignement universitaire. Le livre devient un véritable instrument de travail. Les intellectuels lisent et commentent la Bible, compilent et articulent leurs connaissances en rédigeant des sommes… Les problèmes et leurs réponses s’exposent sous la forme de questions, d’arguments opposés et favorables à la thèse puis d’une réponse argumentée. L’université invente une nouvelle manière d’enseigner et d’étudier : la scolastique.
Jacques Le Goff a bien montré que la naissance de l’université change le statut du maître. La plus grande querelle oppose les maîtres séculiers aux maîtres réguliers. Cette querelle a pour cause une rivalité de pouvoir mais aussi financière. Le maître est payé par ses étudiants. Mais si la création d’une institution commune renforce ces querelles, celles-ci existaient auparavant. La lecture des travaux de Jacques Verger sur la naissance des universités peut être utile.
L’ouvrage présente les grands débats intellectuels du XIIIe siècle. Selon Jacques Le Goff, les débats ont pour enjeux l’équilibre entre la foi et la raison remis en cause par l’aristotélisme et averroïsme. Sur ce point, l’interprétation de Jacques Le Goff des querelles universitaires, notamment parisiennes, est très vieillie. Les travaux de François Xavier Putallaz (Insolente liberté. Controverses et condamnations au XIIIe siècle, Paris-Fribourg, Cerf-Éditions Universitaires, 1993) et de Luca Bianchi (Censure et liberté à l’université de Paris. XIIIe-XIVe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1999) sont indispensables sur ce thème.
Jacques Le Goff a laissé entendre que le XIIIe siècle est le siècle de l’aristotélisme. Son propos doit être fortement nuancé. D’abord, parce que la catégorie même d’aristotélisme est inconnue au Moyen Âge. En réalité, il s’agit d’un aristotélisme néo-platonisant. L’étude récente de Mary Beth Ingham (La vie de la sagesse, Le stoïcisme au Moyen Âge, Paris, Cerf, 2008) révèle même l’importance du stoïcisme. Ensuite parce qu’il n’est plus possible d’interpréter l’aristotélisme comme une forme de pensée étrangère envahissant une doctrine fondée uniquement sur les données de la foi. Ensuite parce que le débat ne porte pas sur une opposition entre une théologie classique d’inspiration augustinienne opposée à une irruption des théories aristotéliciennes. À la fin du XIIIe siècle, il porte plutôt sur la façon d’intégrer les données aristotéliciennes compatibles avec la foi au discours théologique. Le débat ne porte pas davantage sur une opposition entre sciences sacrées et sciences profanes. Il porte avant tout sur la définition scientifique de l’objet et de la méthode de la théologie. Ce problème se pose dès le début du XIIIe siècle avec Guillaume d’Auxerre. Sur ce pont la lecture de l’ouvrage de Christian Trottmann (Théologie et noétique au XIIIe siècle. La recherche d’un statut, Paris, Vrin, 2000) s’avère fort enrichissant.
Jacques Le Goff a eu raison de souligner que chaque commentateur possède son Aristote. Mais son propos peut être contredit sur un point. Jacques Le Goff a mentionné qu’Albert le Grand et Thomas d’Aquin veulent concilier Aristote et la Bible. Le projet annoncé par Albert est de rendre Aristote intelligible aux Latins mais son projet est d’autonomiser la philosophie, jusqu’à présent subalternée, par rapport à la théologie et en définissant un objet et une méthode. Cette démarche est reprise ensuite par Thomas. Albert est un penseur charnière du XIIIe siècle, comme le montrent les études d’Alain de Libera (Métaphysique et noétique : Albert le Grand, Paris, Vrin, 2005), à la source de la démarche des « averroïstes ».
Jacques Le Goff a évoqué les « averroïstes » qui enseignent la « double vérité », à savoir une vérité philosophique fondée sur la raison qui serait contraire à une vérité théologique fondée sur la foi mais qui serait elle-aussi admise. Jacques Le Goff a hérité d’une interprétation transmise par Ernest Renan qui n’a aujourd’hui plus cours. Alain de Libera et Luca Bianchi (Pour une histoire de la double vérité, Paris, Vrin, 2008) ont rappelé que qu’aucun maître n’a professé de double vérité. Ni Siger de Brabant (Ruedi Imbach et François-Xavier Putallaz, Profession philosophe : Siger de Brabant, Paris, Cerf 1997), ni Boèce de Dacie. L’enjeu de la querelle est à la fois doctrinal et institutionnel. Les maîtres es-arts jusque là cantonné à un rôle d’enseignant des arts en vue d’une préparation aux études de théologie cherchent à autonomiser leur statut. Pour cela, ils enseignent une théorie éthique, inspirée du Livre X de l’Éthique à Nicomaque, qui assure que la vie parfaite est celle du philosophe qu’ils incarnent. Tel est aussi le but des condamnations de 1270 et de 1277 : cantonner les maîtres es-arts dans leur rôle subalterne.
Les XIVe et XVe siècles : l’université comme lieu de pouvoir et le déclin de la figure de l’universitaire
L’ouvrage accorde une place importante à Jean Duns Scot et à Guillaume d’Ockham. L’interprétation de Jacques Le Goff est vieillie sur ce point. Il a vu dans les œuvres des deux franciscains un déclin de l’usage de la raison. L’œuvre de Guillaume d’Ockham, lue comme rendant Dieu inaccessible à la raison, préparerait l’œuvre pessimiste de Marin de Luther. Il n’en est rien. Cette vision du Moyen Âge est trop marquée par une lecture thomiste de l’histoire de la théologie et, plus généralement, de la pensée médiévale qui voit dans le XIIIe siècle l’apogée de la théologie. Certes le XIIIe siècle est un siècle particulièrement riche mais l’historiographie récente montre que les autres siècles le sont également. Jean Duns Scot est lui-aussi un penseur innovant. Sur cet auteur, la lecture de l’ouvrage d’Olivier Boulnois (Duns Scot. La rigueur de la charité, Paris, Cerf, 1997) est indispensable. Concernant Guillaume d’Ockham, la lecture de l’ouvrage de Joël Biard (Guillaume d’Ockham et la théologie, Paris, Cerf, 1997) est elle-aussi indispensable.
L’ouvrage reprend un présupposé historiographique : celui du déclin de la scolastique. Les universités sont devenues des lieux de pouvoir, tenus par des maîtres qui se définissent comme supérieurs aux étudiants et au commun des mortels. Cette vision de la corporation des maîtres et de l’enseignement aurait contribué à une stérilisation de l’enseignement fondé sur l’étude de questions vides de sens. La scolastique serait « décadente ». Rabelais, parmi d’autres, critique l’université médiévale. Le Moyen Âge serait en déclin. La Renaissance s’annoncerait.
XVe siècle : l’apparition de nouvelles figures d’intellectuels
Jacques Le Goff a fait donc apparaître de nouvelles figures intellectuelles qui s’opposent à celle de l’universitaire. D’abord, il a présenté le mystique qu’il interprète comme un anti rationaliste dont le message simple touche le peuple. Il est possible de contredire cette interprétation. Maître Eckhart, représentant de la mystique rhénane, est mystique parce que théologien. Sa mystique s’appuie sur de solides bases philosophiques et théologiques et notamment sur l’œuvre de Denys l’Aréopagite. Étonnamment, l’historien retrouve Albert le Grand à la source de ce courant. Ensuite, Jacques Le Goff a présenté l’humaniste, incarné par Jacques Lefèvre d’Étaples ou Lorenzo Valla, dont le rôle et l’activité rompt avec celle de l’universitaire. Celui-ci abandonne le lien entre l’étude et l’enseignement et se retire dans le calme de son cabinet de travail. Ses découvertes vont permettre le progrès de l’humanité.
L’interprétation de Jacques Le Goff est celle que les hommes de la Renaissance ont eue du Moyen Âge. Or, les césures entre l’Antiquité tardive et le Moyen Âge puis entre le Moyen Âge n’existent pas. Cette fin du moyen Âge est davantage une transition et une vision de la Renaissance comme une période de nouveautés, de renouveau mais aussi d’abandon semble plus juste. Sur cette période, la lecture de l’ouvrage de Jacques Verger (Les gens de savoir en Europe à la fin du Moyen Âge, Paris, PUF, 1998) s’avère utile.
Pourquoi lire ce livre ?
Ce livre peut être lu pour deux raisons. La première raison pour sa thèse scientifique. Avec cet ouvrage, Jacques Le Goff a souligné l’importance de la formation du pouvoir universitaire, autrement dit la mise en place d’une nouvelle figure du système trifonctionnel de Georges Dumézil, à savoir celle formée par le pouvoir monarchique, le pouvoir clérical et le pouvoir universitaire. L’université se dote à la fois d’un idéal politique et éthique comme le théorise Dante. Néanmoins, cette thèse peut être approfondie. Jacques Le Goff a adopté la distinction gramscienne faite entre l’intellectuel organique et l’intellectuel critique. Alain de Libera montre que l’intellectuel est, en réalité, placé tantôt en position organique et tantôt en position critique. John Wyclif incarne cet intellectuel organique qui devient critique.
La deuxième raison est que l’ouvrage, riche d’une intéressante iconographie, est un classique. Jacques Le Goff est un des grands médiévistes du XXe siècle. Il n’a cessé de proposer de nouvelles pistes de réflexion sur le Moyen Âge dont il n’a eu de cesse de montrer en quoi il est complexe et riche. Lors de sa première parution, en 1957, son ouvrage était pionnier. Son mérite est de montrer que le Moyen Âge est aussi intellectuel et que ses maîtres s’y révèlent curieux et innovants. Ce livre intéressera les médiévistes mais aussi les historiens des idées et les philosophes. Mais ce livre a les limites que lui confère la date de sa rédaction. Le texte en lui-même date de 1957. La mise à jour de la bibliographie a été arrêtée en en 2000. Pour celui qui ne désire avoir qu’une introduction, cette lecture peut suffire. Et le lecteur prendra plaisir tant le style d’écriture est clair tout en étant très précis. Un enseignant pourra utiliser tel ou tel extrait pour faire travailler ses élèves. Mais pour celui qui souhaite travailler ce sujet, d’autres lectures seront nécessaires. Deux ouvrages généraux peuvent être conseillés : l’un de Jacques Paul (Histoire intellectuelle de l’Occident médiéval, Paris, Armand Colin, 1998, nvelle éd), plus historique, et l’autre d’Alain de Libera (Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1996, 2e éd), plus philosophique.