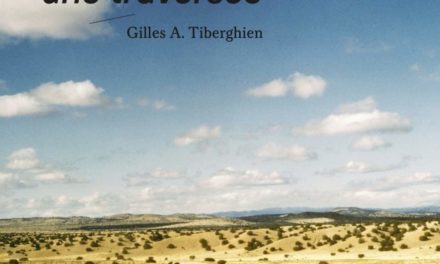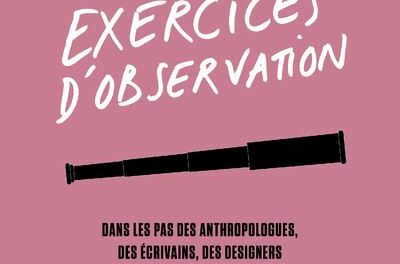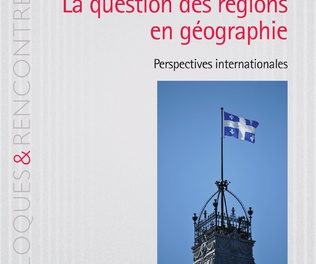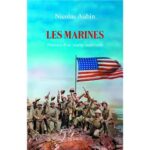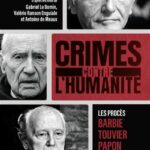« L’air de la ville rend libre » disait Max Weber. Pourtant, à l’ère de l’urbain généralisé, de la montée du travail féminin dans les sociétés occidentales, la ville apparaît encore comme un lieu où la liberté de déplacement des populations n’est pas si évidente que cela. Au-delà de la mise en œuvre d’enclaves fermées (gated communities), il apparaît que des barrières mentales demeurent au sein de l’espace urbain. C’est ce que Guy Di Méo appelle « les murs invisibles ». Professeur des universités à Bordeaux III Michel de Montaigne, membre du laboratoire UMR ADES, il applique cette expression aux pratiques spatiales d’un groupe sexué : les femmes. Pour cela, il a entamé une recherche portant sur une soixantaine de femmes bordelaises et leurs pratiques du territoire urbain. La création d’une nouvelle collection chez Armand Colin, consacrée à la recherche (Recherches), fin 2010, est l’occasion de rendre publics les résultats de recherches en géographie, en sociologie et ici en géographie sociale et du genre.
La question de la pratique de l’espace public par le « deuxième sexe » montre à quel point les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant l’espace, non pas que l’accès de certains lieux de la ville française soient interdits aux femmes mais plutôt qu’elles s’en interdisent l’accès. Guy Di Méo nomme cette autocensure : « les murs invisibles ». Comme le « plafond de verre », qui borne la progression salariale des femmes, les murs invisibles sont des parois de verre qui jalonnent le tissu urbain : une sorte de ségrégation genro-spatiale volontaire. Ce constat, fait à partir d’un échantillon de femmes, ne permet pas de généraliser le cas : les femmes ne forment pas un groupe homogène. Ceci n’est pas non plus un livre sur la domination masculine (les hommes n’y sont pas étudiés). Jusque là les travaux de Guy Di Méo ont porté sur les « territoires du quotidien » partant du postulat d’un homme universel asexué. C’est à la suite des travaux de Jacqueline Coutras, mais aussi de discussions que l’auteur a eu avec Jean-François Staszak et Claire Hancock qu’il s’est intéressé à une approche genrée de l’espace. Jusque là, Guy Di Méo n’avait pas jugé utile de discuter le principe de mixité spatiale de la société française. Même s’il a mené cette étude, il continue de porter un regard critique sur le genre et dénonce ses dérives. Il estime qu’un distinguo homme / femme ne peut pas être envisagé : « Cependant, le genre n’explique pas tout et ne saurait constituer une entrée unique pour nos investigations. Sans les structures sociales, il n’est rien » (p. 15) « L’âge, la condition sociale et économique, l’environnement géographique, historique et culturel » de chaque femme doit être pris en compte au même titre que leur appartenance au sexe féminin.
Cinquante sept femmes ont été interrogées. Elles étaient toutes en mesure de se déplacer et de fréquenter l’agglomération de Bordeaux. Cette enquête a été réalisée par une jeune étudiante de M2 Recherche : Catherine Hoorelbecke. Les femmes choisies l’ont été afin de répondre aux profils que Guy Di Méo avait élaboré en amont de la recherche. Il explique le recours à une enquête réalisée par une étudiante en raison de son âge et de son sexe. Il estimait que ceux-ci seraient des obstacles pour faire parler les femmes. Trois profils ont été mis en évidence. Le premier est celui des femmes marquées par l’intérieur, c’est-à-dire dont l’espace de vie dominant est celui de la maison. Ces femmes sortent peu en raison du métier qu’elles pratiquent (gardiennes d’immeubles, charcutière…) ou parce qu’elles sont malades (elles ont des difficultés pour marcher ou sont en arrêt maladie). Bien souvent, elles ne possèdent pas de moyens de locomotion propres et dépendent des transports en commun ou de leurs proches qui les véhiculent. Elles n’ont pas toujours des moyens financiers à leur disposition. Elles ne trouvent pas de raison de se déplacer. Le second profil est celui des femmes qui n’ont presque pas de murs invisibles dans leur ville et pour qui l’extérieur tient une place importante dans leurs journées. Elles sont plutôt jeunes, célibataires (même si le groupe comporte aussi des femmes plus âgées voire même handicapées). Elles sont actives ou au chômage. Elles ont globalement peu investi leur domicile. Pour elles, la ville est une ressource pour établir des contacts humains. Cela ne signifie pas que la ville soit un espace sans aspérités : les lieux sombres ou occupés par la foule sont évités. La grande diversité de ce groupe montre à quel point l’âge n’est pas déterminant dans les mobilités. Enfin, le troisième groupe, le plus important au niveau numérique, comprend l’ensemble des femmes qui se trouvent dans une situation intermédiaire aux deux autres groupes. Il est difficile à cerner car la notion de murs invisibles n’est pas propre à un âge, une maladie, au fait d’être active ou pas. L’essentiel du corps du livre, par le biais de récits de ville, montre à quel point la situation est complexe. Il apparait toutefois que le lieu de résidence joue une place centrale dans le rapport des femmes à la ville, qu’elles le fuient ou qu’elle lui donnent une place centrale. L’éducation joue aussi pour beaucoup, dans la mise en place des murs invisibles plus ou moins épais et même celles qui n’ont pas conscience de s’interdire certains lieux urbains légitiment leur évitement par la formule « je n’ai rien à y faire ».
Le fait que Guy Di Méo n’ait pas mené le même type d’enquête chez les hommes montre les limites de l’étude. La mise en place de murs invisibles est-elle le seul fait des femmes ? Guy Di Méo n’a finalement qu’un témoignage sur 57, celui de Bernadette, qui montre la répartition sexuée de l’espace : « Une cité des femmes ». Bernadette évoque les mobilités de son mari et cela permet de voir l’autre côté. Pour être concluante cette étude aurait mérité d’être menée auprès d’autant d’hommes que de femmes. Et là, Guy Di Méo aurait pu prendre en charge les entretiens sans craindre d’être victime d’un ostracisme féminin.
Catherine Didier-Fèvre © Les Clionautes