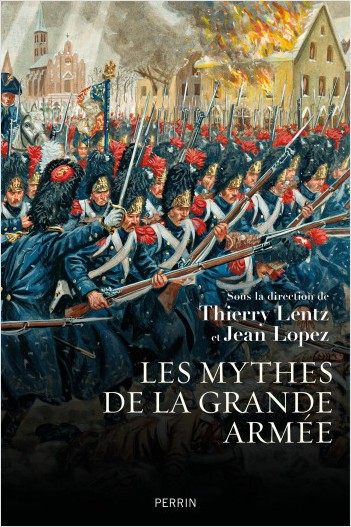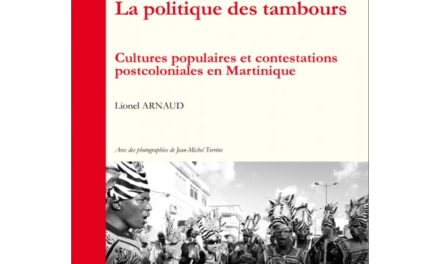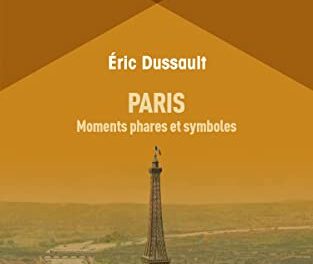Il n’en fallait pas moins : dix historiens pour vingt-quatre contributions, afin de revisiter les principaux « monuments » de la mémoire militaire impériale, faire la chasse aux mythes et aux légendes (dorée ou noire), et déconstruire s’il le faut les récits épiques pour ne pas dire homériques. Tel est l’objectif de ce nouvel ouvrage collectif publié aux éditions Perrin. Autrement dit, il s’agit de confronter les croyances ancrées dans le grand public aux travaux des historiens. Théoriciens militaires, romanciers, grognards, mémorialistes ont été les vecteurs du mythe. Plus récemment, le cinéma, la série télé, le jeu vidéo y participent aussi.
Citons cette phrase dans la présentation générale de Thierry Lentz et Jean Lopez, qui résume bien l’enjeu de ce recueil : « L’historien se retrouve ainsi au beau milieu de ce fleuve épique, à draguer boues et alluvions, à repérer les couches de légendes, à tamiser idées reçues, demi-vérités, vrais mensonges et incompréhensions ».
La première de couverture n’est pas sans rappeler l’iconographie des boîtes de petites figurines à peindre de la marque Airfix, vendues au début années 70. En ce temps-là, les enfants étaient attirés par ces emballages, qui les faisaient pénétrer dans un univers historique pour jouer à la guerre. De toute évidence l’illustrateur, Giuseppe Rava, a probablement été inspiré par des images de jeunesse, et par des œuvres de Meissonier et de Detaille. Ce choix éditorial est bien vu, car on peut saisir la filiation artistique et la représentation normée ou conventionnelle de la Grande Armée qui perdure encore aujourd’hui. Sous l’uniforme méticuleusement restitué, on met en scène le souvenir de la gloire passée d’une troupe à la manœuvre.
Le format éditorial retenu est particulièrement efficace. Chaque contribution d’une vingtaine de pages, peut se lire indépendamment des autres. Chaque démonstration est rigoureusement construite. Les auteurs croisent les sources et les thèses.
L’ouvrage est construit autour de 23 affirmations qui sont passées en revue par une dizaine de spécialistes mobilisés pour l’occasion.
Napoléon ignorait tout des « choses de la mer » (par Antoine Reverchon)
La stratégie maritime napoléonienne s’élabore sur trois axes :
– Reconstruire une flotte de haute mer capable de vaincre la Royal Navy dans une bataille décisive pour envahir la Grande-Bretagne.
– Multiplier les menaces navales dans les colonies et l’activité commerciale afin de disperser au maximum la flotte anglaise.
– Réunir les ressources nécessaires sur le littoral européen pour atteindre les deux premiers objectifs. En effet la capacité de construction d’un arsenal est liée à un bassin fluvial de voies navigables, notamment pour l’approvisionnement en bois (chêne, hêtre, pin). L’Empire dépense donc énormément pour creuser des canaux reliant la Seine à la Saône, la Seine à l’Escaut, le Rhône au Rhin.
Ainsi la marine impériale s’accroît. De 44 vaisseaux et 35 frégates en 1806 on passe respectivement à 73 et 45 en 1813. Cependant l’arsenal britannique est insurpassable avec 160 vaisseaux en 1814. Entre 1793 et 1815, la Royal Navy a détruit ou capturé 92 vaisseaux et 172 frégates de la marine impériale (ou de ses alliés), alors que du coté anglais les pertes sont comparativement minimes : 5 vaisseaux et 16 frégates. A l’infériorité numérique française s’ajoute l’infériorité tactique des équipages, dont la qualité est médiocre. En effet, les officiers d’Ancien Régime avaient émigré. Ils sont remplacés par des capitaines de navires marchands. La création d’une école spéciale de la marine n’apparaît qu’en septembre 1810 (avec deux bateaux-écoles en rade de Brest et de Toulon). La marine impériale dispose néanmoins d’excellents ingénieurs constructeurs mais manque d’ouvriers spécialisés (charpentiers, cordeliers…), ce qui oblige à recourir à une main d’œuvre étrangère.
Afin de faire face à l’artillerie navale lourde à longue portée, et protéger les ports et arsenaux, Napoléon décide la construction de forts détachés à distance de la cible, car les traditionnelles fortifications « à la Vauban » ne suffisent plus. Fort Boyard, dans la rade d’Aix, est ainsi conçu sous le Premier Empire, mais n’est édifié qu’au Second.
Napoléon ne renonce pas à faire débarquer son armée sur les côtes anglaises après Trafalgar. Mais à partir de 1812, la campagne de Russie oblige à déconsidérer cet objectif naval.
La descente en Angleterre ne pouvait pas réussir (par Michel Roucaud)
Michel Roucaud revient sur la planification, dès 1803, du « camp de Boulogne » (1805). Cette ambitieuse et vaste opération militaire comprend la construction des bâtiments des flottilles et d’infrastructures portuaires de fortifications, l’entraînement des troupes (à embarquer et débarquer) et la reconnaissance des côtes. Ce plan d’opérations prend en compte des impératifs de logistique et d’intendance.
Pendant les deux années de planification, on produit 1 294 bâtiments de la flottille de guerre (chaloupes canonnières, péniches, bateaux canonniers) sur 150 chantiers.
N’ayant pas la maîtrise de la mer, Napoléon retourne aux « affaires terrestres ». « Puisque pour vaincre l’Angleterre, il faut dominer l’Europe, alors va pour la domination de l’Europe ! » (Thierry Lentz).
La Grande Armée vit sur le pays (par Antoine Reverchon)
Faisant référence à une lettre de Napoléon au maréchal Soult en 1810, plusieurs historiens considèrent que l’Empereur fait du pillage des pays conquis un principe stratégique.
Un point indiscutable est la recherche de la rapidité des mouvements, par la supériorité numérique pour livrer une bataille décisive, comme le rappelle Jean-Roch Coignet dans ses Carnets : « Notre Empereur ne se sert pas de nos bras pour faire la guerre mais de nos jambes ».
La priorité de Napoléon est l’organisation du ravitaillement, l’équipement des troupes et le suivi des effectifs disponibles pour la marche et le combat. La plupart du temps le soldat reste à la charge du service d’intendance, quand il séjourne dans les casernes, bivouacs, camps et cantonnements d’étape. En plus de loger les soldats, il faut aussi fournir les munitions, les uniformes, les chaussures et les armes de rechange.
A partir de 1807, le système de sous-traitance par des « régies » privées (des pains, de la viande, du fourrage…), est abandonné pour être géré par des fonctionnaires. Napoléon crée par la suite le corps militaire du « train des équipages ». Ainsi aujourd’hui, on parlerait d’une « chaîne logistique » en assurant le transport du ravitaillement, des munitions et des équipements jusqu’aux troupes en marche ou au combat. Toujours en matière logistique, la construction de moulins et de fours demeure essentielle. Ils peuvent être démontables et portatifs, quand ils ne sont pas en ville.
Mais lorsque l’armée pénètre en territoire ennemi, la réquisition se met en place. L’Empereur la justifie par les besoins liés à la concentration des troupes.
En 1809, Napoléon écrit à Berthier, son chef d’état-major, qu’il faut « 60 cartouches par homme portant un fusil » et qu’il en faut « 60 dans les dépôts qui peuvent arriver à quatre ou cinq jours de distance pour renouveler celles consommées ». Il s’estime satisfait si les corps de l’armée disposent de 10 millions de cartouches ou « si l’armée en a 5 millions pour les soldats, 5 millions au parc général et 5 millions de réserve à transporter par eau ou par les voitures du pays ».
Le contrôle des lignes de communication et la disponibilité du ravitaillement guide la marche et les combats de la Grande Armée. Il faut aussi prévoir d’évacuer les blessés, les prisonniers, les canons à réparer, d’acheminer les « régiments de marche » (les renforts de nouveaux conscrits), les « remontes » de cavalerie (les chevaux frais), les fourgons contenant la solde des troupes, et les ordres et messages de l’état-major.
Lorsque la solde est insuffisante et que l’intendance ne suit pas, le pillage pourtant illégal, se généralise.
Antoine Reverchon, affirme donc que la guerre n’a pas payé la guerre.
Napoléon a démontré son infaillibilité militaire (par Stéphane Béraud)
Soucieux de sa postérité, l’Empereur s’attache à Sainte-Hélène à réécrire sa propre épopée en vue de préserver sa gloire militaire. Plus que la victoire sur le terrain, il faut remporter la victoire dans l’esprit des peuples et de leurs élites.
En plus d’être en grand chef de guerre, Napoléon apparaît comme un génie de la propagande. L’objectif est d’assurer sa légitimité politique intérieure. Dès la première campagne d’Italie (1796), il utilise la presse pour son autopromotion. Le Bulletin de la Grande Armée, instrument de propagande, propose des comptes rendus qui décrivent avec précision les hauts faits des armées impériales. Le génie militaire de l’Empereur est valorisé. Certains événements relatés sont réécrits afin de magnifier les victoires.
Dans le « récit-propagande » par Berthier de la bataille de Marengo, la retraite désordonnée des troupes françaises est présentée comme un repli tactique prémédité pour piéger l’ennemi, avant de lancer une contre-attaque. Le rôle du général Desaix a été minimisé, tout comme la charge de cavalerie de Kellermann, qui dans la réalité serait de son initiative.
De même, le rapport du général Suchet contredit le 30e bulletin de la Grande Armée, qui décrit le récit de la noyade de 20 000 hommes dans les lacs gelés, lors de la bataille d’Austerlitz. Suchet mentionne la récupération de seulement trois corps de soldats noyés. La scène de la rupture de la glace sous le poids des troupes et des pièces d’artillerie serait donc imaginaire.
Le maréchal Grouchy est jugé responsable du désastre de Waterloo, par sa mauvaise exécution des ordres de l’Empereur. Pour conserver son infaillibilité militaire et sa clairvoyance, Napoléon discrédite Grouchy. Au final, ce sont les trahisons, les défaillances des subordonnées et le poids du nombre qui l’ont vaincu. Ainsi, « la vérité de l’histoire ne sera pas probablement ce qui a eu lieu, mais seulement ce qui sera raconté » (Las Cases, Mémorial).
La guerre de mouvement met fin à la guerre de siège (par Antoine Reverchon)
Clausewitz montre que Napoléon est en rupture avec les pratiques d’Ancien Régime, notamment la guerre de siège des places fortes. Pour schématiser, on a tendance à opposer la pratique de la guerre de position de l’Ancien Régime à la guerre de mouvement de la Révolution et de l’Empire.
Dans l’imaginaire collectif, la guerre napoléonienne se résume à des batailles et non à des sièges lents. Dans ses analyses de la stratégie militaire, le général Hubert Camon écrit : « Aucun capitaine n’a fait un plus large emploi de la fortification que Napoléon » (1914). L’historiographie récente semble aller dans ce sens.
Durant la guerre d’Espagne, les vingt-cinq sièges causent plus de pertes que l’ensemble des batailles rangées. Selon sa stratégie, Napoléon attache une certaine importance aux « dépôts » de l’armée. Ces places fortes (comme Dantzig en 1807 et en 1812) jouent un rôle essentiel dans la logistique. Elles renferment les vivres, les armes, les uniformes, les harnachements, les écuries de chevaux de remonte, les hôpitaux, les prisons, les moulins et les fours. Au fil de la progression des troupes, les « places de campagne » conquises sur l’ennemi privent l’adversaire de points d’appui.
La chute de Dantzig (24 mai 1807) conduit à la victoire de Friedland.
Napoléon justifie la fortification d’une ville (« place de campagne » ou « barrière défensive »), car elle permet la concentration des ressources et des unités.
Napoléon, ennemi du progrès ? (par Patrick Bouhet)
Cette contribution questionne la légende d’un Napoléon technophobe. Pour conforter cette thèse (Bainville, Tulard), on peut avancer que l’Empereur fait la guerre avec les armes héritées de l’Ancien Régime : le fusil modèle 1777, les canons de Gribeauval.
Guidé par le principe de réalité, le souci d’efficacité préoccupe Napoléon et l’emporte sur la recherche d’innovation, pourvu qu’un progrès technique soit viable, opportun sur le terrain, et bénéfique dans le cadre des opérations militaires. L’aspect quantitatif est un critère, car il faut pouvoir équiper des centaines de milliers d’hommes. L’approvisionnement des troupes reste donc une priorité.
La modernisation de l’équipement est lente. Ça et là, on distingue quelques ajustements. Pour s’adapter aux conditions de combat, les sabres de cavalerie légère passent d’une garde à une branche (à la hongroise) à une garde à trois branches (à l’allemande) qui protège mieux la main.
L’empereur contrôle tout (par Patrick Bouhet)
Il conviendrait mieux de parler de volonté de contrôle, liée au caractère et à la formation de Napoléon. Il est vrai que l’Empereur fait recueillir une masse considérable d’informations sur la situation de ses troupes, et sur l’ennemi. Ces données sont transmises par les ambassades, les espions, ou prélevées sur le terrain. De celles-ci découlent les prises de décision, à plusieurs niveaux (stratégique, opératif, politique).
A la fois chef d’État et général, Napoléon s’appuie sur la maison militaire (transmission, contrôle et exécution des ordres) et l’état-major dirigé par Berthier. Des dizaines de personnes accompagnent l’Empereur. Une difficulté réside dans la fiabilité de l’information reçue, par exemple pour comprendre les intentions de l’ennemi. Déjà à l’époque de Napoléon, deux modes de commandement existent : le commandement par ordre et le commandement par objectif, ce qui suppose dans ce dernier cas que le subordonné fasse preuve d’initiative et de responsabilité. On se base aussi sur l’intuition. Mais au fil du temps, le commandement de plus en plus centralisé perd de son efficacité.
Napoléon était un dieu pour ses grognards (par Stéphane Calvet)
Le grognard renvoie à l’iconographie du grenadier avec son bonnet à poil et sa pipe. On ne peut nier la fascination de ces hommes pour l’Empereur. Mais il ne faut cependant pas percevoir un bloc homogène, pendant et après le règne de Napoléon. Plusieurs générations de soldats se sont succédé. Les deux millions d’hommes qui auraient servi dans les armées du Consulat et de l’Empire, d’Arcole à Waterloo, avaient été recrutés pendant l’Ancien Régime et la Révolution (au moins un tiers), et surtout avec l’instauration de la conscription (loi Jourdan-Delbrel en 1798), imposant un service théorique de cinq ans. On dénombre dix-sept levées entre 1800 et 1814.
Les « soldats de l’An II » représentent à peine 10 % de l’effectif en 1811. On les retrouve essentiellement dans la Vieille Garde impériale.
Les armées sont avant tout celles de généraux. Par exemple, l’armée du Rhin est commandée par Moreau.
La Grande Armée est constituée à 70 % de ruraux, souvent illettrés. Au regard de la diversité des théâtres d’opérations militaires, seule une faible minorité de soldats a pu voir « l’Aigle » sur un champ de bataille.
La popularité et l’admiration à l’égard de Bonaparte commencent durant la campagne d’Italie de 1796-1797. De ces rangs sortent des fidèles totalement acquis à sa personne.
La Vieille Garde a rassemblé 20 000 hommes au maximum.
Pour autant une opposition militaire à cette dévotion existe. Des officiers et généraux, jaloux ou nostalgiques de la République, sont mis à l’écart. Cette forme d’épuration dans les rangs de l’armée vise à déjouer des tentatives de conspiration ou de complot. De nombreux jeunes hommes, réfractaires et déserteurs, insensibles au rêve de gloire militaire, refusent de se soumettre à la conscription.
Mais la promesse d’héroïsation suscite une indéniable adhésion. Auréolé de gloire, le militaire est placé au cœur de la Nation.
L’étude des correspondances entre les militaires et leurs familles montre que le combattant est persuadé du génie militaire de Napoléon, qui apportera la paix dans la gloire, en mettant fin aux hostilités, dans une bataille décisive au cri de « Vive l’Empereur ».
La publication du Mémorial de Sainte-Hélène prend le relais de l’autopropagande amorcée durant la campagne d’Italie. La légende va être aussi entretenue par des écrivains (Balzac, Hugo, Stendhal) et des peintres (Géricault, Charlet). Mais les vétérans cherchent avant tout à faire valoir leurs droits d’anciens combattants (trouver un emploi, se réinsérer dans la société civile), plutôt qu’à comploter contre le retour des Bourbons.
Sur l’estimation de 650 000 personnes mortes pendant les guerres de l’Empire, on en dénombre environ 200 000 « morts au champ d’honneur ». Il faudrait compter deux tiers emportés par les maladies (typhus, infections liées aux blessures de guerre). Il est probable aussi qu’un certain nombre de conscrits en a profité, en portant l’uniforme, pour entamer une autre vie dans un pays étranger. Cet aspect semble assez méconnu. On évalue à un million le nombre de rescapés.
La monarchie de Juillet opère un processus d’instrumentalisation de la légende, par opportunisme, dont l’apothéose correspond au retour des Cendres en 1840. D’un côté, les autorités sont en quête de légitimité populaire. De l’autre, les vétérans cherchent une récupération à des fins matérielles, sociales et culturelles. Les célébrations et les hommages se poursuivent sous le Second Empire (médaille de Sainte-Hélène en 1857).
En quête avant tout d’une reconnaissance légitime pour leur courage, les soldats, qui ont survécu à l’épopée napoléonienne, n’ont pas mis le culte de l’Empereur au centre de leur revendication.
Chaque soldat a un bâton de maréchal dans giberne (par Stéphane Calvet)
Cette affirmation relève du mythe. Elle fait référence à une phrase de Louis XVIII en août 1819 adressée aux élèves de l’École polytechnique et leur commandant le maréchal Oudinot. C’est l’occasion ici de rappeler que des roturiers ont accédé à l’épaulette durant l’Empire. Les romanciers vont par la suite entretenir le mythe de l’ascension sociale par le courage et la gloire. Cependant la culture militaire héritée de l’Ancien Régime, qui privilégie le rang et le nom, persiste.
Derrière les exemples des grandes figures historiques de Lannes, Murat, Coignet, partis de rien, le recrutement ou la nomination des officiers s’avère très divers. Avant la campagne de Russie (1812), les officiers sont majoritairement des anciens soldats de la Révolution. La méritocratie ne constitue pas le seul facteur d’avancement ou d’ascension. Il faut compter aussi avec la courtisanerie, les protections et la naissance.
La bravoure, le coup d’éclat, l’exploit individuel, les faits d’armes sont mis en valeur par la légende, moins dans la réalité, à la lecture des états de service. Malgré tout le courage au feu, et plus encore la blessure (de l’officier), facilitent l’avancement dans la carrière. Mais l’officier subalterne bénéficie moins rapidement d’une promotion.
Il est montré que le manque de civilité peut être une entrave à l’avancement. Les mauvais rapports des inspecteurs généraux conservés à Vincennes en témoignent. L’héroïsme ne fait donc pas tout… sans quand on s’appelle Cambronne ou Lassalle.
Davout, le meilleur des maréchaux ? (par Frédéric Bey)
Né en 1770, cet officier formé sous l’Ancien Régime est promu à cette dignité à seulement 34 ans.
A la tête du IIIe corps de la Grande Armée (1805), il prône la discipline et l’entraînement à la manœuvre des troupes. Il apparaît comme un officier tenace et réfléchi, suscitant parfois la jalousie, jusqu’à l’inimitié ou la défiance de Bernadotte et de Berthier. Lors la campagne de Russie, il dirige 67 000 hommes (Ier corps d’armée), autrement dit la formation principale de la Grande Armée, comprenant cinq divisions d’infanterie et une division de cavalerie légère. Il fait preuve de courage et de talents tactiques. Il se montre économe du sang de ses hommes et soucieux de l’approvisionnement.
Mais le désastre de cette campagne militaire le dépasse. Davout ne participe pas aux campagnes d’Allemagne (1813) et de France (1814). Rallié à Napoléon pendant les Cent-Jours, il est nommé ministre de la guerre, alors qu’il aurait préféré rester à la tête d’un corps d’armée.
Pour Napoléon, le maréchal Soult est le « plus grand manœuvrier d’Europe », et non Davout. Cependant sa rigueur, son professionnalisme impeccable, et son souci du maintien de l’excellence des troupes apportent à l’Empereur une certaine sécurité et lui garantit l’application des ordres.
Sur les vingt-six maréchaux du Premier Empire, quatre s’en détache. A l’efficacité d’un Davout prudent et constant, on opposera les charges folles de Murat, le courage de Ney et le panache de Lannes tué au milieu de ses hommes.
La cavalerie charge au galop, sabre au clair ! (par Patrick Bouhet)
La cavalerie est l’arme offensive par excellence, caractérisée par sa grande mobilité. Elle agit par le choc mais doit préserver sa cohésion pour être efficace.
La formation en colonne est utilisée pour charger l’infanterie quand le déploiement en ligne est rendu impossible par la topographie. Autrement dit tous les terrains ne lui sont pas favorables.
Cet article tend à corriger les représentations iconographiques et cinématographiques. En effet, une charge de cavalerie n’est pas une action désordonnée mais bien réglée, à la fois technique et précise. Les mêlées chaotiques et les charges effrénées des œuvres de fiction sont donc éloignées de la réalité des guerres napoléoniennes. Par exemple, l’officier qui contrôle l’unité et les trompettes qui transmettent les ordres, ne sont pas en première ligne mais au arrière du centre de l’unité.
Contrairement à l’artillerie, la cavalerie peut mener un combat de mêlée. L’infanterie est plus polyvalente, supportant tous les terrains et pouvant combattre par le feu et le choc.
Napoléon recherche la bataille décisive (par Patrick Bouhet)
Pour Napoléon, la victoire est le résultat d’opérations concomitantes réussies. Sans être une fin en soi, la bataille est un moyen de raccourcir la durée d’une campagne tout en tirant des avantages stratégiques et politiques. La stratégie retenue est souvent l’offensive. En gagnant une bataille, l’Empereur vise à amorcer la destruction de la cohésion des forces ennemies restantes.
Durant la bataille, il s’agit d’user l’adversaire, de créer un flottement dans les lignes ennemies par des manœuvres menaçantes, d’obliger la partie adverse à engager ses réserves. Napoléon cherche à imposer son rythme et à créer la surprise, à déstabiliser l’ennemi par une coopération interarme de qualité.
La bataille d’Austerlitz est l’aboutissement de dix-neuf rencontres et engagements militaires précédents. La bataille a une visée tactique et opérationnelle, car elle ne conduit pas à la fin de la guerre. Le caractère décisif, au sens militaire du terme, repose sur le fait qu’un des belligérants peut être battu temporairement, et donc n’a plus la capacité de poursuivre le combat. Cependant à partir de 1812 (campagne de Russie), et surtout durant la campagne d’Allemagne en 1813, on recherche davantage la bataille décisive (sans être réellement obtenue).
De manière générale, Napoléon a pour ambition de rester un souverain victorieux. Il faut donc gagner significativement et complètement, le plus vite possible.
A bien considérer, la prise de Paris en 1814 et Waterloo en 1815, sont les deux événements assurément décisifs, puisqu’ils conduisent aux deux abdications.
Le Blocus continental ne pouvait pas marcher (par Pierre Branda)
Le projet de Napoléon d’interdire le commerce de marchandises anglaises sur le continent était une réponse au blocus maritime imposé par l’Angleterre quelques mois auparavant. Il pénalise les négociants et l’industrie française qui rencontrent des difficultés d’approvisionnement de matières premières. Il est aussi un frein à l’approvisionnement de produits coloniaux. Avec la perte progressive des colonies, la canne à sucre se fait plus rare et donc plus chère. Napoléon fait planter des betteraves dans la plaine Saint-Denis. Par ailleurs, la contrebande est de plus en plus active au fil du renforcement du Blocus continental. Les marchandises anglaises circulent en fraude. L’État impérial connaît une perte de ses recettes fiscales. L’économie française souffre. L’autorisation d’un système de licences ou de permis décrétés par Napoléon montre la limite des entraves au commerce britannique.
La guerre napoléonienne préfigure la Première Guerre mondiale par sa brutalité (par Stéphane Béraud)
L’application de la notion de « guerre totale » aux guerres napoléoniennes par des historiens, comme Nicolas Cadet, semble excessif. Certains soutiennent la thèse de la « brutalisation », qui tend à développer une culture d’anéantissement de l’ennemi, constatée en Espagne avec les violences de masse sur les civils.
Cette « brutalisation » dépasse le simple cadre militaire pour envelopper aussi le domaine politique. Stéphane Béraud, ne perçoit pas une intensité plus élevée de la violence des combats et donc refuse cette thèse. Les guerres napoléoniennes ne marquent pas une rupture avec la période précédente. Les pertes de l’ensemble des forces en présence représentent entre 17 % (Austerlitz) et 30 % (Essling).
Comparativement, on estime à 23 % les pertes totales à Fontenoy (1745). Le déploiement accru de l’artillerie, les choix tactiques et les quelques améliorations techniques de l’armement ne suffisent pas à avancer l’idée d’une rupture et donc d’une « brutalisation ». Selon l’auteur, le périmètre du champ de bataille (20 à 30 km² environ) et la durée des combats (la journée) n’évoluent guère. Napoléon entend provoquer la dislocation plus que la destruction dans les rangs adverses, en démoralisant et désorganisant l’ennemi.
La recherche a montré que la mortalité (immédiate) au combat dans la Grande Armée est quatre fois moins élevée que les pertes sanglantes différées (à l’hôpital), autour de 16 %, entre 1803 et 1814.
Les écrits (mémoires, lettres) des combattants ne donnent pas dans des descriptions réalistes de la violence de la guerre, sans faire état de ses émotions. La fierté d’avoir participé à l’aventure impériale est récurrente. Avec une forme d’autocensure, le témoignage se limite à livrer quelques données sur les pertes numériques. L’épidémie de typhus durant la campagne de 1813 décime davantage les troupes que le champ de bataille.
La ligne anglaise était supérieure à la colonne française (par Stéphane Béraud)
On doit cette formule à l’historien britannique David Chandler à propos du combat de Maida en Calabre en 1806, et qui dès lors va entretenir cette « légende tactique » dans l’historiographie anglo-saxonne. Or l’historien Eric Dauriac a montré, par l’étude du IIIe corps commandé par Davout durant la bataille d’Auerstaedt, que l’armée française utilise davantage la ligne comme formation de combat plutôt que la colonne d’attaque. Des spécialistes de la tactique napoléonienne, Paddy Griffith et Brent Nosworthy écartent la thèse de la supériorité britannique seulement fondée sur la puissance de feu de la ligne. Rien n’est figée : les marches d’approche et les attaques quand l’adversaire paraît affaibli, peuvent se faire en colonne. Mais l’ordre peut être donné de passer à la formation en ligne à l’approche de l’ennemi.
Il faut aujourd’hui considérer que la détermination morale des soldats, dans le maintien de la cohésion et du sang-froid constitue un facteur important.
En Espagne, les défaillances opérationnelles et logistiques, la qualité moindre de l’encadrement et de l’entraînement des conscrits des corps français sont des éléments qui peuvent expliquer les succès de l’armée anglaise.
La guerre finance la guerre (par Pierre Branda)
La guerre a pesé lourdement sur la fiscalité de l’Empire. Après 1805, l’autofinancement des opérations extérieures devient un principe général. Des économies sont à réaliser dans les finances publiques une fois que les troupes sont équipées et habillées. Les armées doivent se suffire à elles-mêmes, notamment en les faisant stationner dans les pays envahis. Les bénéfices financiers conclus avec la signature des traités de paix représentent un autre moyen d’alléger le budget impérial. Les contingents militaires étrangers alliés sont à la charge des pays d’origine.
La guerre engendre un surcoût sur les finances publiques. L’équilibre budgétaire est rompu après la rupture de la paix d’Amiens. L’ensemble des dépenses militaires inscrites dans les budgets de l’État s’élève à 6,74 milliards de francs, de l’an XI (1803) à 1814. Le surcoût des guerres successives est estimé à 3,11 milliards de francs. Pierre Branda estime que la guerre a été payée par la guerre elle-même à hauteur de 41 % (contributions ordinaires et valeurs saisies en pays ennemi, recettes extérieures issues des traités, contingents alliés et troupes aux frais des pays frères).
Les budgets militaires de 1805 à 1812 ont augmenté de 75 %. Ce chiffre s’explique par la levée constante de troupes, par l’enchaînement des campagnes, et par le renouvellement permanent de matériels.
Les puissances vaincues (Espagne, Russie, Autriche, Prusse) ont des ressources financières limitées, et donc s’acquittent difficilement de leurs contributions.
Napoléon, le dévoreur de la jeunesse française (par François Houdecek)
2,4 millions d’hommes ont servi dans l’armée française entre 1792 et 1815. Le système de recrutement est établi par conscription depuis l’instauration de la loi Jourdan-Delbrel en septembre 1798. Les hommes de 20 à 25 ans doivent être recensés et inscrits sur des listes municipales. La désignation des partants se fait par tirage au sort. De 1800 à 1805, 18,3 % des conscrits recensés sont incorporés. Ce chiffre monte à 30 % de 1806 à 1810. Le recrutement s’accentue particulièrement en 1813 (890 000 hommes). Alors que la Première Guerre mondiale représente une ponction de 20 % sur la population française, les guerres napoléoniennes concernent 7 %.
Beaucoup d’hommes cherchent à échapper à la conscription. En dessous d’une taille d’1,624 mètre on est exempté. Pour limiter le nombre de cas, ce chiffre est abaissé à 1,517 mètre en 1813. Les simulateurs et les fraudeurs, en nombre, cherchent l’exemption. On feint la surdité, la myopie, l’incontinence, les douleurs articulaires ou musculaires. Certains achètent des potions pour faire apparaître des plaies. Les plus déterminés s’amputent l’index droit qui empêche de tirer.
Le mariage est un justificatif pour échapper au recrutement. Dans les familles les plus aisées, on se paie un remplaçant, une recrue de substitution. Le jour des opérations de conscription, un arrangement financier est toujours possible pour échanger un mauvais contre un bon numéro.
Les insoumis, les réfractaires et les déserteurs peuvent être nombreux. La désertion collective est plus fréquente et peut concerner un soldat qui accumule plusieurs années de service. Vivre dans la clandestinité suppose un soutien moral et matériel. Ceux qui travaillent dans des exploitations agricoles reculées, ou dans la petite domesticité et l’artisanat échappent plus facilement aux contrôles.
Les insoumis repris se retrouvent (après un décret de 1811) dans des régiments qui portent le nom des îles sur lesquelles ils stationnent : Belle-Ile, Ré, Lérins… La discipline et le taux de mortalité sont plus élevés qu’ailleurs.
De mai à août 1813, en Saxe, on relève selon les services du général Radet, 40 000 cas de désertions. 700 cas sont instruits par la justice prévôtale, compétente en la matière, parmi lesquels on note 320 condamnations.
La bataille se gagne à la baïonnette (François Houdecek)
Le combat au corps à corps, la charge héroïque et les actions d’éclat incarnent la bravoure. La première promotion de la Légion d’honneur récompense avant tout l’attaque à la baïonnette (58 %) ou au sabre (39 %). Pourtant le choc entre deux unités reste très exceptionnel. Il ne paraît pas pertinent de déterminer une hiérarchie entre le feu, le choc et la manœuvre. Les victoires à l’époque de la Révolution et de l’Empire sont davantage le résultat d’une combinaison de moyens et d’une adaptation permanente à la réalité de la bataille.
Le pilonnage des lignes adverses par l’artillerie aux premiers instants de la bataille est une épreuve très stressante qui dégarnit les rangs. Pris sous le feu roulant les hommes, moralement déstabilisés, tombent au hasard. Mais le soldat doit cependant conserver sa place, sans s’apitoyer sur ceux déjà abattus et sur le spectacle terrible des corps disloqués. Pour garder son efficacité, les canons tirent sur l’infanterie à moins 1 000 m de distance (600 m pour la cavalerie). Les boulets pèsent entre 2 et 6 kg. Sur des terrains assez durs, comme à Wagram, les projectiles ricochent, allongeant ainsi la portée de tir.
Le fusil modèle 1777 utilisé par l’infanterie a une portée optimale de 120 à 160 mètres. Il se charge en 12 temps et 18 mouvements (4 temps en combat). Il faut plusieurs semaines d’entraînement pour maîtriser les gestes réglementaires (charger, tirer). On n’apprend pas vraiment à viser. Ce n’est que sur le terrain que les officiers indiquent qu’il faut cibler les jambes en-dessous de 100 mètres de distance de l’adversaire. Au-delà, à plus de 160 mètres, on se concentre sur le buste. Les salves successives des différents rangs peuvent rapidement aboutir à une certaine confusion, entre les soldats qui rechargent et ceux qui tirent. Le nombre de coups tirés doit l’emporter sur la précision. Au mieux, le fantassin expérimenté tire trois à quatre fois par minute, mais dans le feu de l’action ce rythme se réduit à une à deux fois.
Les manœuvres et les conversions de ligne ou à colonne caractérisent surtout la tactique militaire napoléonienne. Au fil des campagnes, les pertes humaines, l’augmentation permanente des effectifs (mais trop rapidement formés), et l’érosion des compétences se font sentir.
Sans précision, les coups de fusil ne sont guère efficaces. Le déluge de projectiles épuise et dégrade les hommes physiquement et moralement. Le choc avec la charge à la baïonnette a pour but de donner le coup de grâce.
« En guerre comme en amour, pour conclure, mon cher, il faut se voir de près » confie Napoléon à Las Cases. La cavalerie est l’arme de choc qui peut stopper l’artillerie, écraser ou faire cesser le feu de l’infanterie, chasser les tirailleurs. Les dragons et lanciers (la cavalerie de ligne), les cuirassiers et les carabiniers (la cavalerie lourde) attaquent par vagues successives. Cependant la charge de cavalerie n’a pas la garantie du succès face à un carré d’infanterie. Napoléon sait mettre en œuvre, avec pragmatisme, la coopération interarmes qui combine le feu, le choc et la manœuvre. Le moral du soldat est un facteur déterminant pour mener à la victoire… sans compter la foi en son Empereur, dont ses plans portent la réussite et la gloire.
La Garde impériale, une troupe de choc (par Stéphane Calvet)
Forte de 40 000 hommes (en 1812) cette troupe d’élite entre dans la légende avec la « défaite glorieuse » de Waterloo, le fameux mot de Cambronne, et le sacrifice du dernier carré…
L’instrumentalisation politique de la bataille de Marengo (14 juin 1800) fait de la Garde consulaire un modèle de bravoure, de résistance et de courage. S’ensuivent des récompenses et des promotions pour fidéliser, et signifier la reconnaissance. Très tôt cette unité est privilégiée, mais parallèlement le recrutement se montre plus sélectif et exigeant. L’incorporé devra dépasser 1,80 mètre pour être grenadier à pied et faire preuve d’endurance physique. Beaucoup d’entre-eux ont l’expérience des guerres de la Révolution. Les effectifs augmentent rapidement : 2082 hommes au début du Consulat, 7776 à la veille de l’Empire.
La Garde est une troupe de choc, employée seulement comme une force de réserve ou de soutien (sauf la cavalerie et l’artillerie), caractérisée par une solide fraternité d’armes. Elle brille sur plusieurs champs de bataille de 1805 à 1812. Au fil des ans, on distingue une Jeune Garde et une Vieille Garde, la part des « Italiens » et des « Égyptiens » diminuant. La campagne de Russie porte un coup fatal à cette élite de l’élite. Les pertes sont énormes : 75 % de la Vieille Garde et 90 % de la Jeune Garde. « Ce n’est pas à Waterloo que la Garde est morte, mais bien en Russie ! ».
Le remplacement de ces troupes exceptionnelles va perdre inévitablement en qualité. A partir de la campagne de 1813, la Garde devient une troupe d’assaut. « Plus de la moitié des officiers de la Garde tués entre 1800 et 1814 le sont pendant la campagne de France ». L’engagement et la détermination au combat peuvent expliquer une telle perte. Rarissimes auparavant, des désertions commencent à s’accumuler. Les critères de recrutement sont revus à la baisse en 1815 : taille de 1,70 mètre, intégration de volontaires de 18 ans dans la Vieille Garde… Ceux d’Austerlitz, d’Eylau, de Friedland ou de Wagram ne sont plus que 15 % de l’effectif.
Avant la défaite de Waterloo, la Vieille Garde n’est déjà plus un redoutable outil de guerre. Il ne faut donc pas imputer la responsabilité de la défaite à la Garde, qui s’est glorieusement battue au regard du nombre de morts et de blessés.
De Marengo à Waterloo, 180 000 hommes sont passés par la Garde.
1812 préfigure 1941 (par Jean Lopez)
La comparaison de la campagne de 1812 avec l’opération Barbarossa de 1941 pose d’emblée des limites tant les objectifs sont différents. Napoléon ne cherche pas la guerre à tout prix mais plutôt l’alliance avec le tsar pour lui faire appliquer le Blocus continental. Avec cette « seconde campagne de Pologne », l’Empereur semble en quête d’un nouveau Friedland et d’un second traité de Tilsit. Il ne s’agit pas de détrôner le tsar.
Les objectifs d’Hitler, eux, sont idéologiques. Il s’agit d’une guerre d’anéantissement visant à détruire l’Union soviétique et le bolchévisme. Il n’est donc pas ouvert à la négociation. C’est tout ou rien !
Le point commun des deux conquérants se situe sur le plan géopolitique. Ils rêvent d’étendre leur domination à l’espace continental européen.
La Grande Armée (600 000 hommes) et la Wehrmacht (3,9 millions avec ses alliés) jouissent d’une réputation d’invincibilité. L’armée impériale n’est plus celle d’Austerlitz. Elle souffre de désertions, alors que l’armée allemande bénéficie d’une meilleure expérience et d’une certaine motivation pour se lancer dans l’aventure russe.
Contrairement à Hitler, Napoléon ne cherche pas à rester en Russie coûte que coûte.
La maîtrise de l’espace et l’hiver ont eu raison de la logistique défaillante napoléonienne. Avec la politique russe de la terre brûlée, il n’a pas été possible de vivre sur le pays. Le problème d’approvisionnement en fourrage a mis à mal les 100 000 cavaliers, empêchant notamment les actions de reconnaissance ou de poursuite. Avant même de combattre, la faim, le froid et la maladie avaient tué en masse dans les armées de l’Empereur.
L’espace russe et les infrastructures ont évolué entre 1812 et 1941. Les troupes d’Oudinot effectuent 210 km en dix-sept jours (12 km/jour) sans combattre, alors que les divisions de Manstein réalisent cette distance en cinq jours (42 km/jour) en combattant.
Le désastre militaire est plus important pour Napoléon, qui perd sa cavalerie et ses vétérans. Hitler conserve les deux tiers de son armée. Un tournant dans le conflit mondial est amorcé.
« L’envie irrésistible de lancer une nouvelle fois les dés de la guerre » rapproche les deux conquérants, pour les conduire vers leur chute respective que nous connaissons.
En Russie, Napoléon a été vaincu par le « général Hiver » (par Antoine Reverchon)
Les arguments fréquemment mis en avant par les historiens pour justifier l’échec de la campagne de Russie sont la faiblesse des ressources du pays, les longues distances à parcourir, et bien évidemment le climat particulièrement rude. Le 29e bulletin de la Grande Armée, daté du 12 décembre 1812, conforte cette dernière thèse, en incriminant le froid glacial russe.
Pourtant, avant même que les températures soient durablement négatives, la Grande Armée a déjà perdu un quart de son effectif initial. Mais un autre facteur essentiel est à prendre en compte. L’armée russe a coupé les lignes de ravitaillement, ce qui provoque la faim. De la défaite on bascule à la déroute.
La campagne de 1812 n’est pas improvisée, en témoigne les moyens logistiques à mobiliser. Napoléon est donc bien conscient de l’importance du transport et du ravitaillement pour cette aventure russe.
L’insuccès des manœuvres et le manque de ressources font dire à Antoine Reverchon que Napoléon a déjà perdu la campagne de Russie le 18 août 1812 à la bataille de Smolensk, autrement dit trois mois avant le début de l’hiver. Plus que la rudesse du climat, les opérations militaires russes précipitent la débâcle de la Grande Armée.
La campagne de 1814, un chef-d’œuvre ? (par Frédéric Bey)
Comment considérer la campagne de France comme brillante, alors qu’elle conduit à la première abdication de Napoléon ?
L’armée française est en nette infériorité numérique dès janvier 1814. Elle dispose de 70 000 combattants, alors que la Sixième Coalition rassemble 500 000 hommes (l’armée du Nord de Bernadotte : 170 000 hommes, l’armée de Silésie de Blücher : 130 000 hommes, l’armée de Bohême de Schwarzenberg : 200 000 hommes). Face à cette difficulté, Napoléon peut toutefois compter sur la divergence de vues des membres de la coalition.
Comme souvent avec Napoléon, il faut aller vite. « La stratégie est la science de l’emploi du temps et de l’espace. Je suis, pour mon compte, moins avare de l’espace que du temps. Pour l’espace, nous pouvons toujours le regagner. Le temps perdu, jamais ! » (propos tenus en 1814). Les maréchaux et la population sont lassés de la décennie de campagnes militaires et des guerres. L’Empereur paraît donc bien seul.
Comme déjà dit, Napoléon recherche l’effet de surprise, par la rapidité de mouvements. Ainsi, les victoires s’enchaînent en février 1814, sans être décisives. Mais elles ont permis de souder les Alliés. Au regard de l’effectif total disponible, les pertes dans le camp français sont lourdes, tandis que l’ennemi dispose encore d’importantes réserves dans leurs bases arrières. La perspective d’une victoire française s’éloigne inexorablement, au fur et à mesure que s’amenuisent les ressources humaines après chaque bataille.
L’entêtement de Napoléon, son refus de compromis et de négociation, produisent une impasse diplomatique au Congrès de Châtillon (du 5 février au 19 mars 1814) avec les autres puissances belligérantes.
Marmont et Mortier négocient une reddition le 31 mars. Les partisans de l’Empereur dénoncent la trahison des maréchaux et des élites politiques. Ils préfèrent insister sur les manœuvres audacieuses, les victoires héroïques de la campagne de France, la résistance à l’envahisseur… la défaite dans l’honneur.
Le 2 avril, le Sénat dépose Napoléon.
Le bilan est désastreux : la France est ramenée à ses frontières de 1792 par le traité de Paris signé le 30 mai 1814.
Napoléon pouvait gagner la bataille de Waterloo (par Thierry Lentz)
Napoléon réussit à recréer une armée de 210 000 hommes, issus de la garde nationale pour les trois quarts, mais mal formés et mal équipés. Les coalisés (Blücher et Wellington) ont retenu les leçons de la campagne de 1814. Ils conviennent de ne pas diviser leurs forces.
Le dimanche de Waterloo (18 juin 1815) engage 70 000 soldats dans chaque camp. Thierry Lentz décrit avec précision et clarté les temps forts de la bataille.
On dénombre 10 800 morts (dont 6 800 Français) et 35 000 blessés (deux tiers sont français).
Alors que Napoléon a écrit sa version « officielle » de la bataille, l’historien présente plusieurs questions (accusations de Napoléon) qui alimentent encore aujourd’hui les débats :
– La responsabilité du maréchal Ney, qui avait pourtant réussi à empêcher la jonction de l’armée anglo-néerlandaise de Wellington avec celle de l’armée prussienne de Blücher. On lui reproche le sacrifice de la cavalerie. Dans ses dictées à Sainte-Hélène, Napoléon rejette la faute sur le « brave des braves ». Il en vient à regretter de l’avoir employé, alors même qu’il n’a pas envoyé l’infanterie de réserve en appui à ce moment là.
– Le comportement de Grouchy, arrivé trop tard sur le champ de bataille, est dénoncé par Napoléon. Peut-être les instructions n’ont-elles pas été assez claires ?
– Enfin, les compétences du maréchal Soult comme chef d’état-major sont remises en cause.
N’ayant plus les moyens militaires de ses ambitions politiques, Napoléon ne pouvait pas gagner.
L’ouvrage ne propose pas de conclusion. En revanche quelques références bibliographiques sont indiquées à la fin de chaque contribution.
Ainsi s’achève l’épopée militaire impériale, comme elle avait commencé, par une défaite. Trafalgar la maritime et Waterloo la terrestre, sorte d’alpha et d’oméga de l’aventure guerrière napoléonienne, incarnent l’ambition contrariée de l’Empereur.
Cependant, on pourra admettre qu’il a réussi à construire la postérité héroïque de sa Grande Armée. Par la volonté du chef, la célébration a été immédiate. La fameuse proclamation de Napoléon après Austerlitz, le 12 frimaire an XIV (3 décembre 1805) en constitue une éloquente illustration : « vous avez décoré vos aigles d’une immortelle gloire… Il vous suffira de dire « J’étais à la bataille d’Austerlitz », pour que l’on réponde, « Voilà un brave ». »
Jamais ennuyeux et très accessible, cet ouvrage permet d’en apprendre beaucoup sur le fonctionnement militaire, la stratégie et la tactique, les enjeux politiques et diplomatiques, la propagande, le poids de la conscription dans la société. De manière plus générale, l’occasion est donnée de se replonger dans cette période historique qui fascine encore tant de personnes, et dont la Grande Armée en est une des mythiques composantes.
Ce recueil de contributions offre bon nombre de réponses et d’arguments aux questionnements qui pourraient surgir dans les classes.