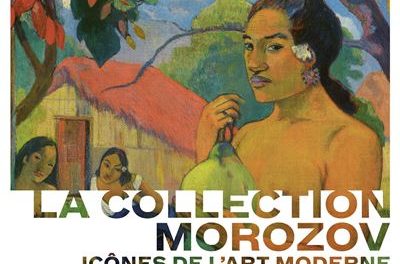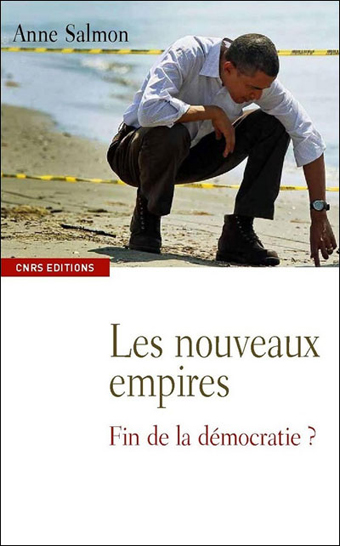
Les états se sont vus contestés à partir des années 70 par la montée en puissance des sociétés transnationales qui se sont développées sur fond de dérégulation, une dérégulation suscitée par les états eux-mêmes. Cette dérégulation, loin de favoriser la concurrence a surtout favorisé la concentration. Dans le domaine maritime par exemple, un des secteurs qui joue un rôle déterminant dans le processus de mondialisation, les 15 premières firmes concentrent à elles seules plus de 75 % de l’activité. Cette montée en puissance des firmes transnationales se traduit également par une augmentation des activités de lobbying et des activités d’influence.
L’auteur s’interroge à propos des réflexions sur la fin de l’histoire telles qu’elles ont pu être développées par Francis Fukuyama. C’est sans doute cela qui a pu sanctionner l’évolution en cours. « Le système capitaliste son expansion sont inéluctables et sans alternatives ».
Les firmes multinationales ont un impact considérable sur les politiques publiques. Certaines sociétés transnationales en actionnant des leviers économiques sont capables en effet d’infléchir les politiques des États. Tant que les États ne s’opposent pas à cette influence et réussissent à convaincre les citoyens de son bien-fondé, celle-ci peut apparaître comme légitime aux yeux du corps social. L’auteur se demande si, dès lors que les divergences apparaîtraient, la contrainte exercée par les firmes ne deviendrait pas plus visible. Anne Salmon fait d’ailleurs référence aux analyses d’Ernest Mandel, l’économiste de la quatrième internationale, qui évoquait déjà entre 1974 et 1978, les premières tendances aux délocalisations qui ont explosé dans les années 90. À cette époque, cela concernait les activités polluantes qui étaient alors externalisées. Le changement par rapport à cette période réside dans le nouveau pouvoir des consommateurs et des investisseurs. Les grands acteurs capitalistes élaborent désormais des stratégies inédites par leur ampleur qui les conduisent à des jeux d’influence qui impliquent directement les représentants politiques. L’intensification des activités de lobbying se traduit par une intervention directe dans la vie politique qui pèse sur la démocratie. Les consommateurs, en quête de bonnes affaires, phénomène favorisé par la diffusion sur Internet des sites comparateurs de prix, participent d’ailleurs de ce mouvement. Toutefois, les mouvements de consommateurs ne font pas forcément le poids en termes d’influence. Ce sont les firmes qui sont davantage en mesure de les influencer, voire de les amener à faire pression directement sur les pouvoirs publics pour favoriser leurs entreprises.
Un mouvement qui tire ses racines dans les années 70
La thèse de l’auteur va très au-delà de ce simple constat : dès lors que les états nationaux ont vu naître de puissants concurrents, les sociétés multinationales, c’est un nouveau modèle de société qui est en train d’émerger. La valorisation des rapports contractuels, les logiques de concurrence de compétition, combiné avec l’éclatement des grandes bureaucraties intégratrices hiérarchisées, est venu rivaliser avec le modèle de régulation sociale stabilisée dans le cadre du compromis fordiste adossé aux États-providence.
Pour l’auteur, l’hypothèse réside dans une articulation entre la concentration économique des firmes et l’essor d’un nouveau modèle de société se retrouve dans les changements structurels, organisationnels et idéologiques qui ont été introduits par les grandes entreprises à la fin des années 70. On retrouve d’ailleurs plus loin les conséquences de cette atomisation organisée sous couvert de réorganisation et de gain de productivité dans les relations de travail au sein de l’entreprise.
Ce qui aujourd’hui se met en place depuis la fin de XXe siècle est un marché transpolitique incontrôlable par aucun pouvoir politique.
C’est cette logique sur laquelle s’appuient les firmes transnationales. Leurs seules exigences en matière d’organisation politique se résument très simplement par le respect d’une sphère privée qui leur permettre de mettre en œuvre leur logique de développement et de conquête de nouveaux marchés. Paradoxalement, la multiplication de nouvelles entités territoriales, favorisée par l’implosion de l’Union soviétique, a pu permettre à des logiques de firmes transnationales de s’imposer. Au-delà des territoires nationaux se sont des réseaux d’échanges supranationaux entre les instances économiques dominantes qui se sont imposées.
La vague de dénationalisation qui a été impulsée par le fonds monétaire international dans les pays du Sud s’est accompagnée d’une cette dissociation des puissances économiques à l’égard du pouvoir politique ancré sur les territoires. Mais dans une certaine mesure ce sont les acteurs politiques locaux qui ont été rendus bénéficiaires de ces évolutions. Le cas de la Tunisie a pu montrer comment un État autoritaire, dominé par un clan familial, pouvait parfaitement s’accommoder de logiques d’investissement favorisés par des politiques de dérégulation.
Toutefois, ces acteurs économiques au sein des espaces transnationaux souffrent d’un déficit de légitimité. Cela les amène à favoriser un mouvement de déstabilisation des contre-pouvoirs, issu du monde du travail, au sein même des organisations capitalistes.
La déstabilisation des collectifs de travail, que l’auteur présente dans le chapitre quatre mérite très largement d’être étudiée non seulement dans le secteur des entreprises privées mais également dans les services publics. L’exemple qui a d’ailleurs été pris par la sociologue et celui de l’évolution de l’entreprise EDF, qui a été profondément réorganisée selon les nouvelles formes de management qui se sont imposées à partir des années 80.
Les institutions internationales notamment l’organisation internationale du travail ont commencé à dresser le bilan des différentes crises financières depuis 2007. Du point de vue de la montée du chômage, comme des salaires réels, la situation est de moins en moins favorables au monde du travail. Un chiffre d’ailleurs amène à réfléchir à propos de la vulnérabilité. 1 000 000 000 1/2 de personnes, la moitié de la main-d’œuvre mondiale, se trouvant situation de vulnérabilité. Cette situation est très largement favorable aux organisations capitalistes qui disposent d’une armée industrielle de réserve forcément soumise.
Une analyse qui concerne aussi le secteur non-marchand
Certains auteurs comme Richard Sennet évoquent depuis quelques années un « nouveau capitalisme ». Les mutations structurelles de ce nouveau capitalisme conduisent au démantèlement des organisations bureaucratiques de la période de fordiste qui étaient fortement intégratrices. La fragmentation des grandes institutions à des conséquences en termes de fragmentation de la vie sociale. De ce fait, cela favorise l’éclatement de la vie familiale désormais soumise aux exigences du travail, la mobilité, mais également le repli sur un cocon bien fragile que l’on essaie tant bien que mal de préserver. Le déracinement généralisé dans le travail provoque un effritement des relations sociales tissées dans la durée et ne favorise évidemment pas l’action collective. Cette logique qui a été développée dans les grandes entreprises se retrouve également dans des services publics où l’on développe à l’envi le recours à des personnels à statut précaire, introduisant une situation de concurrence et donc de tension entre salariés.
De ce fait, ce phénomène participe d’une sorte de mouvement de déqualification. L’encadrement a tendance à s’éloigner de plus en plus des personnels d’exécution, dès lors qu’il est soumis à des contraintes d’objectifs. Pour le personnel d’exécution, qui ne peut espérer qu’une reconnaissance immédiate de ses efforts, mais en aucun cas une pérennisation de sa situation, cela participe au final d’un détachement à propos du métier, voire même de réactions de rejets violents.
Cette violence peut apparaître comme multiforme, s’exercer contre l’usager que l’on perçoit de plus en plus comme un adversaire, contre le cadre intermédiaire vu comme un ennemi, voire contre soi-même comme en témoignent certains suicides dans de grandes entreprises comme France Telecom.
Cette déstabilisation des conséquences sur la vitalité des contre-pouvoirs, le syndicalisme a été forcément victimes de ces évolutions. Dès lors que le collectif de travail se voit déstabilisé, le collectif de lutte s’en trouve fragilisé, comme l’explique Anne Salmon, dans le chapitre cinq. Les mutations de l’entreprise, même si elles sont précédées et à d’éventuelles concertations, sont en réalité imposée. La multiplication des réformes successives empêche une réflexion collective de se mettre en place, que l’on retrouve d’ailleurs dans le système éducatif français, dirigé par un cadre supérieur issu de ce monde de l’entreprise, le même type de ressort de gestion des ressources humaines.
C’est sans doute ce qui est peut-être le plus surprenant dans l’analyse d’Anne Salmon. Les mutations du secteur de l’entreprise et leurs répercussions sur les salariés du privé, se retrouvent quasiment à l’identique dans les réformes en cours du système éducatif français. À croire que l’auteur de l’ouvrage et le ministre de l’éducation nationale ont puisé aux mêmes sources, leur argumentaire. Si on notera toutefois que pour l’auteur de cet ouvrage, il s’agit sans aucun doute de fournir à ceux qui subissent et essaient de combattre ces évolutions des instruments d’analyse, plutôt que de les mettre en œuvre.
Il est clair que pour Anne Salmon, les questions qui sont posées par ce nouveau capitalisme sont au cœur du processus démocratique. Comment développer des sociétés civiles, dès lors que leur atomisation apparaît comme inéluctable. C’est en ce sens qu’elle souligne le danger pour la démocratie. Dès lors que les états se voient dépossédés de leur rôle d’intégration sociale, il ne leur reste plus que les fonctions coercitives. Les États-nations deviennent strictement des états gendarmes, dès lors que l’État-providence se voit remis en cause.
Derrière cette analyse d’un auteur rencontré lors du dernier salon du livre de sciences humaines, on retrouve quelques-unes des intuitions fulgurantes de Jack London dans « le talon de fer ».
Le constat est bien pessimiste, mais il semble bien pourtant que quelque part au sud de la Méditerranée, il peut y avoir des raisons d’espérer, tant il est vrai que les aspirations des hommes à la liberté finissent toujours par secouer les chaînes qui leur ont été forgées.