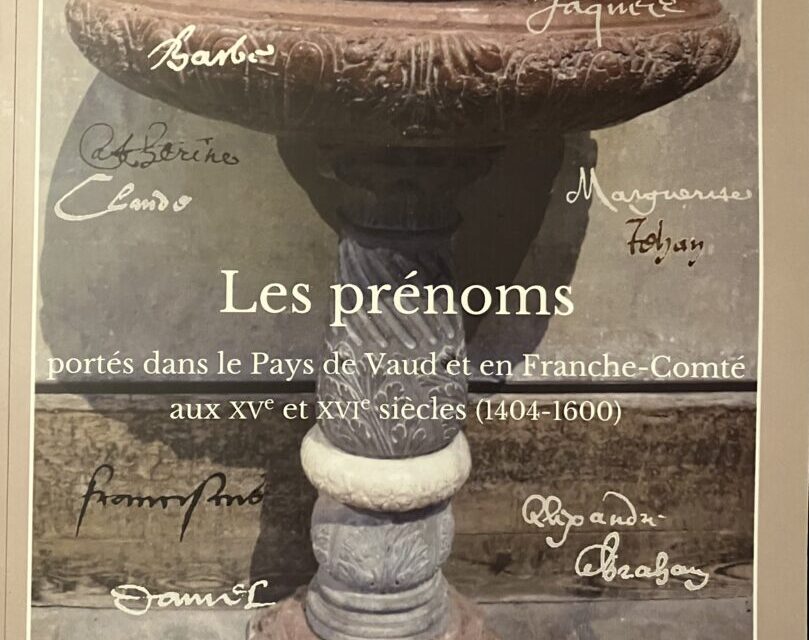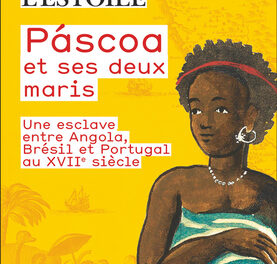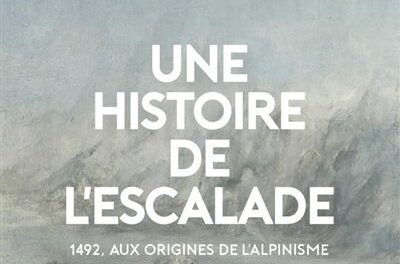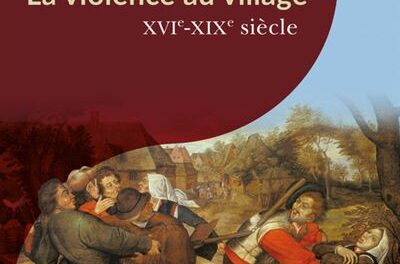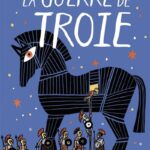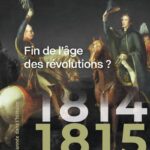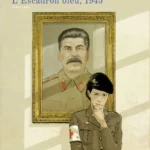Dans son introduction, Sylvie Poidras-Bohard explique le choix d’un sujet qui peut étonner. Elle le situe dans le questionnement anthroponymique des années 1970-1980, une approche de l’histoire sociale. Elle en fixe les bornes Chronologiques et spatiales.
Les sources et la méthodologie
Cette première partie, incontournable dans un travail de thèse montre à la fois la variété, les richesses et les limites des sources utilisées. Les sources judiciaires vaudoises et administratives, notamment les procès en sorcellerie, sont précieuses. Elles sont présentées en détail, pour chaque siècle, comme il se doit pour une thèse.
Dans cette zone frontalière, les sources du Pays de Vaud ou de Franche-Comté ont leurs particularités. Dans l’ensemble, elles permettent une approche de la société tant urbaine que rurale.
L’autrice dresse un portrait précis de sa zone d’étude. En ce qui concerne les données sociales, elle remarque une dégradation, au cours du temps, du statut des femmes : fille de, épouse ou veuve de… que l’on soit en terre catholique ou protestante. Un travail pointu sur les registres de baptême informe sur ces réalités sociales, y compris les métiers, voir les migrations (Nyon, 1592, « Pierre Sylvestre, réfugié » – p.76). La reconstitution des familles est parfois difficile, c’est l’une des limites des sources étudiées.
Un ensemble de reproductions aborde la question de la lisibilité des sources, en latin ou en français.
Les prénoms du Pays de Vaud et de la Franche-Comté avant la Réforme, au XVe siècle
Après un rappel historique du système anthroponymique, l’étude montre que les prénoms, féminins comme masculins, étudiés sur une population totale de 2 718 individus en Pays de Vaud, sont très majoritairement issus du Nouveau Testament : Pierre et ses dérivés (Perrin, Pétrus, Perrot…), Jean (Johannes..), Jacques, André, Baptiste, Bartholomé, Thomas et Philippe. Les femmes portent des prénoms issus de la féminisation des prénoms masculins, Jacquette, Perronette.
En Franche-Comté, la situation est assez semblable, même si des diminutifs sont associés à prénoms testamentaires, par exemple Grosjehan, ou l’apparition de Mathieu ou Gaspard. Pour les femmes, Anne et Marie dominent.
Les prénoms inspirés des saint.es et martyr.es dans le Pays de Vaud et en Franche-Comté forment un groupe distinct, avec au Pays de Vaud : Nicolas et ses dérivés, Antoine et François. Claude a un statut privilégié car très ancré dans ce territoire. Pour les femmes, on trouve Marguerite, Nicolette, Claudia et quelques autres.
En Franche-Comté, ces prénoms sont plus souvent en deuxième prénom. Assez variés, les plus fréquemment choisis sont : Stéphane, Simon, Estienne, Nicolas, Claude. Pour les femmes, on retrouve Marguerite, Catherine, Biétrix, Cécile, Ysabelle.
Des prénoms d’origine germanique, sont présents au Pays de Vaud Guillaume, Henri, Girard, Aymon et renvoi à la littérature chevaleresque. Pour les femmes, Guillemette et Mermette dominent. Pour la Franche-Comté, on retrouve Guillaume, Henri, on trouve aussi Hugues pour les prénoms masculins. Pour les femmes, Les dérivés de Guillaume dominent : Guillerme, Guyotte…
Les prénoms dits théophores et symboliques renvoient à des personnages importants, parfois canonisés comme Dominique ou Benoît. Ils sont possiblement rattachés à un lieu sacré comme Jourdain, Jordana en référence au fleuve Jourdain ou à un temps religieux comme Baptiste pour l’entrée dans la vie spirituelle par le baptême. Quant à Amédée, il signifie qui aime Dieu.
Enfin quelques prénoms insolites sont évoqués.
Les prénoms du Pays de Vaud et de la Franche-Comté à partir de la Réforme
Avec l’influence calviniste puis la contre-réforme, des évolutions apparaissent. Les prénoms issus des saint.es et martyr.es passent au premier plan. Simon, Simone renvoient à saint Simon de Crépy, le fondateur de Mouthe. Claude prend la première place au Pays de Vaud, aux côtés de Jean et Pierre, prénoms du Nouveau Testament. Pour les femmes Clauda et Francesca dominent
À noter la situation particulière, et donc intéressante, du village d’Orbe à la fois catholique et protestant du fait de son appartenance aux bailliages communs à Fribourg et Berne. Le prénom Claude est moins attribué, malgré des résistances, quand le village est soumis aux lois de Calvin qui interdit les prénoms de saints.
La résistance des prénoms de saint.es et marty.res s’expliquent par la volonté de placer le nouveau-né sous la protection d’un saint.
Quelques graphiques mettent bien en évidence les évolutions entre le XV et le XVIe siècle.
La même étude est conduite pour la Franche-Comté. Elle montre que les prénoms les plus utilisés sont Jehan (18,4%), Claude (16%), Pierre (14,2%), Jaques (5,3%), Anthoine (4%) puis Nicolas (3,6%). Claude et François sont en tête des prénoms issus de saints. Pour les femmes, outre l’apparition de Simone (3,5%), Claudia est bien placée derrière Jehannette.
Les prénoms du Nouveau Testament dans le Pays de Vaud et en Franche-Comté au XVIe siècle, majoritaires au siècle précédent, ne représentent plus que 38 % des prénoms au XVIe siècle, en Franche-Comté comme en Pays de Vaud. Les prénoms d’origine germanique voient leur place se réduire.
Les prénoms issus de l’Ancien Testament sont en nette progression, à mettre en parallèle avec l’influence grandissante des idées protestantes : Abraham, David et Daniel pour les hommes, Esther Sara ou Judith pour les femmes. Ces prénoms, plus présents pour les baptisés que pour leurs parents attestent de cette progression au Pays de Vaud.
Les prénoms théophores et symboliques deviennent anecdotiques même si de nouveaux prénoms apparaissent comme Noël, Dimanche, Bénédit ou Christine.
Conclusion générale
Dans cette région frontalière, l’étude a montré l’impact de la vie quotidienne sociale et religieuse sur le choix des prénoms aux XVe et XVIe siècles et un comportement commun dans les deux zones.
« les prénoms sont sensibles au contexte environnant et reflètent les mentalités, les inquiétudes, les changements majeurs politiques et religieux. »(p. 531)
L’autrice ouvre la réflexion sur une évolution probable dans le contexte, au siècle suivant, de la guerre de Trente ans.
Une étude qui permet de montrer que l’exploitation des sources judiciaires et administratives n’est pas achevée et qu’elles peuvent répondre à bien des questions pour approcher, au plus près, les choix des hommes et les femmes des XVe et XVIe siècles.