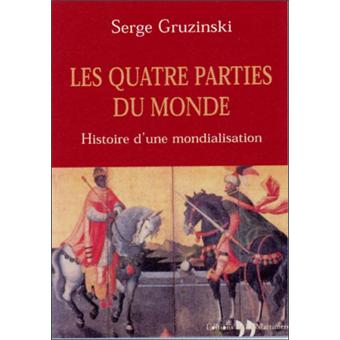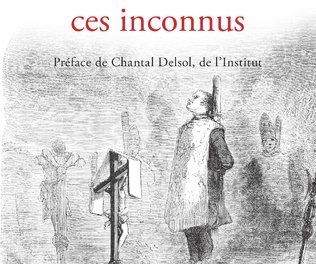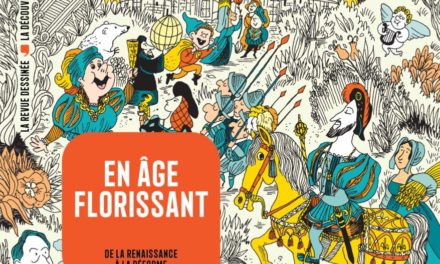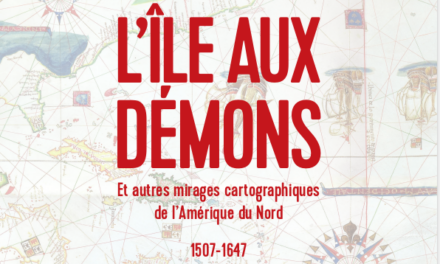Par sa célèbre remarque, « Notre monde vient d’en trouver un autre », Montaigne exprime la conscience nouvelle, dans l’Europe au XVIe s., de l’existence d’un autre espace totalement étranger à sa civilisation. L’expression « les quatre parties du monde », formulée par Heinrich Martin (†1632), imprimeur, cosmographe et éditeur hambourgeois installé à Mexico, confirme cette relativité européenne, réduite à un quart du globe. La biographie même de Martin illustre l’ouverture de nouveaux canaux de circulation à l’échelle mondiale. C’est dire l’importance de l’entreprise européenne qui veut embrasser les nouveaux mondes à partir du XVIe et la révolution qu’elle représente. Pour suivre les traces de la « mondialisation ibérique », Serge Gruzinski se propose d’en retracer l’histoire entre les années 1580 et 1640 qui correspondent, d’une part, à la génération qui succède aux Conquistadores et prolonge leur action et, d’autre part, à l’apogée de l’empire ibérique. L’auteur se propose de suivre les recommandations de Fernand Braudel sur l’étude des « recouvrements de civilisations » et de Pierre Chaunu sur l’analyse des « désenclavements planétaires ». Son objectif est donc fort ambitieux : faire l’histoire du désenclavement européen à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle et, en même temps, désenclaver l’histoire européenne. Pour réaliser ce dessein, l’auteur mobilise tout au long de l’ouvrage de nombreuses notions américaines, nées de la remise en cause de l’européocentrisme (entre autres, les connected stories : les histoires connectées ; cf. S. Gruzinski, « Les mondes mêlés de la Monarchie catholique et autres “connected histories” », Annales, HSS, Janv-février 2001). Aussi, les esprits chagrins pourront-ils s’irriter de ces renvois très fréquents à des formules anglo-saxonnes, pas toujours utiles à la compréhension de cette étude, et qui traduisent en fait une américanisation de la pensée européenne (territorial fallacy, middle-grounds, political correctness p.114, p.230, p.322, 323, p.333 p.381, jusqu’à l’anglicisme “globalisation”). Toutefois, dans sa rédaction, Serge Gruzinski s’amuse de cette “globalisation” américaine, puisqu’elle agit de la même manière que la “globalisation” ibérique planétaire qu’il étudie ! Il y a donc un double rôle à ce livre : analyse historique par un historien reconnu de l’Amérique latine (La Pensée métisse, 1999 eut un écho important) et « boîte à outils pour comprendre ce qui se joue depuis plusieurs siècles entre occidentalisation, métissages et mondialisation » (p.10) dans le contexte de la mondialisation actuelle.
Cette dualité est perceptible à la lecture de l’ouvrage. Les deux premières parties ouvrent la voie à une réécriture nuancée de la mondialisation ibérique, sans remettre en cause les acquis des études sur les dominations espagnole et portugaise. Dans ce but, Serge Gruzinski se fonde sur un corpus de textes parfaitement maîtrisé, qu’il distille peu à peu afin de développer ses thèses.
La première partie s’ouvre par un appel au nécessaire décentrement de l’histoire européenne. Pour cela, sont réunis des témoignages d’auteurs indiens, métis et non ibériques, le plus souvent vivant à Mexico. Ils offrent aux lecteurs le décalage nécessaire à une démonstration nuancée des processus de mondialisation qui n’oublie pas les chocs en retour des découvertes. L’accueil dans la péninsule Ibérique d’intellectuels américains ou asiatiques, à l’image de l’Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), les relations de la Nouvelle-Espagne avec le Japon et la découverte de la circulation éolienne pour relier l’Asie par la voie Pacifique, entraînent d’évidentes extensions de cette mondialisation ibérique. Parmi les éléments de transferts, celui de la « chasse au trésor » est le plus manifeste et, de Goa à Lisbonne, de Potosi à Séville, les navires ibériques se chargent de cargaisons de grande valeur. Cependant, le pillage des richesses indigènes n’est certainement pas le point essentiel de la globalisation. En effet, dès que celle-ci pénètre les sociétés autochtones, elle les transforme radicalement, que ce soit par la volonté de christianisation, par l’intérêt qu’elle leur porte, ou par l’imposition de cadres mentaux. Ainsi, la transcription phonétique des langues indigènes (nahuatl, quechua, tupi…), qui jusqu’alors ne s’écrivaient pas, bouleverse les sociétés locales au moment même où les langues ibériques, elles, se mondialisent. Pour leur part, les Européens intègrent de nouveaux savoirs, comme l’illustre « la somme sur la botanique indienne » du Portugais Garcia da Orta, intitulé Coloquios dos simples (Goa, 1563) ou la Géographie et description universelle des Indes (1574) de López de Velasco. Le cas de l’évolution de la ville de Mexico est remarquable (ch.4) et Serge Gruzinski lui avait déjà consacré une étude en 1996, mais il présente ici les éléments propres aux métamorphoses urbaines nées de la domination espagnole avec la marginalisation de la population indienne par la relativisation de la République des Indiens, que les maîtres espagnols avaient conservée, et avec l’apparition de nouveaux marginaux dans la ville : noirs, mulâtres, métis, pauvres picaros, chinos venus des Philippines, voire de Chine. Ces mutations expliquent les tensions urbaines qui surgissent ; les révoltes de 1569, de 1611 et de 1624 pour la première fois marquent une distanciation des élites créoles vis-à-vis du pouvoir métropolitain. Ces confrontations constituent seulement une des facettes de la mondialisation ibérique puisque l’affrontement entre opprimés et oppresseurs est lui-même producteur d’échanges, de mobilité et de valeur. Si les Indiens se voient imposer une vision du monde, des coordonnées géographiques venues d’Europe et l’alphabet latin, par ailleurs les élites indigènes participent aussi aux rêves ibériques à cause de l’évangélisation missionnaire et des formations qu’elles reçoivent dans les collèges. Selon l’auteur, la « mondialisation ibérique n’est parfois qu’un collage d’imaginaires » (p.121). Cette globalisation est soutenue par le quadrillage de l’espace colonial issu de l’implantation d’institutions métropolitaines : de l’Inquisition aux chancelleries, des vice-royautés aux universités, en passant par les ordres religieux.
Si la confrontation n’est pas le mode quotidien de la gestion des relations entre dominants et dominés, c’est en grande partie à cause de l’existence d’un monde intermédiaire qui est mobile et sillonne l’espace ibérique. La deuxième partie du livre s’attache à montrer ce monde, souvent nomade, qui n’est plus totalement espagnol mais pas encore latino-américain, où l’individu possède deux patries ; celle de ses aïeux et celle d’adoption, celle de son souverain (et la métaphore solaire a favorisé l’adhésion indienne au souverain Habsbourg) et celle où il s’installe. Par le biais d’une succession ordonnée de biographies thématiques, Serge Gruzinski formule sa conception de la mondialisation ibérique. Le parcours tumultueux de Pedro Sarmiento de Gamboa montre la perméabilité des réseaux de correspondances et des connexions tandis que, avec la vie de Maria Barbosa, mulâtresse née à Evora, et celle de Diego Chino, métis d’un Espagnol et d’une femme de Malacca, on trouve l’illustration de la mise au point planétaire de la stratégie inquisitoriale (p.141) : l’opprimé participe à la définition de son oppression.
A l’image de ce monde, la Monarchie catholique de Philippe II, qui réunit les couronnes espagnoles et portugaise à partir de 1580, nécessite des agents aptes à gérer l’empire et à transmettre les connaissances adéquates. Pour cela, elle recourt à des médiateurs, à des passeurs, qui réalisent cette jonction entre le monde ibérique et le monde indigène (pour les désigner, Serge Gruzinski a choisi de traduire prácticos par experts). On pourrait penser que l’auteur développe dès lors la notion de métissage qui, ainsi qu’il l’indique, est à la mode depuis plusieurs années. Bien au contraire, ses deux dernières parties sont beaucoup plus tranchées que les précédentes : le Nouveau Monde reste pour lui celui des dominants, à peine modifié par l’apport des dominés. La place faite à la négociation, à l’acculturation et au métissage dans le processus de mondialisation est réduite. Ce constat pessimiste s’applique à ceux que l’auteur qualifie d’experts de l’Eglise et de la Couronne (ch.7 : Gaspar da Cruz et Bernardino de Sahagún pour l’Espagne, Diogo do Couto et André Alvares de Almada pour le Portugal) car ceux-ci jouent un rôle actif dans l’élargissement du monde – et donc dans « la colonisation de l’imaginaire » (p.164) -, puisqu’ils sont toujours au service de la Foi et de la lutte contre l’Idolâtrie même si leur objectif ne vise pas l’oppression des indigènes. Le domaine scientifique confirme cette carence des passeurs à intégrer et à transmettre les savoirs indigènes, surtout si ces derniers peuvent remettre en cause les savoirs européens. Ainsi, Francisco Hernandez, (1517-1584), « premier médecin de toutes les Indes » de Philippe II avait rédigé un monument où il décrivait plus de trois mille plantes américaines, mais son travail fut réduit à un seul volume ! Au-delà de ces passeurs, à un niveau de responsabilité supérieure, de nouvelles élites apparaissent pour la gestion des empires ibériques. Nommés dans des postes en Europe aussi bien que dans les territoires de l’Empire, les vice-rois, présidents de chancellerie, inquisiteurs et capitaines généraux sont les premiers responsables de la mondialisation de l’empire des Habsbourg. Là aussi, l’exposé de plusieurs biographies (Martin Ignacio de Loyola, Rodrigo de Vivero ou Salvador Correia de Sá) permet de mesurer la diversité des origines, des méthodes et des aspirations de ces « élites mondialisées ».
La « piste des objets » (ch.12) est un des passages les plus convaincants sur l’échec du métissage culturel et sur son rejet en tant qu’élément d’exotisme au sein d’une culture marginalisée par les élites urbaines et par les institutions. L’art métis produit pourtant des illustrations qui accompagnent nombre de codex (dont le Codex de Florence), mais celles-ci ne servent qu’à valoriser le propos retranscrit. Du XVIe au XVIIIe siècles, la peinture officielle de Nouvelle Espagne suit le courant maniériste européen et l’auteur constate « l’invisibilité obstinée du “local” sur quantité de toiles » (p.311). La métaphore des « parois de verre » (ch.14) s’applique à l’impossibilité culturelle de l’occident d’appréhender la pensée indigène. Le regard porté sur le monde extérieur reste imperméable aux influences et aux métissages. La philosophie occidentale et les pratiques linguistiques s’imposent et se reproduisent en-dehors de la Péninsule, à l’image des œuvres d’Antonio Rubio, de l’Académie antarctique de Lima, et de la réforme orthographique proposée par Mateo Aleman, en même temps qu’elles perpétuent les valeurs, les principes et les schèmes de pensée européens, et cela en suivant les voies institutionnelles classiques. Les apports indigènes sont rejetés, à moins qu’ils ne renforcent la légitimité de la globalisation ibérique.
Cette histoire de la « première mondialisation » donne donc lieu a un livre passionnant, agréablement illustré (signalons la remarquable qualité éditoriale de l’ouvrage) et écrit avec vivacité. S’il est parfois déroutant, et quelquefois agaçant, c’est à cause des redondances auxquelles l’auteur recourt pour renforcer l’impression de circularité des influences planétaires (entre « connexions », « maillons », « ponts », et « circulation », le lecteur non “branché” peut se perdre), à cause aussi de son refus d’utiliser les notions européennes de prépondérance et d’hégémonie, et surtout du fait de l’actualité de la globalisation .
Ce texte qui, par ailleurs, multiplie les réflexions originales et les pistes pionnières – sur le plagiat, sur la conception de la modernité, sur les notions de fortune et de consommation qu’offre l’ouverture du Nouveau Monde – constitue donc une somme remarquable sur les phénomènes liés à la mondialisation.