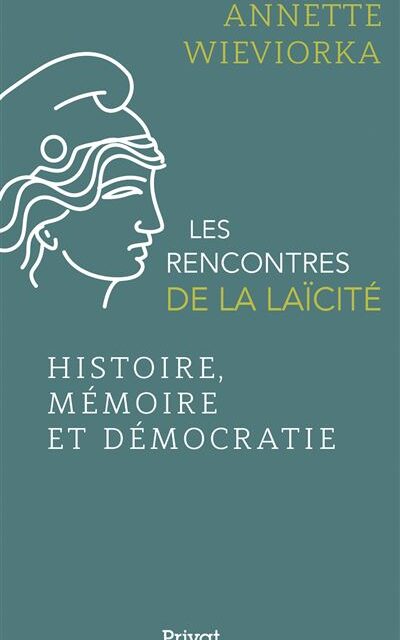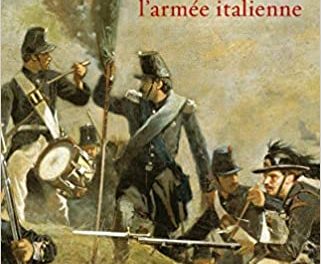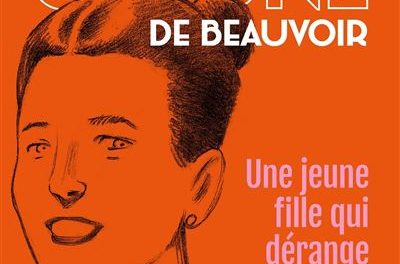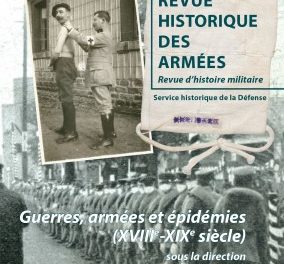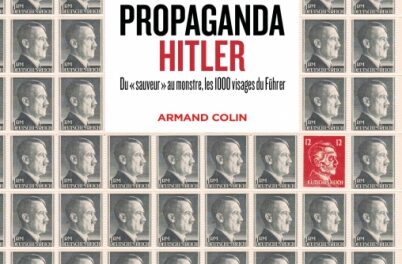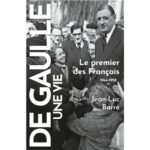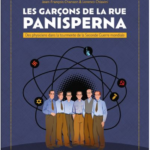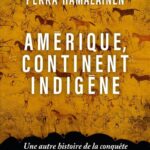Issu d’une conférence tenue à la librairie Ombres blanches à Toulouse en 2022, ce texte d’Annette Wieviorka évoque l’histoire et la mémoire comme des outils pour penser la démocratie.
L’historienne revient sur son parcours et son histoire familiale. Elle raconte son malaise à son retour de Chine, après deux ans d’enseignement entre 1974 et 1976, c’est-à-dire dans les dernières années de la Révolution culturelle. Elle s’interroge sur la manière dont elle a pu succomber à cette « tentation totalitaire ». C’est un déclencheur pour apprendre le yiddish, s’interroger sur son histoire familiale en croisant témoignages et archives. Elle s’intéresse notamment à l’histoire de Wolf Wieviorka, son grand-père paternel, écrivain tué à Auschwitz.
Autre déclencheur, la mort de sa tante Berthe en 2012, la pousse à se lancer dans l’écriture de Tombeaux. L’histoire familiale est aussi celle des grands mouvements migratoires depuis la Pologne. Les motivations sont avant tout économiques, même si l’antisémitisme et les pogroms ont joué un rôle. Côté paternel, le départ pour Paris de Wolf Wieviorka est motivé par la recherche d’une carrière littéraire.
Annette Wieviorka, ses frères et sœur, grandissent dans une famille pauvre où la place de l’éducation est centrale. Elle estime qu’ils sont un fruit de l’école républicaine et ont le point commun d’être tous devenus fonctionnaires.
A leur arrivée en France, les prénoms des deux branches de la famille sont francisés. Mais son père et son oncle nés en France portent des prénoms juifs et vont étudier dans une école juive du consistoire. La famille oscille entre un désir d’intégration et celui de préserver la culture yiddish. Ces écoles du Consistoire sont destinées aux immigrés pauvres où ils apprennent en premier lieu à être français. L’enseignement y est entièrement en français, à l’exception de celui de la religion. Wolf Wieviorka est passé par Berlin, située à l’époque de la République de Weimar, car il y était facile d’y obtenir des papiers en mentionnant des villes qui avaient été bombardées. Il est alors, comme beaucoup de juifs, considéré comme réfugié russe et disposait de vrais papiers établis avec de fausses informations. L’historienne donne plusieurs exemples de « bricolages » de papiers d’identité dans sa famille.
Dans sa famille maternelle, la rupture avec la religion est totale alors que dans sa famille paternelle, l’idée que les Juifs forment une nation domine. Dans cette optique, il faut développer une identité yiddish sur place (doyrkeit en yiddish). Elle souligne le rôle central de l’école pour les 2e et 3e génération et se demande si l’école joue encore ce rôle. Dans les échanges avec la salle, elle souligne les difficultés croissantes de l’école et la nécessité de revaloriser les enseignants.
Cette courte conférence, qui reprend des idées développées dans certains de ses livres, notamment Tombeaux et Mes années chinoises, est une bonne entrée en matière pour découvrir Annette Wieviorka.