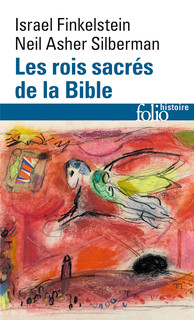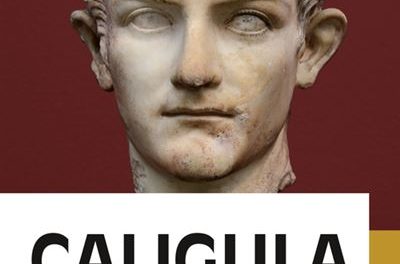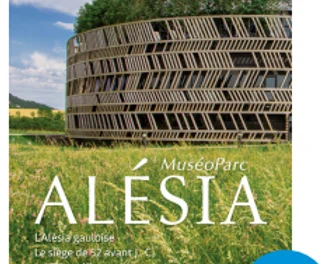Un second ouvrage des auteurs de la Bible dévoilée
Cet ouvrage est consacré à David et Salomon considérés par trois traditions culturelles comme des modèles de souverains (Daoud et Sliman pour les musulmans) comme en témoignent les nombreux arbres de Jessé établissant la légitimité de souverains chrétiens.
L’ouvrage est le produit d’une nouvelle et fructueuse collaboration entre Israël Finkelstein, archéologue à l’université de Tel-Aviv et Neil Asher Silberman, directeur historique du centre archéologique belge ENAME. On doit déjà à ces deux auteurs La Bible dévoilée (Bayard, 2002, Gallimard, 2006 – The Bible unearthed, The Free Press, 2001), ouvrage passionnant dont a été tiré le documentaire du même nom diffusé sur Arte avant d’être édité en DVD.
Dans ce premier ouvrage, les auteurs posaient, la question de l’historicité des événements politiques et des personnages mentionnés dans la Bible. Ils se fondaient sur une confrontation systématique du texte biblique à l’archéologie et aux autres sources laissées par les différentes civilisations du Proche-Orient, notamment égyptiennes et assyriennes.
L’historicité des patriarches hébreux n’y résistait pas. Idem de l’Exode puis de la conquête de Canaan par Josué, successeur de Moïse. Comment, en effet, croire en l’historicité d’une migration qui ne laisse aucune trace dans le désert du Sinaï ? Comment imaginer, qu’au lieu de passer par le Sinaï, un groupe ou un peuple en fuite ait pu, longer la côte jusqu’à l’actuelle bande de Gaza sans être repéré par les postes de garde égyptiens, ceux là même qui signalèrent les Peuples de la mer sous Ramsès III ? Comment soutenir l’idée d’une conquête fulgurante par les Hébreux d’un espace cananéen qui, au bronze récent, était justement sous contrôle égyptien ?
David : du souverain d’un royaume mythique au chef de bande apirou
Le nouvel ouvrage complète le précédent même s’il ne rend pas sa lecture nécessaire. L’un des éléments structurants de l’argumentation est dans la critique sévère mais méthodique, nuancée et fort convaincante de la chronologie habituellement retenue par une historiographie trop peu critique vis-à-vis du récit biblique : David, vainqueur du Philistin Goliath, aurait régné, après Saül, sur un royaume indépendant dont Jérusalem aurait été la splendide capitale. Son fils Salomon, bâtisseur du temple, aurait régné sur un vaste territoire, lequel aurait été par la suite divisé en deux entités. Au Nord, le royaume d’Israël, détruit par les Assyriens au VIIIe siècle avant notre-ère, devient la province de Samarie. Au Sud, le royaume de Juda est dirigé par la dynastie davidique, jusqu’à la prise de sa capitale Jérusalem au VIIe siècle avant notre ère.
Cette théorie se heurte pourtant à de nombreuses incohérences révélées par la confrontation des sources laissées par les peuples riverains et celles qui ont été exhumées par la recherche archéologique. Plutôt que des nomades ayant conquis Canaan, les Hébreux seraient plutôt des descendants des Apirous, terme sociologique sans connotation ethnique désignant des bandits semi-nomades, pasteurs ou paysans ruinés peuplant les hautes-terres situées à l’Est de la plaine littorale contrôlée par les Egyptiens. L’émergence, au Fer I, d’Israël, puis de Juda serait donc liée aux bouleversements que connaît la plaine littorale au Bronze récent avec, entre autres, l’arrivée des Peuples de la mer, parmi lesquels les PhilistinsLa Bible dévoilée indique que le récit de l’Exode serait lié à la reprise à leur compte par les peuples cananéens, du souvenir de l’expulsion des Hyksos par les Egyptiens. Dans le même ordre d’idée, le lecteur ne peut que se souvenir de la parenté liant le récit du Déluge à l’Epopée de Gilgamesh elle même inspirée par le récit sumérien du Poème du supersage. De même, sait -on que le récit de la naissance de Moïse est inspiré de la légende du roi Sargon d’Akkad et de Sumer, abandonné dans un panier et sauvé des eaux par la déesse Ishtar.. Le David historique aurait donc fort probablement été un chef apirou, à une époque où Jérusalem n’était qu’un gros village. Saül n’aurait pas été son prédécesseur à Jérusalem mais le souverain d’Israël, royaume nordiste en plein essor, ayant alors peu en commun avec les collines désertiques de la chefferie de Juda. La dimension de gros village de la Jérusalem du début du Fer (ici le Xe siècle), laisse peu de place à la théorie du grand royaume unifié de David et Salomon. Elle exclut également qu’on ait pu construire à cette époque le temple décrit dans le texte biblique.
Juda recueille la mémoire d’Israël et invente un passé commun aux deux royaumes
Le royaume de Juda semble avoir largement profité des malheurs d’Israël avant d’en recueillir la mémoire. Ainsi, derrière les Philistins de la Bible, vainqueurs de Saül, c’est l’action des Egyptiens (Shéshonq 1er) qui se profile. La Bible décrit d’ailleurs un raid pharaonique visant Jérusalem. Si les inscriptions de Karnak ne mentionnent pas Jérusalem et David parmi les vaincus du pharaon, c’est sans doute la marque d’une allégeance de Juda à l’Egypte ou d’une indifférence des Egyptiens vis à vis d’un espace alors relativement désert. Juda a en fait pu profiter de l’affaiblissement du royaume du Nord, celui de Saül, seul véritable objectif de l’expédition égyptienne. Goliath, dont la description biblique ne renvoie en rien aux Philistins de la fresque de Ramsès IIICelle qui décrit la victoire contre les Peuples de la mer, a pu dans ce contexte être l’un de ces mercenaires grecs au service de l’Egypte. Tout dans son équipement rappelle les hoplites du VIIe-Ve siècle. Le royaume de Juda a également pu tirer profit de l’ascension des rois araméens de Damas puis d’une allégeance à l’Assyrie pour se protéger des convoitises nordistes que son développement suscitait. Avec la prise de Samarie et la destruction du royaume d’Israël par les Assyriens (720), Juda est confronté à l’arrivée massive de réfugiés nordistes, porteurs de la mémoire israélite : malheurs du roi Saül, fastes de la cour, etc. Mêlée à une tradition judéenne exaltatant le lignage davidique, la mémoire israélite se transforme. Saül devient prédécesseur de David à la tête d’un royaume unitaire qui n’a jamais existé. A la fin du VIIe, sous Josias, le royaume de Juda se sent appelé à un grand destin. On unifie une mémoire nationale qui explique la légitimité davidique par l’impiété de l’ancienne dynastie nordiste. On centralise le culte pour mieux étendre le contrôle territorial, ce qui débouche à terme sur le monothéisme.
Un héritage universel
Finkelstein et Silberman avaient déjà montré dans leur premier ouvrage à quel point la géographie de certains des livres bibliques (notamment l’Exode ou le Livre des Rois), ce qu’on désigne comme le texte deutéronomique, apparaissait contemporaine du règne de Josias. De ce roi prometteur de la fin du VIIe siècle, un passage biblique nous apprend très laconiquement qu’il est mis à mort à Megiddo par le pharaon Neko II Appelé aussi Néchao ou Nécos dans d’autres ouvrages lors d’un ultime sursaut de l’Egypte de la Basse-époque. Catastrophique au vu de l’espoir suscité, la mort de Josias à Megiddo est à l’origine de l’expression «Armageddon» (Har Megiddo). Avec la période postexilique, qui suit l’annexion de Juda par Babylone et la déportation des élites judéennes sur les bords du Tigre, commence le temps de Yehoud, province babylonienne puis perse, hellénistique et enfin romaine. La prédominance de la dynastie davidique y survit, non comme programme politique mais comme élément purement religieux. En témoigne entre autre l’importance pour les Evangélistes du rattachement de Jésus à David via Joseph et la naissance à BethléemJ’indique à mes secondes que cette naissance est d’autant plus suspecte qu’elle a pour fonction de rendre Jésus plus acceptable en Judée en le rendant moins nazaréen et, surtout, en le rattachant à David. Le Jésus historique ne saurait être accepté sans la dimension davidique. D’autres sauveurs de l’époque sont tous présentés comme liés à David. C’est le cas d’Athrongaeus, qui émerge à la faveur des troubles qui suivent la mort d’Hérode vers 4 avant notre ère, de Theudas (vers 40), qui prétend séparer les eaux du Jourdain, ou de « L’Egyptien » qui prétend un peu plus tard ébranler les murs de Jérusalem.
Ecriture polémique ou actualisation historique ?
La partie consacrée à l’héritage davidique n’est sans doute pas la plus captivante. Les auteurs sont archéologues et c’est bien dans ce domaine qu’ils excellent, faisant renouer le lecteur avec l’ambiance d’autres recherches sur l’origine des Etrusques, des Peuples de la mer ou des Sumériens. C’est davantage avec l’esprit de l’enquête historique, au sens où l’entendait Hérodote, qu’il faut aborder ces lectures sur la haute Antiquité en se gardant de toute approche polémique. On a volontiers accusé Finkelstein d’être mu par la volonté secrète de saper les fondements de la nation israélienne contemporaine. Son discours relève pourtant bien une approche scientifique très distanciée. De surcroît, on en oublie qu’il voit dans les Hébreux des autochtones cananéens et non des immigrants mésopotamiens. Des arguments plus scientifiques sont également employés contre lui mais sans grande efficacité. Il s’agit à chaque fois d’expliquer qu’il a mal compris tel ou tel détail du contenu de l’analyse d’un autre chercheur. Au vrai, il semble bien qu’il faille jeter au rancard un grand nombre de nos frises de 6e et des données parfois rappelées avant le cours de seconde sur l’émergence du christianisme. Ce qui m’a le plus dérangé dans cet ouvrage, comme dans le précédent, n’est pas dans son discours mais dans la façon il a pu être desservi par la traduction françaiseLe fait de pratiquer quotidiennement la langue anglaise amène à remarquer un certain nombre d’erreurs dans les traductions françaises. Les collègues enseignant en section européenne ou internationale savent combien la pratique de l’anglais historique permet, mieux que le recours au collègue linguiste (qui n’est pas forcément historien), d’éviter les erreurs de compréhension ou de traduction. On utilise ainsi en anglais le verbe « to capture » pour évoquer la prise d’une ville. Or, à plusieurs reprises (au moins deux) la traduction évoque une « capture de Jérusalem » (p.25) au lieu d’une prise. Les paysans sont « harassé » plutôt qu’harcelés par les représentants de l’autorité (p. 59) ou les Araméens (p. 142). Dans la cartographie, « Sea of Galilea » est systématiquement traduit « Mer de Galilée » (p. 90 ; 104) plutôt que « lac de Tibériade » (même si Tibériade et Galilée sont de toute façon des termes anachroniques). On traduit également « industry » par « l’industrie » de Juda (p. 232), conférant à ce terme le sens d’activité économique qui peut être le sien en anglais (et en français du Québec ou du XVIIIe). Quoiqu’utilisé par les professionnels du tourisme, ce sens, n’appartient pas au vocabulaire des historiens (et géographes) français. Salomon a la réputation d’être « grand amoureux » (p. 277) plutôt qu’amant réputé. Menahem, chef rebelle, se fait tuer à Massada par les membres d’un « gang » (p. 288) plutôt que par ceux d’une bande rivale. Enfin, plutôt que « la royauté de droit divin », on évoque « les droits divins des rois », choix là encore très discutable pour traduire l’expression anglaise « Divine rights of kings ». Bien que le traducteur n’en soit pas à sa première traduction historique, il procède à des choix discutables quand il ne s’agit pas d’erreurs étonnantes.. Il est clair que sa lecture, et celle du précédent doivent impérativement être digérés par nos manuels et nos cours afin de servir une histoire dépassionnée mais sans frilosité vis-à-vis des croyances.