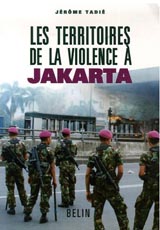
Par Marie-Christine Doceul
C’est dans l’excellente collection Mappemonde que Jérôme Tadié, jeune géographe responsable du programme de recherches « Territoires urbains et violence dans les grandes métropoles d’Asie du Sud-Est » à l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), a l’opportunité de publier sa thèse soutenue en 2002 sous le même titre.
Le travail est clairement un travail de géographie sociale et culturelle et non de sociologie à la différence de celui de Loïc Wacquant sur la violence de l’hyperghetto américain. En effet, la recherche porte sur la ville comme espace de violence. En cela, elle rejoint les travaux qu’a pu faire Bernard Callas sur Kampala par exemple.
De quelles violences s’agit-il ? Jérôme Tadié distingue les violences politiques des violences ordinaires en ville (délinquance, batailles de rues) qu’il choisit d’étudier plus à fond.
Quelles relations avec l’espace de la ville ? l’auteur veut mettre en évidence la façon dont les territoires de la métropole indonésienne sont gouvernés à la fois de façon officielle et informelle et le rôle de certains types de violence dans ce contrôle du territoire.
Pourquoi Jakarta ? la capitale indonésienne qui compte 8.3 millions d’habitants (la région urbaine atteint près de 20 millions) est connue pour la dangerosité de certains de ses kampung, quartiers populaires denses présents dans toute la ville. Il est dommage que J. Tadié n’ait pas jugé bon de mieux expliquer les spécificités de Jakarta par rapport à Manille ou à Singapour pour prendre les métropoles les plus proches qu’il se contente de citer.
Se lancer dans cette géographie de l’informel contraint le chercheur à aller au-delà des données officielles et à glaner ses informations sur le terrain même en recourant à une méthode ethnographique d’immersion dans le milieu urbain, dans les lieux de mauvaise réputation de TanahTinggi et de Senen en particulier.
Dans la première partie, l’auteur dresse une géographie du danger à Jakarta. Il commence par les lieux symboliques du danger, ceux des émeutes depuis 1965, pour insister ensuite sur les lieux de la violence quotidienne. C’est la partie la plus intéressante car il passe en revue les lieux de la délinquance et de la criminalité (transports, marchés, quartiers de prostitution) puis les batailles de quartier, véritables petites guerres urbaines, et enfin les batailles de lycéens. La vingtaine de pages consacrées à ce sujet ne manquera pas d’intéresser le professeur de lycée français : on y apprend leur nombre (presque 200 par an), leur calendrier dans l’année (en août et mars-avril) et dans la semaine (le samedi), leur bilan de 26 morts en 2000, leurs armes (« de l’âge des pierres à l’âge du fer ») ainsi que les champs de bataille : les autobus et les espaces publics. La violence urbaine répond à trois types de logiques territoriales : économique pour la délinquance et certaines batailles de quartiers, communautaire pour les batailles de quartiers et de lycéens, ou symbolique pour les espaces publics de la petite criminalité et des émeutes.
De ce constat de la violence, Jérôme Tadié passe à l’analyse de l’insécurité et de ses traductions spatiales. Alors que la violence est concentrée dans certains quartiers, l’insécurité, sentiment propagé par deux moyens, les journaux et la rumeur, s’étend à l’ensemble de la métropole de Djakarta. La peur porte sur les groupes sociaux suivants considérés comme dangereux et donc stigmatisés : les vendeurs de rue, les mendiants et les enfants de rue, ainsi que la jeunesse lycéenne, du moins celle qui fréquente les établissements techniques et professionnels ainsi que les lycées généraux de quartiers défavorisés. La violence laisse des traces visibles dans la ville : des ruines consécutives aux émeutes, des protections des bâtiments par des filets anti-jets de pierre, et surtout l’enfermement de certains quartiers : les lotissements aérés réduisent leurs accès à un ou deux, et comme dans bien d’autres métropoles du monde, les nouveaux quartiers de classes moyennes ou aisées sont d’emblée clos et sécurisés.
Le deuxième volet concerne les territoires de la répression. Le contrôle et la surveillance de la ville obéissent à des nécessités de développement économique ainsi qu’à des logiques politiques. Les forces de contrôle sont au nombre de trois, très imbriquées entre elles : les forces municipales, la police et aussi l’armée. En effet, depuis 1958, l’armée indonésienne a une double fonction de défense extérieure et de contrôle du territoire et de la société. La police n’est plus depuis 1999 sous la dépendance de l’armée, ce qui ne l’empêche pas de rester impopulaire en raison de sa violence et de sa corruption. La police urbaine est aussi chargée de lutter contre les désordres urbains en particulier contre l’habitat illégal et le commerce de rue. Bien plus, le maintien de l’ordre et la surveillance passent par la participation de la population aux patrouilles de gardes civils qui effectuent par exemple la ronde de nuit. Enfin depuis 1995, le gouvernement cherche à modeler les codes de conduite de la société à l’instar du Japon et de Singapour.
Au-delà de toutes ces formes de contrôle, la population intervient spontanément pour rétablir l’ordre par des lynchages collectifs aux dépens de l’individu pris sur le fait ou simplement soupçonné de cambriolage, de vol ou d’agression. « Le voleur agit, la foule s’agite » affirme un dicton de Jakarta. La justice spontanée peut aussi s’exercer contre des véhicules : bus à la conduite dangereuse par ex, voire même contre des postes de police. Comment expliquer l’augmentation de la violence de ces lynchages qui se traduisent par plus de 100 morts par an ? l’auteur montre que les lyncheurs se trouvent dans toutes les couches de la société, que la cause du lynchage doit en être cherchée du côté de la défiance populaire envers la justice et la police, elle-même inspirée du mépris des élites envers le droit et que le lynchage exprime une forme d’appropriation communautaire du territoire par la population qui y réside en réaction à l’insécurité.
La troisième partie, la plus novatrice, est consacrée à la recherche des mécanismes informels de contrôle du territoire par les caïds ou preman. Le preman.se définit par son pouvoir en marge de la ville officielle. Le terme même ne date dans son sens actuel péjoratif que de dix ans. L’étude délaisse le preman en col blanc au profit du caïd des quartiers populaires : caïd de marché ou de carrefour, recouvreur de dettes ou tueur à gages. L’histoire des relations entre le monde souterrain des caïds et le pouvoir officiel est complexe, entre utilisation et répression dont l’épisode fameux en 1983-84 dit de Petrus où le pouvoir de Suharto élimina les caïds avec leurs propres méthodes d’assassinat. Qu’en est-il aujourd’hui ? l’ambivalence continue : les caïds sont utilisés pour contrôler les territoires, briser les grèves, résoudre les conflits au sein du quartier. Dans un passage lumineux (pp.196-197), J. Tadié explique le caïd comme « un personnage de la frontière urbaine » entre les deux mondes des dirigeants et du peuple qui ne se rencontrent guère, agissant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre.
Les preman se répartissent dans la ville selon une complexe et fine mosaïque ethnique. Par ex, les Padang, spécialisés dans le vol à la tire, sont présents dans certains secteurs des marchés et dans les bus. Il se dégage 5 territoires principaux contrôlés par un caïd (« toute forêt a son tigre ») : le quartier portuaire de Tanjung Priok, le quartier chinois de divertissement de Kota, les deux plus anciens marchés de la ville : Tanah Abang et Senen et un grand centre commercial doté comme les deux marchés d’une gare routière, Blok M. Le caïd commande les lieutenants chargés de l’exploitation prédatrice du territoire : rackets des vendeurs, rangement des parkings, batailles de quartiers, et recrute des hommes selon un réseau à base ethnique. Le partage du territoire avec les forces de l’ordre est possible grâce à la corruption de celles-ci.
La conclusion souligne la signification de la violence comme lutte pour l’exploitation des richesses au niveau de l’Etat comme à celui du quartier ou du carrefour. La gestion urbaine actuelle de Jakarta est telle qu’elle ne permet pas la distinction nette entre contrôle formel et informel des territoires.
Roger Brunet disait : « L’antimonde peut-être étudié avec des méthodes scientifiques ». Jérôme Tadié le prouve avec ce travail enrichi d’un corpus de 23 cartes et 21 photos utilement légendées, mais hélas toutes en noir et blanc.













