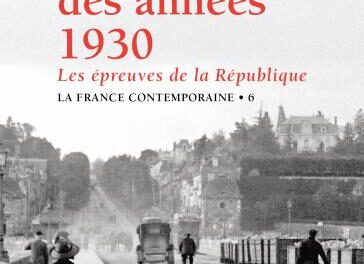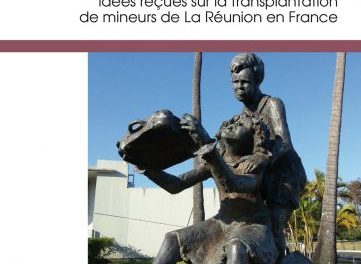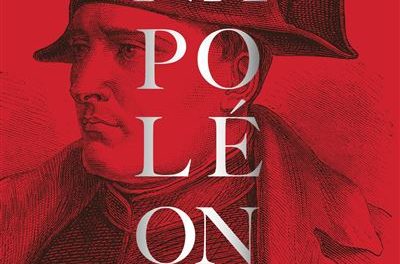Il fallait réunir les compétences de deux spécialistes d’histoire politique et sociale (Danielle Tartakowsky) et d’histoire économique (Michel Margairaz) pour réussir le tour de force de résumer l’histoire de l’État en France depuis la Libération en moins de 200 pages, dans un texte dense où les citations et les exemples détaillés se font rares, mais pour lequel on regrettera l’absence de chronologie et d’index. Le travail collaboratif de ces deux auteurs a déjà produit deux ouvrages de référence : une Histoire du front populaire en 2006 et un ouvrage sur 1968 sous-titré La grande bifurcation publié en 2010. Le titre de ce nouvel opus, L’État détricoté, filant la métaphore textile, pourrait s’avérer trompeur, tant les auteurs montrent que si par certains aspects la place de l’État se réduit de manière croissante depuis plus de trois décennies, par d’autres il connaît une consolidation, pour ne pas dire un durcissement de ses prérogatives.
Mais reprenons le fil chronologique de ce récit des institutions, des acteurs et des pratiques de l’État en France à travers deux périodes, constituant les deux grandes parties du livre : « l’État social et sa crise, 1945-1992 » (p. 7-94), puis « Libéralisation, mondialisation, nouvelle économie, 1993-2017 » (p. 95-188). À partir de 1944, avec la création du programme du Conseil National de la Résistance (chapitre 1), sont mise en place plusieurs mesures majeures, la planification, les nationalisations, la Sécurité sociale, le statut de la fonction publique et bien d’autres : ainsi, l’État devient l’acteur central du développement économique et social, dans une continuité avec la politique du Front populaire. En synchronie avec une dynamique occidentale visible dans des États libéraux comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France adopte donc le Welfare state, que les auteurs préfèrent traduire par l’expression d’ « État du mieux-être ». La réussite et la longévité de ce programme du CNR tient à sa triple légitimité transpartisane (des gaullistes au Parti communiste, les deux forces politiques dominantes des années 50 et 60), transnationale (puisqu’il se retrouve alors dans de nombreux pays d’Europe de l’ouest) et démocratique (par opposition aux années noires de la Seconde guerre mondiale).
Dans la France gaulliste, après la signature du traité de Rome en 1957, les dynamiques internationales commencent à peser plus fortement, comme le rapporte le IIIe Plan de modernisation (1958-1961) : « notre pays ne peut choisir une politique de protectionnisme et de repliement sans risquer du même coup de se retrouver appauvri, isolé et comme rejeté de l’histoire ». Au point que certains experts commencent à doute de l’utilité de poursuivre sur la voie de la planification dans le cadre d’une concurrence internationale croissante. Il faudra pourtant attendre la fin des années 70 pour voir le Plan perdre de sa substance, avant de tomber en désuétude dans les années 80.
Le moment 1968 est présentée comme le point de départ de la « grande bifurcation » qui intervient au milieu des années 80 : une bifurcation entre une culture de régulation par l’État et une culture de mobilisation dans la société (chapitre 2). Si la culture de la régulation connaît des épisodes de consolidation, comme entre 1969 et 1972, puis au tout début du premier mandat de François Mitterrand avec une politique keynésienne de relance économique, les tendances à la libéralisation se font jour de plus en plus clairement, d’abord dans les domaine politique, social et culturelle (par vagues discontinues, en 1968-72, puis 1974-75), puis bientôt dans les sphères économique et financière. Elles sont favorisées par une remise en cause des politiques keynésiennes, suite à la crise économique de 1974 et aux critiques virulentes des maux du système soviétique dans les années 1970, qui atteint par ricochet le Parti Communiste, dont la culture politique connaît une remise en cause, au même titre que le gaullisme historique malmené par le mouvement de mai 68. Ainsi, des années 60 au milieu des années 80, « la libéralisation économique et financière se fait à petits pas et est octroyée d’en haut, à la différence des libertés politiques et sociales, conquises à travers des épisodes de mobilisation collective » (p. 40).
Cette libéralisation économique se fait donc « à bas bruit » entre 1960 et 1992 (chapitre 3). Elle « émane pour l’essentiel du milieu restreint des hauts fonctionnaires financiers ou économiques, avec l’appui de quelques hommes politiques, sans nécessairement engendrer un débat public, et demeurent l’objet de réflexions confidentielles » (p. 64). Il en va ainsi du Plan, remis en cause par l’intégration au Marché commun, mais aussi par la présence nouvelle du patronat dans ses instances, tandis que la CGT et la CFDT affirment leur hostilité aux orientations du nouveau plan lancé en 1970. Si les nationalisations sont relancées avec l’arrivée de Mitterrand au pouvoir en 1981, les auteurs désignent de « grand revirement intellectuelle et symbolique » les évolutions initiées en 1982, que l’on a résumé par le mot de « rigueur ». Celles-ci se concrétisent par un blocage des prix et pour la première fois des salaires, qui va s’avérer durable, tandis que F. Mitterrand fait la même année l’apologie des profits et des entreprises ; bientôt c’est la dépense publique elle-même qui est remise en cause et les « prélèvements obligatoires » présentés comme une charge et non plus comme nécessaire à la redistribution des richesses, une valeur que la gauche gouvernementale en vient à délaisser. Cette dérive néolibérale se confirme sous le gouvernement Fabius par des mesures de libéralisation bancaire, boursière et financière… qui n’empêchent pas la droite de gagner les élections de 1986 et de poursuivre la dynamique de libéralisation, avec les privatisations d’entreprises menées sous l’égide d’Édouard Balladur. Pour le début des années 1990, les auteurs font le constat d’un déphasage entre la libéralisation économique et la dérégulation financière d’une part, et l’attachement idéologique d’une grande partie des Français pour la régulation d’une économie mixte, fondée sur des services publics puissants. Ce fut sans doute la force de F. Mitterrand d’avoir réussi à maintenir un équilibre entre les deux dynamiques, non sans menacer l’identité politique de la gauche à plus long terme.
La seconde partie s’attelle à montrer les dynamiques de l’État depuis un quart de siècle, en commençant par rappeler le contexte du début des années 1990, selon un jeu d’échelle, allant de la mondialisation croissante, notamment financière, à l’approfondissement de l’Union européenne avec le traité de Maastricht, tandis qu’en France est poursuivie la politique de privatisation, par la droite comme par la gauche, en même temps que s’accentue le déclin industriel et technologique par manque d’investissement dans les équipements et les secteurs de l’innovation.
Le chapitre 4, concernant les années 1993-2007, s’intitule « Libéralisation ou « réforme de l’État » ? ». C’est à Michel Rocard que l’on doit le changement de paradigme en matière d’organisation administrative, dénommée « nouvelle gestion publique » et expérimentée d’abord en Nouvelle-Zélande dans les années 1970 : il valorise les méthodes du secteur privé en intégrant désormais une « logique de responsabilité »… que la droite, vainqueur des élections de 1993 et 1995, s’empresse de poursuivre. C’est au même moment que le thème de la « réforme de l’État » s’impose dans le milieu des hauts fonctionnaires et qu’il s’invite dans le débat public, mais il faudra attendre la campagne de 2002 pour voir Jacques Chirac se prononcer pour une réduction de nombre de fonctionnaires. L’autre tendance lourde de cette période concerne les atteintes à l’État social, qui s’accompagnent d’une explosion de la pauvreté. Elle s’accompagne d’un changement dans les représentations économiques, par la dénonciation des cotisations sociales comme une taxation à alléger pour les entreprises et des salaires comme un coût. Et ce sont les finances publiques qui supportent la politique de flexibilité et de baisse du coût de travail, avec les emplois jeunes ou le passage aux 35 heures, tandis que le niveau de chômage ne baisse qu’à la marge. Néanmoins, c’est en décembre 1995 qu’a lieu la plus forte mobilisation sociale depuis 1968 : elle permet de s’opposer avec succès au Plan Juppé sur les retraites et au contrat de Plan Bergougnoux sur le statut des cheminots. Elle ressemble pourtant à la dernière victoire de la « démocratie protestataire » pour la défense d’un État régulateur, « jouant le rôle de garant du lien social et de pourvoyeur d’emplois » (p. 124).
Lorsque Nicolas Sarkozy devient président en 2007 (chapitre 5 : « La crise et la « rupture », 2007-2012), il avait déjà clairement annoncé ses projets aux Français-es : il s’agit « de refonder l’État, de refonder le service public, de refonder la fonction publique. Comme on l’a fait en 1945 avec le programme nationale de la résistance. Comme on l’a fait en 1958 avec le général de Gaulle ». Sarkozy met ses pas dans ceux de glorieuses figures, tandis qu’il appelle « à tourner la page de Mai 1968 ». Mais l’irruption de la crise financière mondiale de 2008 et celle des dettes publiques en Europe l’obligent à modifier les ambitions de son projet de rupture. Il affirme néanmoins sa volonté de renforcer l’exécutif, ou plutôt la fonction présidentielle, au dépens du 1er ministre que devient un simple rouage d’exécution, tandis que ses rapports avec le pouvoir judiciaire se tendent. La réforme de l’État est marquée surtout par la décision du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, toujours dans le but de réduire la dépense publique. Car l’équilibre des comptes des administrations publiques devient un dogme constitutionnel à l’origine de la réorganisation des administrations centrales (armée, justice santé, ambassades…), mais aussi de la volonté de simplifier le « mille feuille administratif », avec le projet de supprimer les départements dans dix ans… On peut considérer « ce coup d’État contre les départements » comme le premier acte d’une tension entre État central et collectivités territoriales, dont un nouvel épisode se jouent en ce moment entre E. Macron et les élus territoriaux. Si N. Sarkozy ne réussit pas à modifier le statut de la fonction publique, en revanche les effectifs de la police, de l’Éducation nationale ou de l’hôpital sont en baisse et est opéré le gel du point d’indice dans un contexte de crise déjà évoqué. L’université comme l’Hôpital restent pourtant sous le contrôle de l’État, avec néanmoins des procédures contractuelles destinées à réaliser des gains de performance, mais l’appel au service marchand privé se multiplie pour certaines dépenses, de l’Armée comme de la justice.
Tout cela est facilité par le renversement de tendance qui rend les mobilisations inopérantes, d’autant que le président affirme que « ce n’est pas la rue qui gouverne… » ou encore que « l’État bureaucratique, paralysé par la lourdeur de son appareil administratif, gaspille les impôts des Français ». En même temps, la politique de baisse de l’impôt se poursuit, en particulier pour les plus grosses fortunes, tandis que le « travailler plus pour gagner plus » renforce le pouvoir d’achat des salariés, mais creusent les inégalités entre les travailleurs à temps plein et les autres salariés, en majorité des femmes. Il en va de même du régime de retraite qui augmente le temps de cotisation des travailleurs et creuse lui aussi les inégalités. En contrepoint de cet affaiblissement de la taille de l’État, ce dernier s’affirme de plus en plus sécuritaire : le discours de Grenoble de 2010 marque une rupture quant à la politique migratoire du pays, en restreignant le regroupement familial, en amalgamant insécurité et immigration, en stigmatisant l’étranger. Autre cible visée : les mineurs délinquants pour lesquels les mesures éducatives sont remplacées par une pénalisation et une sanction des familles. Sans surprise le taux d’occupation des prisons grimpe alors à 200 %, l’une des raisons pour lesquelles la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Le titre du 6e et dernier chapitre est particulièrement éclairant sur l’évolution très récente : « Du social-libéralisme au libéralisme décomplexé (2012-2018) ». Les auteurs rappellent d’abord les deux grandes tendances des deux dernières décennies : le terrorisme global qui entraîne un glissement sécuritaire des États ; le marché globalisé combiné aux contraintes budgétaires européennes qui permettent de légitimer une réforme de l’État selon des modalités de fonctionnement du secteur privé. Le retour de la gauche au pouvoir avec François Hollande favorise la libéralisation sociétale, dont la mesure phare est la loi Taubira de 2013 sur le mariage et l’adoption, qui prolonge le Pacs du gouvernement Jospin. La politique territoriale est en demi-teinte, avec la mise en place d’un nouveau statut pour les grandes métropoles et surtout la réorganisation-fusion des régions en 2015, tandis que la loi Fioraso sur les universités précipite les regroupements d’université et fait craindre un désengagement financier de l’État au profit des collectivités territoriales. En revanche, dans les autres domaines, c’est la continuité avec les gouvernements précédents de droite qui domine. Il en va ainsi de l’obsession de la recherche d’économies dans toutes les administrations publiques, tandis que les entreprises bénéficient du controversé CICE de 40 milliards d’euros, censé relancer l’activité et donc l’emploi. C’est avec l’arrivée de Manuel Valls à la tête du gouvernement que les réorientations libérales deviennent la règle, même si c’est au ministre de l’Économie E. Macron qu’elles sont associées : travail du dimanche, réforme des prud’hommes, vente de milliards d’actifs d’entreprises publiques, et surtout la loi sur le code du travail (dite « loi El Khomri ») en 2016. Enfin, la fin du mandat, marquée par les terribles attentats de 2015 et 2016, voit une renforcement de la politique sécuritaire (état d’urgence renouvelé, loi de Renseignement et loi Antiterrorisme), dont M. Valls admet qu’elles restreignent les libertés des citoyens. Mais la volonté de constitutionnaliser la déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France engendre une cassure avec les forces politiques ayant ramené la gauche socialiste au pouvoir, aggravée par les oppositions à la « loi El Khomri », achèvent de dissuader le président de se représenter en 2017, fait unique dans la Ve République.
L’ouvrage consacre des pages nourris à « L’État selon Macron : l’exécutif expert face à l’entreprise » (p. 171-188), sur lesquelles tenterai une approche globale de la philosophie macronienne du rôle de l’État. L’idée directrice est la responsabilisation individuelle et l’extension de l’action privée aux dépens des protections collectives ou, pour le dire plus simplement, « reporter sur l’individu une partie des défaillances de l’organisation sociale ». Ainsi, la politique d’assistance, sans cesse rognée et mise sous surveillance, vise à « soutenir l’inactivité imposée par les restructurations du marché du travail plutôt qu’à développer l’activité ». Il en va de même dans les services publics où la précarisation progresse et où les méthodes de management du privé remettent en cause l’idée d’une mission de service public. Pourtant la « forte demande d’État, rarement exprimée publiquement par nos élus » (p. 174) se fait sentir, en particulier dans certains territoires. Finalement, le concept de « société civile », tant utilisé lors de la campagne présidentielle de 2017, est un bon révélateur des dynamiques sociétales et des conceptions politiques en cours : elle intègre des individus bien insérés dans la société, des acteurs ayant réussi dans la champ professionnel, des « premiers de cordée » pour reprendre l’expression présidentielle, mais elle laisse au bord du chemin tous les vaincus de la mondialisation victimes de la précarité : ne serait-elle pas le révélateur d’un effacement progressif de l’État dans le cadre néolibéral aux profit de l’ensemble des acteurs privés ? Ayant favorisé son accession au pouvoir, elle devient un des moyens d’exercice de ce pouvoir, mais elle s’accompagne « en même temps » d’une présidentialisation croissante du pouvoir, d’un « État réduit à l’exécutif expert », au dépens des corps intermédiaires. De leur côté, les collectivités territoriales sont soumises à un « pacte girondin » qui s’apparente à un donnant-donnant inégal, puisque le gain d’autonomie est contrebalancé par la demande d’économie (13 milliards d’euros sur le quinquennat), que des associations d’élus qualifient de « recentralisation à outrance », s’inquiétant de l’accroissement des inégalités territoriales. Finalement, pour le dire brutalement, La République En Marche (LREM) serait le premier gouvernement en capacité d’acter la fin de l’État social.
La brillante conclusion de Danielle Tartakowsky et Michel Margairaz ouvre des perspectives plurielles, à la fois dans la durée historique de l’histoire française, comme dans celle de la place de l’État dans un monde globalisé. Ils rappellent que le pays a connu trois configurations successives du compromis social : le compromis républicain de la IIIe République, auquel s’est greffé l’État social né de la période 1936-1946, tandis que les années 1980 ont vu émerger le modèle néolibéral, lequel continue à rogner les derniers acquis de l’État social, à dissocier le lien entre mouvement social et politique et finalement à renforcer les inégalités sociales entre « premiers de cordée », assistés et classes moyennes (salariés et retraités) soumises à l’impôt. Mais les auteurs insèrent aussi cette dynamique dans une perspective plus large, celle de « l’État du nouvel âge global » analysé par Saskia Sassen : si la mondialisation ne s’est pas développée sur les ruines de l’État national, elle a fragilisé les acteurs politiques traditionnels au profit d’une horizontalité des pratiques individuels. « Et ce sont les individus qui absorbent désormais le citoyen et les principes d’égalité et de souveraineté. Les droits de l’homme, dépolitisés, tiennent désormais lieu de support aux demandes des individus » (p. 196). De même, elle a bouleversé l’équilibre entre les pouvoirs, au profit de l’exécutif, dont on voit depuis quelques années les dérives dans bon nombre de pays démocratiques. Enfin, elle a favorisé la collusion entre les milieux financiers et politiques, accru le nombre d’affaires de corruption mises à jour, en somme elle a permis de substituer au politique la « question morale ». Finalement, ne serait-ce pas tout simplement la démocratie qui serait menacée par ces dynamiques historiques ou, pour le dire autrement, ne serions-nous pas en train de vivre un « âge de la régression » démocratique ?