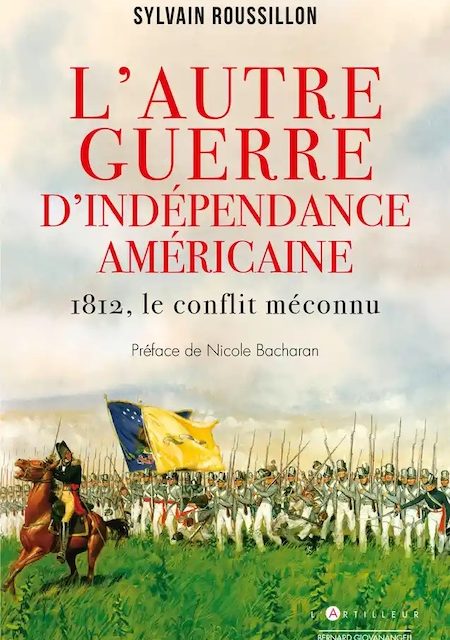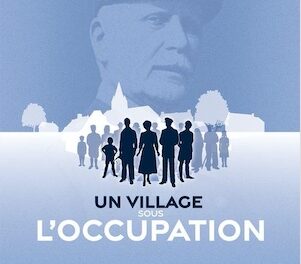Pour l’amateur d’histoire, l’année 1812 évoque avant tout la disparition de « l’armée des 20 nations » emmenée par Napoléon dans les profondeurs de la Russie, premier des chocs qui devait amener la chute du Grand Empire. Au delà d’un occidentalo-centrisme bien compréhensible, l’historiographie actuelle tend cependant à s’intéresser de plus en plus aux impacts sur l’ensemble des régions du globe de l’affrontement entre la France révolutionnaire puis impériale et l’Europe plus ou moins coalisée, impacts qui furent réels, constants et lourds de conséquences ; on citera à titre d’exemple le récent et remarqué Les guerres napoléoniennes. Une histoire globale, d’Alexander Mikaberidze, paru chez Flammarion en 2020 et objet d’une recension pour la Cliothèque consultable ici.
C’est dans ce contexte que se place le sujet de cet ouvrage, réédition probablement pas fortuite à l’approche d’une année napoléonienne d’un texte déjà opportunément publié en 2012 sous un titre quasi similaire (L’autre 1812, la seconde guerre d’indépendance américaine). En juin de cette année là en effet, alors que la Grande Armée se masse sur le Niémen en vue de la funeste invasion, les jeunes Etats-Unis déclarent la guerre à leur ancienne puissance tutélaire, le Royaume de Grande-Bretagne, prélude à un conflit qui va se développer sur terre et sur mer pendant plus de 30 mois. C’est au récit de ces événements méconnus que s’attache Sylvain Roussillon.
White House down
On trouvera dans la première partie de l’ouvrage une présentation des origines de la guerre. L’auteur retrace d’abord la progressive gestation des Etats-Unis de la période post-révolutionnaire. Ayant à gérer la vaste problématique des territoires ouverts de l’ouest (surtout après l’achat de la Louisiane en 1803), dépourvu par choix d’armée régulière, encore largement dépendant des importations européennes pour les produits manufacturés, le nouvel Etat fédéral voit sa classe politique se cliver entre fédéralistes plutôt conservateurs et démocrates-républicains plus progressistes. Ceux-ci parviennent à faire élire comme président Jefferson (1800-1808), qui tend vers une politique de neutralité dans le conflit franco-britannique, dont les retombées économiques sont pourtant lourdes.
La Couronne ne se montre cependant pas avare de provocations sur les frontières indiennes et en mer, et la poussée belliciste qui en découle dans certains milieux américains est exploitée par son successeur Madison, à l’approche de nouvelles élections présidentielles, pour déclencher le conflit. Préoccupations intérieures et internationales sont étroitement liées dans les esprits de son administration, qui espère ainsi prendre le contrôle à bon compte du Canada, museler l’opposition indienne, rétablir la liberté de navigation des bâtiments américains et marginaliser les fédéralistes encore liés à l’ancienne puissance colonisatrice. Mais celle-ci, sans escompter rétablir sa tutelle, est fermement décidée à définitivement brider l’expansion de ses ex-sujets.
Les opérations qui débutent en 1812 (deuxième partie de l’ouvrage) vont donc être disputées. Lancées à l’offensive avec un optimisme souvent mêlé d’incompétence, les troupes américaines sont sévèrement étrillées dans la région des Grands Lacs, où Hull perd Détroit. En mer, la petite flotte de guerre américaine et les nombreux corsaires qui la renforcent tiennent par contre la dragée haute à la puissante Royal Navy. L’année suivante (troisième partie de l’ouvrage), de durs combats, la victoire navale de Perry sur le lac Erié et celle d’Harrison sur la Thames, qui voit la mort du chef indien Tecumseh, ennemi juré des Américains, permettent à ceux-ci le retour sur leurs positions initiales dans le Nord-Ouest.
Mais les succès ne sont pas exploités ; pareillement sur le front du lac Ontario où on se contente de brûler York (moderne Toronto) avant de perdre de nouveau du terrain. Et, sur le Saint-Laurent, les fortes colonnes lancées à la conquête de Montréal à l’automne sont piteusement repoussées par les Anglo-Canadiens, dans les rangs desquels combattent de nombreux volontaires francophones, tandis que le soulèvement des Creeks agite l’ouest.
L’année 1814 (quatrième partie) voit l’arrivée progressive sur le théâtre des opérations de troupes régulières britanniques expérimentées, rendues disponibles par la chute de l’Empire, alors que les Américains se réorganisent. Dans la région du Niagara, les deux adversaires se neutralisent par de rudes coups ; sur le lac Champlain, la forte armée d’invasion lancée par les Britanniques est miraculeusement stoppée par la victoire navale de MacDonough à Plattsburgh. Mais ceux-ci sont maintenant décidés à porter l’offensive au cœur des Etats-Unis : en août, leur flotte apparaît dans la Chesapeake, débarquant un corps expéditionnaire qui vient incendier les édifices publics de Washington, mal défendue et évacuée dans la panique. L’humiliation fouette l’orgueil des Américains ; en septembre, ils soutiennent victorieusement l’attaque devant Baltimore, poussant l’adversaire au retrait. Dans le sud, les Creeks sont définitivement matés ; les Britanniques cependant occupent Pensacola en Floride espagnole, d’où ils menacent la Louisiane.
Les belligérants sont néanmoins bien conscients de leur neutralisation réciproque : en décembre, une paix basée sur le statu quo ante bellum est négociée à Gand. Mais le délai que la nouvelle met à gagner le Nouveau-Monde donne lieu à d’ultimes affrontements (cinquième partie), en Géorgie et surtout à la Nouvelle-Orléans, devant laquelle les Britanniques subissent le 8 janvier 1815 leur pire défaite de toute la guerre. Les ultimes coups seront portés par l’USS Peacock devant Java en juin.
Une guerre pour rien ?
Sans conséquences territoriales, peu coûteuse humainement, la guerre anglo-américaine va avoir un impact politique profond, tel que l’expose l’auteur dans la conclusion de l’ouvrage. Décrédibilisé, le parti fédéraliste est rapidement marginalisé sous la présidence Monroe (1816-1824) qui entend mener une politique d’union nationale autour de l’exaltation née de la guerre. Sa fameuse doctrine, énoncée en 1823, vient en complément matérialiser le rôle prépondérant que se donnent les Etats-Unis sur le continent américain après un conflit qui les a vus définitivement s’émanciper de leur ancienne puissance coloniale. En découlent les sentiment national, nationalisme et impérialisme qui à des degrés divers vont les guider jusqu’à nos jours.
Au final, Sylvain Roussillon livre ici un récit prenant sur un conflit méconnu ; sans doute le « premier écrit en français sur le sujet », même si certains (dont l’auteur de ces lignes) se rappelleront l’avoir découvert à la lecture de l’ouvrage consacré à l’Indépendance par le prolifique Indro Montanelli dans la trop courte série illustrée (et traduite) Les guerres américaines, publiée chez Atlas dans les années 80, et/ou à celle des deux superbes volumes dédiés par Liliane et Fred Funcken à L’uniforme et les armes des soldats des Etats-Unis1(Casterman, 1979-1980), auxquels du reste S.Roussillon se réfère lui-même.
De cette guerre, il en déroule, en un peu moins de 200 pages aérées au fil de 20 chapitres simplement organisés selon une logique à la fois chronologique et géographique, les différents épisodes, dont les plus pittoresques ; on suivra ainsi l’étonnant périple du commodore Porter dans le Pacifique, ou le ralliement décisif des frères Laffite et de leurs flibustiers à la veille de la bataille de la Nouvelle-Orléans2.
Concis et d’une lecture plaisante, le texte est assis sur une solide bibliographie. L’auteur n’est à priori pas un spécialiste du sujet ; présenté comme « directeur d’une école d’enseignement supérieur » (en laquelle on reconnaîtra l’Institut des Sciences Sociales, Economiques et Politiques fondée à Lyon par Marion Maréchal), ancienne figure de proue du renouveau monarchiste, proche du groupe RN en Auvergne-Rhône-Alpes, Sylvain Roussillon livre depuis quelques années divers ouvrages historiques (Les brigades internationales de Franco (2012), Le communisme français avant le Congrès de Tours (2019), L’épopée coloniale allemande (2021), les fascismes russes (1922-1945) (2021)) qui ont tous pour point commun de s’intéresser à des « angles morts » de l’historiographie française.
Il offre ici, dans une approche évidemment très américano-centrée, une vision globale des événements et de leur arrière-plan politique, servie par d’indéniables qualités de rédaction. Agrémenté d’utiles cartes et d’une préface de la politologue Nicole Bacharan, l’ouvrage constitue donc une intéressante introduction à un conflit qui devait constituer un tournant de l’histoire des Etats-Unis.
Indéniablement déterminante de ce point de vue, cette « seconde guerre d’indépendance » allait néanmoins les laisser face à un certain nombre d’inachèvements ; la « nation (forgée) dans les épreuves » du conflit telle que mentionnée par l’auteur ignorait voire excluait toute une partie de la population du territoire (esclaves, Indiens…) et restait divisée par de profondes divergences parfois irréconciliables. Après l’aiguillon constitué par un autre conflit méconnu, la Guerre du Mexique, la Guerre de Sécession, un demi-siècle plus tard, allait en être l’expression la plus sanglante.
1Auteurs de BD prolifiques, piliers du journal Tintin, les Funcken réalisèrent entre 1966 et 1982 une série de 17 albums illustrés et de plus en plus précis bien connus des amateurs d’uniformologie, auquel vint s’ajouter un ultime volume publié à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française.
2Pour l’anecdote, l’épisode devait donner lieu au seul film jamais réalisé par l’acteur Anthony Quinn : Les boucaniers (1958), avec Yul Brunner dans le rôle de Jean Laffite et Charlton Heston dans celui du général Andrew Davis, défenseur de la Nouvelle-Orléans et futur président des Etats-Unis ; une des très rares mises en scène du conflit au cinéma.
Stéphane Moronval