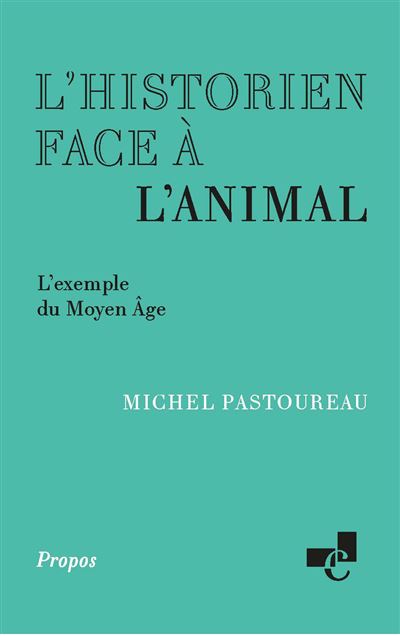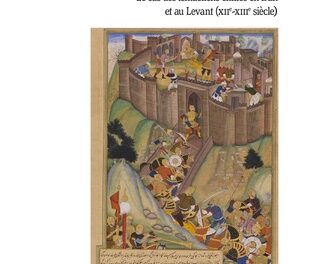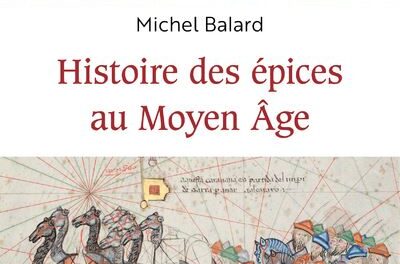« Longtemps, les historiens ne se sont guère préoccupés de l’animal, l’abandonnant aux recueils d’anecdotes et à la « petite histoire ». Au cours des dernières décennies cependant, l’animal est devenu un objet d’étude à part entière. Dans cette mutation, les médiévistes ont joué un rôle pionnier, non sans devoir affronter divers obstacles. Michel Pastoureau soulève dans cet essai plusieurs questions essentielles. Que faire des savoirs de notre temps quand on est historien d’un passé lointain ? Comment éviter de conduire des enquêtes téléologiques ? Nos connaissances actuelles ne sont nullement des vérités, seulement des étapes dans l’histoire des savoirs : elles feront sourire nos successeurs comme nous font sourire les bestiaires du Moyen Âge. » École Nationale des Chartes, 4e de couverture.
Si Michel Pastoureau est maintenant bien connu d’un large public éclairé Ses livres sur les couleurs et leur symbolique dans l’histoire sont devenus des best sellers et même de magnifiques objets à offrir… , on sait moins qu’il a fait ses études supérieures à l’Ecole des Chartes – promotion 1972.
Un petit livre de plus ?
Que la toute jeune collection « Propos » fasse honneur à l’un des ses plus célèbres élèves n’est pas étonnant. Mais que peut dire ici en moins de 100 pages un historien qui depuis 50 ans a contribué à remettre à l’honneur un quasi-millénaire à travers des sujets « futiles, anecdotiques ou marginaux » ?
La collection, lors de son lancement, présente son projet ainsi :
« L’École nationale des chartes – PSL lance une nouvelle collection de courts essais sur des thèmes au cœur de ses spécialités destinés à un public de curieux ou d’amateurs éclairés. »
Au delà du rapport de l’historien à l’animal, sur lequel Michel Pastoureau aura beaucoup écrit, se joue peut-être un autre enjeu, cher aux Chartistes, celui de concilier la rigueur scientifique dans la recherche avec l’humilité face à la vérité historique…
Le christianisme et les animaux
La considération historienne pour l’animal a beaucoup évolué depuis les années soixante et la thèse Michel Pastoureau, Le bestiaire héraldique au Moyen Àge, thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, 1972, 6 vol. de l’auteur sur le bestiaire héraldique médiéval à l’école des Chartes.
Si les médiévistes ont su faire se décloisonner les différentes sciences s’y intéressant, c’est dû en grande partie à l’extraordinaire intérêt des écrits et donc des hommes du Moyen Âge pour les animaux. Aucune autre époque ne l’a autant observé, raconté, représenté et fantasmé, notamment dans les églises, au vu et au su des fidèles et surtout des clercs.
Ce qui n’empêche pas des courants de pensée contradictoires. D’une part, très majoritairement l’idée d’une séparation très nette entre l’humain, créé à l’image de Dieu et l’animal, créature imparfaite, voire impure. Moqueries, fantasmes, interdictions morales et juridiques ; les matières à évoquer l’animal sont innombrables.
Il existe néanmoins un second courant, inspiré d’Aristote qui pressent qu’animaux et humains forment une même communauté d’être vivants. Les écrits de saint Paul sur le fait que les animaux seront également sauvés lors du Jugement Dernier influencent fortement certains théologiens dont le plus célèbre est François d’Assise.
Ainsi, les interrogations sur les animaux – que l’on s’en écarte ou qu’on y voit des proches – conduisent à des questions redoutables : « Ont-ils une âme ? » ou « Faut-il les traiter ici-bas comme des êtres responsables de leurs actes ? »
Savoirs et classements
Si de nombreuses assertions de l’époque nous font sourire comme les classifications ou les hiérarchies animales (à part le Roi-Lion) ou encore les animaux fantastiques que nos lointains prédécesseurs considéraient comme réels (dragons, licornes, etc.), Michel Pastoureau nous met en garde contre tout anachronisme ou pire, tout mépris scientifique. Pas sûr que ceux qui nous suivrons dans une centaine d’années n’auront pas le même rire sarcastique quant à nos « vérités ». À nous de ne les prendre que comme des étapes dans l’histoire des savoirs.
Qui se ressemble s’assemble
Les médiévaux ignorent la notion de mammifère ou celle d’insecte. Leurs classifications reposent sur d’autres critères que la zoologie contemporaine inspirée par les grands naturalistes des XVIIIe et XIXe. Hormis 4 grandes catégories dans les contours sont flous et poreux (quadrupèdes, oiseaux, poissons, serpents et vers), il y a celle des monstres (monstra) créatures mi-bêtes, mi-humains, indigènes de contrées exotiques… Le cas de la licorne est instructif : personne ne met son existence en doute. Quant au dauphin, il est le roi des poissons et est donc logiquement représenté avec une couronne.
On comprend combien cette classification emprunte à l’imaginaire et aux représentations divines, ou plutôt infernales, tant présentes dans les églises.
Bestiaire christologique, bestiaire diabolique
Le discours chrétien modifie la classification par l’aspect physique. Le bestiaire chrétien met en avant le poisson durant le haut Moyen Âge. Puis il est remplacé par l’agneau dont l’usage sacrificiel antique suggère celui du Christ. La colombe, oiseau blanc et messager – c’est elle qui informe Noé des intentions de Yahvé – est l’oiseau le plus important du bestiaire chrétien. Son inverse, le corbeau, est noir et donc diabolique.
Le cas du lion est intéressant des évolutions des mentalités dans ce temps très long du Moyen Âge. C’est d’abord une créature infernale par sa gueule rugissante, symbolisant celle de l’Enfer dans les Psaumes et chez saint Augustin. Puis, il devient – tel le Christ – un animal noble et miséricordieux. On comprend ainsi pourquoi il prend à partir du XIIIe siècle la place de l’ours comme roi des animaux.
Le bestiaire infernal est lui beaucoup plus abondant, car probablement témoin des peurs de l’époque : ce sont les animaux « sombres » (loup, ours, bouc, corbeau, hibou…) et verts (dragon, serpent, basilic, sirène, sauterelle…). Puis les animaux répugnants et traitres comme les serpents ou le porc, impurs et lubriques.
Anthropologie
Un troisième classement – certes non exclusif des deux autres – s’appuie sur la ressemblance avec l’humain. Trois cas de quadrupèdes intriguent fort les contemporains : l’ours, le porc et le singe.
Le singe
Pour Aristote – référence incontestable au Moyen Âge – le singe est le plus proche de l’homme. Mais cette proximité heurte les valeurs chrétiennes, l’animal ne pouvant être qu’imparfait par rapport à la créature créée par Dieu. La scolastique du XIIIe siècle trouve la solution au paradoxe : le singe ressemble à l’homme non par nature mais par imitation ! Il simule (simius) comme son nom latin l’indique, et n’en est que plus démoniaque On comprend que Darwin ait eu quelques difficultés à faire admettre sa théorie de l’évolution….
L’ours
En fait, pour beaucoup d’auteurs médiévaux, c’est l’ours qui est le plus proche de l’homme, par sa stature verticale, l’usage adroit de ses mains et surtout son pied entièrement posé sur le sol – qualité que seuls l’homme et lui partagent. Il peut comme lui courir, nager, sauter, lancer des objets et même danser.
Le porc
Le cas du porc est beaucoup plus ambigu. La médecine médiévale, qu’elle soit musulmane ou chrétienne, sait que sa constitution et ses organes sont proches de l’humain. Mais ils ne doivent pas trop contredire les clercs, pour lesquels l’animal est au moins impur. il est donc vraisemblable que les tabous religieux anciens qui pèsent sur lui sont liés à cette proximité biologique trop grande avec l’humain.
D’autres comportements culturels nous intriguent. Ainsi, les procès auxquels son espèce est soumise à partir du XIIIe siècle. Pour beaucoup d’auteurs chrétiens de l’époque, l’animal est responsable de ses actes, car il a une âme et un certain intellect, la limite étant qu’il ne peut concevoir de pensées abstraites ou religieuses. Et puis, cette question du tabou religieux dans deux des religions du Livre…
Tabou religieux
On a souvent annoncé la question de l’hygiène dans les contrées tropicales. En fait l’argument climatique ne tient guère : on mange du porc en Indonésie et dans la péninsule indochinoise. On notera que du coté du symbolique, toute société sans s’en rendre compte a ses tabous alimentaires. Ainsi nous ne mangeons ni chien ni chat. Parallèlement, certains peuples – les Crétois ou les Galates – n’en mangent pas, non par crainte d’être intoxiqués mais parce qu’ils considèrent l’animal comme sacré.
Plusieurs explications, d’ordre historique, ont une certaine faveur : le porc était considéré comme un animal votif Soit un animal offert en sacrifice aux Dieux. chez les Cananéens, ce qui aurait pu expliquer l’anathème des Hébreux sur cet animal. D’autre part, comment des éleveurs nomades auraient-ils pu emmener dans leurs déplacements un animal si sédentaire ?
Si l’on reprend les taxinomies en vigueur au Moyen Âge, les animaux qui ne trouvent pas leur place dans les quatre grandes classifications sont considérés comme impurs ou maléfiques. Ainsi du porc. Bien qu’animal à sabots fendus comme tous les ruminants, le porc ne rumine pas. Mais n’oublions pas ce cousinage biologique troublant entre le porc et l’homme. Manger du porc, n’est-ce pas être anthropophage ?
Un discours prolixe
Concernant le livre, textes, matériaux et images fournissent un riche aperçu de l’intérêt pour les animaux. Parmi les nombreuses catégories de livres, arrive en premier la Bible, référence incontournable des savants de l’époque. Puis les bestiaires, riches d’informations nouvelles par rapport à l’Antiquité, période elle aussi riche en sources écrites.
La Bible
Autorité suprême mais aussi immense encyclopédie, l’Ancien Testament évoque une riche galerie, du serpent de la Genèse à la baleine de Jonas. Idem pour le Nouveau Testament,
Les bestiaires
On désigne sous ce nom les textes qui ont pour fonction de décrire les caractéristiques des animaux et d’en tirer des conclusions morales et religieuses. Ainsi le lion, censé dormir les yeux ouverts, montre une vigilance tel le Christ avant sa résurrection. On le verra donc régulièrement aux portes des églises. Inversement, le porc, toujours les yeux au sol à le fouiller de son groin, symbolise l’homme pêcheur uniquement occupé à sa jouissance matérielle.
Les historiens positivistes de la fin du XIXe ont souvent moqué comme ridicules ces bestiaires. Cette opposition binaire entre crédulité religieuse et sérieux scientifique a même persisté jusque dans les années soixante.
On retrouve ici la raison de l’écriture de ce petit livre – alors que l’auteur a publié sur plusieurs décennies une oeuvre considérable sur le sujet. Comment l’historien doit-il aborder les représentations qu’une époque se fait de l’animal ? Ce biais d’anachronisme et ce refus d’accepter un relativisme culturel ne poserait pourtant aucun problème à un ethnologue ou à un anthropologue…
Le Roman de Renart
C’est peut-être le texte littéraire du Moyen Âge le plus connu du grand public. Ce monument littéraire est composé de vingt-sept poèmes, rédigés entre le XIIe et le XIIIe siècle par une vingtaine de clercs différents sur trois générations. Outre son côté « chanson de geste parodique », sa trame narrative présente une remarquable continuité dans l’affrontement entre Renart le goupil et Ysengrin le loup.

Ce qui intéresse l’historien, c’est que l’on a affaire à une véritable société, à l’image de celle des hommes et où tous les animaux parlent comme des humains.
Le comique des situations ne masque aucunement la satire sociale ; l’image donnée des campagnes correspond bien à ce que l’on sait du monde rural de l’époque.
Le loup est borné et stupide et il ne fait pas vraiment peur. Il semble que la peur du loup soit plus certainement l’apanage de période de crises, comme au XVIIIe avec la bête du Gévaudan. Quant à Renart, que le grand public a vu comme une sorte de héros rusé et même redresseur de torts, les écrits postérieurs le présentent comme de plus en plus cynique et retors. Ce qui fait écho à la façon dont la taxinomie du temps le voit : c’est un animal qui ne marche par droit, qui est roux, qui triche constamment, bref c’est un pêcheur.
Et puis il y a là le reflet d’une tendance de plus en plus critique des auteurs vis à vis des vices de la société : personne n’est épargné, puissant ou misérable.
Quoi qu’il en soit, le succès du roman de Renart ne se dément pas au fil des époques, puisqu’il a été adapté en langue locale sur tous les continents. On sait que son nom propre a remplacé son nom d’origine en français, gage d’une popularité jamais démentie.
L’animal dans l’image
Longtemps cantonné à un rôle d’illustration dans les écrits sacrés du haut Moyen-Àge, l’animal devient au XIIe siècle objet d’intérêt pour lui-même. Ce tournant capital dans l’iconographie pour la représentation humaine vaut aussi pour cette créature, certes imparfaite, mais créée par Dieu. L’auteur considère le fameux « éléphant de Saint-Louis » au milieu du XIIIe siècle comme le premier exemple de portrait animal dessiné de façon réaliste et nommé comme tel – au sens moderne du mot.cf. Michel Pastoureau Les animaux célèbres 2e éd., Paris, 2001, p. 142-151.
Les bestiaires respectent aussi une hiérarchie précise reflétant les préoccupations du temps ou la tradition : le lion, l’ours, la licorne et le dragon ont droit à une pleine page, tandis que le loup, le cerf ou le cheval, à une miniature de grande taille. Oiseaux, poissons, serpents et autres « vers » doivent se contenter de petites miniatures.
Les animaux sont représentés nommés, comme la tradition biblique l’atteste : « Adam donne leur nom aux animaux » (créés par Dieu), et selon la nomenclature proposée par Isidore de Séville.
Attributs et représentations
Fort logiquement pour l’époque, la question du réalisme ne se pose pas. Chaque animal possède un attribut qui le distingue d’une autre espèce morphologiquement semblable et que chacun est à même d’identifier, dans la lignée des bestiaires de Pline et d’Isidore. Ainsi, l’autruche et la grèbe, indistincts sur les représentations, se reconnaissent immédiatement par l’objet qu’elle tiennent : l’autruche, un fer à cheval dans le bec, lié à sa réputation de tout avaler – même le métal – et la grèbe, un caillou dans la patte qu’elle lance au sol pour avertir ses congénères d’un danger.
Parallèlement et ce n’est pas un hasard, c’est à partir du XIIe siècle que les attributs des hommes dans les iconographies affichent le désir de différenciation sociale : diversification des noms de baptême et apparition du nom de famille – le « nom dernier » des Anglo-saxons – naissance des armoiries et règlementations des pratiques vestimentaires.
Gardons-nous de toute arrogance scientifique !
Michel Pastoureau souligne en conclusion qu’ « ironiser sur les discours des bestiaires ou corriger les représentations des enlumineurs est absurde : ce serait supposer que nos savoirs actuels sont des vérités, alors qu’ils ne constituent qu’une étape dans l’évolution des savoirs ».
Dit autrement : que faire de nos connaissances actuelles – ici en zoologie au XXIe siècle – quand on étudie celles d’un passé lointain ?
L’accusation de relativisme n’est pas loin, mais l’auteur n’en a cure, car la qualité des champs de recherche qu’il a ouvert parle pour lui.