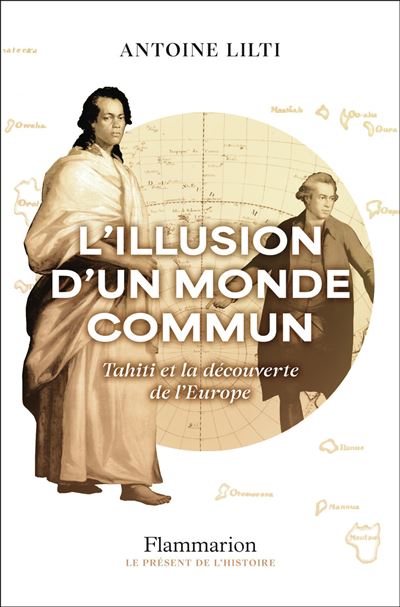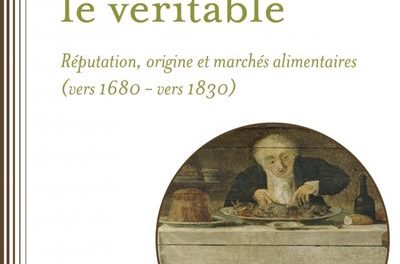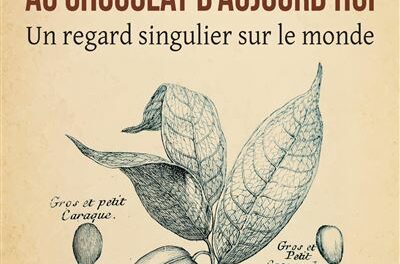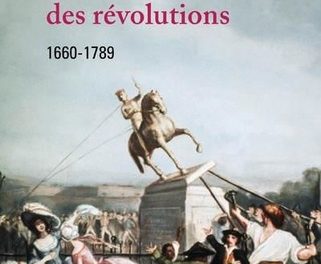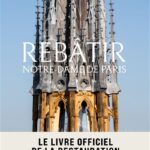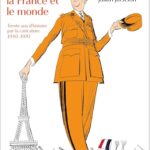Antoine Lilti se propose de « restituer l’histoire oublié-e des voyageurs polynésiens embarqués avec les Européens. Je n’écris pas un contre-récit des explorations du Pacifique, je ne cherche pas à en dévoiler la face cachée, encore moins à opposer l’histoire des uns et celle des autres, mais à comprendre autrement une histoire commune. » (p. 28)
Il retrace la venue des Tahitiens en Europe, les réactions des hommes des Lumières, mais aussi les tentations impériales. La difficile rencontre de deux mondes culturels différents conduits à l‘illusion d’un monde commun.
« Il s’appelait Aotourou »
L’auteur, spécialiste de l’histoire sociale, culturelle et intellectuelle des Lumières, part des premiers écrits des visiteurs de la Polynésie au milieu du XVIIIe siècle : Bougainville, Commerson et du Compte-rendu que Diderot a fait des Voyages autour du monde de Bougainville. Diderot en profite pour une attaque du colonialisme, de la société occidentale tout en niant un possible dialogue interculturel.
Antoine Lilti s’intéresse à AotourouAhutoru dans l’orthographe actuelle que Bougainville ramène en Europe. Qui était-il ? Comment a-t-il vécu ce dépaysement ?
L’enquête
Que sait-on d’ Aotourou ?
Il y a peu de traces de cet homme avant le récent livre de Véronique Dorbe, Ahutoru ou l’envers du voyage de Bougainville à TahitiEd. le Vent des îles, 2003.
L’expérience d’Ahutoru est à rapprocher de celles d’autres polynésiens embarqués sur un navire européen comme Tupaia avec Cook, Hitihiti, Omai ou Pautu qui naviguèrent vers le Pérou sur un bateau espagnol. L’auteur présente sa méthode d’analyse et le contexte épistémologique de ses travaux. Il rappelle que d’autres « sauvages » ont connu ce voyage dès le XVIe siècle.
Le rêve austral des Lumières
Le récit remet en lumière les premières incursions européennes en Polynésie, dès la fin du XVIe siècle. Les marins et les scientifiques, des XVIIe et XVIIIe siècles, sont à la recherche d’un continent inconnu à découvrir dans le vaste Pacifique. C’est l’occasion pour le lecteur de (re)découvrir Philippe Buache, Buffon, Maupertuis, de Brosses dont les idées préfigurent les voyages de Bougainville et de CookVoir les textes présentés dans Clio-texte : Explorations du XVIIIe siècle: Cook et Bougainville.
Une prophétie
« Les Tahitiens étaient-ils curieux des Européens ? » (p. 45), c’est la question de ce chapitre qui présente en détail la tradition tahitienne qui annonçait, par la prophétie d’un prêtre, l’arrivée des européens quelques années avant 1767, date du premier contact avec le Dolphin, de Samuel Wallis.
Tayo Maté
Les visiteurs européens rapportent tous la même « légende » : éloignement du si long voyage, accueil amical des Îliens et compréhension malgré l’écueil de la langue. Ils ajoutent un regard plein de promesses envers les femmes, des récits enchanteurs. Cette description d’îles paradisiaques ne reflète pas la réalité comme le montre les journaux de bord, notamment celui du premier navire à toucher la Polynésie Le Delphin qui évoque des maladies, l’attaque de nombreuses pirogues et a méfiance des hommes. On peut parler d’ambivalence dans les relations entre Européens et Tahitiens : entre rejet des intrus, curiosité et premiers « échanges marchands ».
Le terme de tayo ou taio retenu par les Européens comme « ami », représente peut-être plus un lien rituel. Le terme d’ami est, au XVIIIe siècle, représentatif d’une doctrine : la domination sans contrainte.
Une petite Cythère
Ce chapitre est consacré au regard que les Européens portent sur les femmes insulaires : belles, désirables et peu farouches, alors que, pour l’anthropologue Serge Tcherkézoff, la liberté sexuelle des Tahitiennes est une fiction. Elle est née d’une méprise des Européens sur le « don » par le groupe de jeunes filles, un acte public et cérémoniel lié au culte du dieu ‘Oro et destiné à capter le pouvoir symbolique de ces étrangers, doués de grands pouvoirs grâce à leurs armes puissantes.
Dans les textes européens, on trouve trace de cette ambiguïté des relations sexuelles, pas aussi consenties et gratuites que rapporte la légende rapportée par les récits de voyage.
Les malentendus étaient sans doute réels mais partiels.
Quitter Tahiti
Pourquoi certains îliens ont-ils accepté de partir vers l’Europe ? Sont-ils partis de leur plein gré ?
L’auteur montre à la fois les réticences de Bougainville, une décision collective des Tahitiens et la volonté de l’un d’eux : Ahutoru. Les marins décrivent une volonté de monter à bord de L’Étoile ». Au cours du voyage, il se montre très curieux.
Les autres Polynésiens qui se sont embarqués, sur différents navires, semblent bien être à l’origine de leur départ comme le montre les exemples de Tupaia avec Cook et de Hitihiti qui va, avec les Anglais en Nouvelle-Zélande, à l’Île de Pâques avant un retour à Tahiti.
Conversations
Contrairement aux espoirs de Bougainville qui espérait faire d’Ahutoru un intermédiaire sur d’autres îles, c’est un échec aux Samoa dont il ignore la langue ou au Vanuatu où il se montre méprisant. Il est par contre impressionné à Java et à batavia par les nouveautés qu’il découvre et notamment les savoirs médicaux des Européens.
Au cours du voyage, les échanges avec Bougainville permettent à ce dernier de percevoir l’envers du décor paradisiaque, la violence des guerres locales.
La carte de Tupaia
Le savoir de Tupaia, grand prêtre du dieu ’Oro, est reconnu par Cook et notamment ses connaissances géographiques des divers archipels, de leur localisationLa carte a été retrouvée au British Muséum, en 1957.
Cette connaissance atteste de la navigation à longue distance des Polynésiens et la mémoire transmise de leur arrivée. Tupaia est parvenu à traduire la tradition orale dans le langage cartographique des Anglais. Les principes de représentation sont présentés en détail dans ce chapitre.
Il fut aussi un intermédiaire efficace avec les maoris de Nouvelle Zélande, appartenant au même espace linguistique.
Les Polynésiens présents sur les navires n’étaient ni des captifs, ni des invités de marque, mais des intermédiaires recherchés pour la navigation et la découverte de nouvelles îles.
Une stérile curiosité
Ce chapitre tente d’aborder ce que furent les curiosités, les sentiments d’Ahutoru confronté au monde de la cour de Versailles, très exotique pour lui.
D’autre-part, il est lui-même objet de la curiosité des savants, en particulier de Charles-Marie de la CondamineLes Conquistadors du savoir, une fabuleuse épopée scientifique en Amérique du Sud,1735-1743, Bernard Jimenez, Grenoble, Glénat, collection La société de géographie, 2024 qui en a fait un portrait. Antoine Lilti en propose une analyse autour de la notion de « sauvage », débattue au XVIIIe siècle.
La faible maîtrise du français par Ahutoru empêchait des contacts approfondis avec ses interlocuteurs savants ou curieux qui attendaient des démonstrations d’admiration pour les réalisations de la France. L’intérêt ne dura pas.
« Un bon échantillon » ?
L’auteur évoque le voyage d’un autre Tahitien Mai, arrivé à Londres en 1774. L’opinion bien que curieuse est alors plus préoccupée de l’indépendance américaine. On a des témoignages du séjour de mai dans la presse britannique. Il fut vacciné contre la variole, procédé en pleine expérimentation.
On peut approcher les ambivalences de ce séjour grâce à sa rencontre avec la romancière Fanny Burney qui témoigne d’ l’intégration de Mai qui, outre l’anglais, a appris les codes de la société anglaise. Fanny Burney semble, comme nombre de ses amis, n’avoir que peu de curiosité pour la Polynésie, ses écrits montrent une société sûre de la supériorité.
L’auteur analyse le portraitIl est reproduit dans l’encart après le p. 192. Encart qui présente divers portraits et paysages représentant Tahiti réalisé par le peintre Joshua Reynolds, portraitiste de l’aristocratie.
Retour dans le Pacifique
On a peu de sources sur les retours. Si le président Brosses regrette le faible investissement dans l’éducation d’Ahutotu, faute d’un projet politique, G. Forster, pense lui aussi que le retour de mai aurait pu être préparé pour que des connaissances (agriculture, industrie) puissent profiter aux Polynésiens.
Mourir à Madagascar
Ahutoru repart en 1770 sur un navire qui se rend à l’Île-de-France (Maurice) dont l’intendant est Pierre PoivreIl s’appelait Poivre – Un chasseur d’épices dans la mer des Indes (1750-1772), Gérard Buttoud, L’Harmattan, 2016, dont l’auteur retrace la carrière. On a quelques témoignages sur le séjour d’Ahutoru. C’est Marc-Joseph Marion-Dufresne , installé à l’Île-de-France qui se charge d’organiser le voyage vers Tahiti. Ahutoru, qui embarque malade le 26 octobre 1771, meurt lors de l’escalade de Madagascar, le 6 novembre, victime de la variole.
L’auteur rapporte le voyage de Marion-Dufresne : Tasmanie, Nouvelle-Zélande, découverte et baptême de l’île Crozet.
Conflit de loyauté
L’auteur rappelle les initiatives de la vice-royauté du Pérou dans le Pacifique. C’est ainsi que le Tahitien Pautu est ramené à Lima en 1773, baptisé. L’attitude des Espagnols diffère de celle des Anglais ou des Français qui n’ont pas cherché à convertir mai ou Ahutoru.
L’ambition péruvienne tait double : convertir les hommes et faire reconnaître la souveraineté espagnole sur Tahiti : une courte expérience (nov. 1774 – nov. 1775).
Le récit qu’en firent les Espagnols permet de saisir le conflit de loyauté dans lequel s’est retrouvé Pautu, pris entre sa famille qu’il retrouve à son retour de Lima et les Espagnols qui lui imposent une vie chrétienne. Le refus de Pautu de porter des vêtements occidentaux est perçu comme une trahison. Cette situation atteste de la difficulté à concilier deux systèmes de vie et de croyance.
Huahine
Ce chapitre est consacré au retour de Mai à Tahiti après un an de voyage. Les relations avec Cook se détériorent rapidement, car le contexte à Tahiti a changé depuis les précédents voyages de Cook, du fait du séjour des Espagnols.
L’auteur montre les conséquences des idées anglaises de développer l’élevage en échange de l’eau et des fruits dont on besoin les navires. L’accueil est plus froid, Mai se montre hautain même dans sa famille. Un malentendu se crée avec des Tahitiens qui souhaitent l’aide des Anglais dans un conflit local. La participation de Mai et de Cook a un rituel au dieu ’Oro renforce la rupture.
Ce chapitre est l’occasion d’évoquer l’affaire des mutins de Pitcairn. Le témoignage d’un des mutins et quelques autres textes permettent de se faire une idée des dernières années de mai à Huahine (Tahiti).
La fable de Tahiti
La mémoire de ces Îliens venus en Europe est restée sous forme d’une fable, un imaginaire du paradis polynésien. Ce sont les traces de cette fable que l’auteur recherche dans les textes. Il analyse les écrits anticoloniaux de Diderot et la place réelle ou fictionnelle des autochtones dans les récits de voyages.
La fiction politique
La question que posent certains textes au XVIIIe siècle, aussi fantaisistes parfois que L’Histoire des révolutions de Tahiti der J.-Ch. Poncelin de la Roche-Tilhac est celle du rapport civilisation/nature, débat des philosophes des Lumières.
L’auteur présente, ce qui est peut-être le premier roman d’anticipation, L’An deux mille quatre cent quarante, rêve s’il en fut jamais de Louis Sébastien MercierDisponible pour les curieux sur le site de la BNF : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6571684d/ et l’origine de mythe du « sauveur blanc ». Une autre trace de la fable tahitienne se trouve dans les romans sentimentaux du XVIIIe siècle dans lesquels un peuple innocent est corrompu par le contact avec les Européens.
Le monde dans un fauteuil
Dans les années 1780, un spectacle Omai ou un voyage autour du monde, à Londres, représente les voyages de Cook. Les décors invitent au dépaysement, un exotisme distrayant.
Adieu à Cythère
La fable a alimenté le discours anticolonial tout en mettant en valeur les connaissances face à l’idée de paradis naturel.
L’auteur rappelle la réalité des rivalités franco-anglaises pour le contrôle e des îles et la colonisation au XIXe siècle.
Le mythe tahitien n’est pas oublié au XXe siècle : Ségalen, Loti, Jack London, Gauguin… Il manque peut-être la référence à Brel. L’image d’un éden polynésien perdure. Les Îliens commencent à répondre au plan politique : Le Front de Libération de la Polynésie d’Oscar Temaru, ou littéraire : Chantal T. SpitzL’île des rêves écrasés, paru Au Vent des Îles en 2004
Dans son épilogue, l’auteur évoque la place de ces voyageurs tahitiens dans la mémoire collective. Longtemps oubliés, ils réapparaissent depuis les années 1970.