

Premiers pas dans la police
Né en 1895, Pierre Bonny est un petit employé bordelais d’extraction rurale. Caporal d’infanterie fait prisonnier de guerre dans la Somme en septembre 1916, il entre dans la police par concours en 1920. Stagiaire à la Sûreté générale de Paris, il est encore un jeune policier peu expérimenté et parfaitement anonyme quand il est impliqué dans l’énigmatique affaire Seznec en 1923. Son rôle y est marginal. Affecté à des tâches de secrétariat et commis à de rares vérifications annexes, il n’est qu’une des petites mains de l’enquête policière. Cela n’a pas empêché les partisans de l’innocence de Seznec de lui imputer le rôle d’un deus ex machina maléfique, en vertu de la funeste notoriété qu’il s’est acquise postérieurement. Ce mécanisme de surinterprétation flagrante s’avère un cas intéressant de mauvaise réputation rétrospective. La récapitulation factuelle rigoureuse des éléments du dossier d’accusation, tels qu’exposés par Guy Penaud, démonte de façon convaincante la légende accusant Bonny. Mettant à mal la thèse de la machination policière présentée lors des procédures en révision postérieures, elle hypothèque aussi plus largement la théorie de l’innocence de Seznec.
Au cours des années suivante, la participation de Bonny, enquêteur audacieux et précis, à la résolution d’affaires criminelles complexes et retentissantes lui vaut de devenir assez vite une célébrité de la chronique policière. Elle lui attire aussi la réputation d’un homme aux talents «spéciaux», apte à traiter des missions politiques à caractère sensible et rémunérées sur les fonds secrets ministériels. Il semble avoir notamment joué un rôle dans la coulisse des manoeuvres d’influence qui permirent la condamnation de l’Action Française par le Vatican en 1926. Il devient ainsi un adepte zélé des méthodes de police parallèle, parfois pour le bien de l’État, parfois pour le compte de commanditaires officieux aux mobiles plus ou moins opaques, et parfois à son avantage personnel. Selon l’avis d’un supérieur qui semble avoir bien cerné le personnage, «quant il s’intéressait à une affaire, on ne savait jamais si c’était pour le bien du service ou dans son intérêt propre». De fait, son profil devient celui d’un policier marron. Car certaines de ses activités sont clairement en marge de la légalité, et mettent en jeu des méthodes douteuses relevant du chantage ou de l’intimidation. Bonny est mêlé à quelques affaires louches potentiellement compromettantes. Dans l’immédiat, ces menées équivoques lui assurent un train de vie très supérieur à ses émoluments officiels.
Le marécage des affaires politico-policières
Le policier d’élite n’est cependant pas infaillible. Il peut même s’égarer aux marges du ridicule : c’est ainsi qu’il s’enferre dans un tissu d’affabulations à l’occasion de la disparition de l’actrice américaine Jeanette MacDonald, avant que l’énigme «people» ne fasse long feu lorsqu’il s’avère que la star est simplement rentrée Outre-Atlantique… Classé politiquement à gauche et proche des radicaux, Bonny a l’imprudence de se brouiller avec son supérieur, le puissant directeur de la Sûreté nationale et futur préfet de police Jean Chiappe. Il n’en est pas moins promu inspecteur principal en 1932. Sa notoriété atteint ensuite son apogée à l’occasion des affaires Stavisky et Prince. Malgré diverses allégations au mieux non corroborées et au pire clairement fantaisistes, Bonny n’a pourtant sans doute ni connu ni même jamais rencontré l’escroc Alexandre Stavisky. Son rôle dans cette affaire, tel qu’il émerge de l’analyse faite par l’auteur, semble globalement constructif. Fin 1933, c’est lui qui fait le lien en identifiant le suspect suite à une commission rogatoire émise par le juge d’instruction de Bayonne. C’est donc logiquement à ses talents qu’est confié le versant parisien de l’enquête. Ses investigations sont actives et efficaces, et Bonny se trouve bien dans la capitale le jour du suicide de Stavisky à Chamonix, en dépit des rumeurs qui lui ont imputé la mort suspecte de ce dernier ! Mais, jouant un double jeu, il tente de compromettre le préfet Chiappe, en s’appuyant sur une déposition officieuse de la veuve Stavisky. Le règlement de compte personnel ne tourne pas en sa faveur. Dessaisi et suspendu, il poursuit néanmoins ses investigations officieusement, tandis que Chiappe perd son poste en raison de sa mollesse face aux manifestations d’extrême-droite. Grâce à un indicateur, Bonny parvient à mettre la main sur les talons des chèques émis par Stavisky, et obtient une réhabilitation professionnelle éclatante en remettant ces indices majeurs aux plus hautes autorités judiciaires.
Peu de temps après, la mort mystérieuse du magistrat Albert Prince, mis en cause dans la longue impunité judiciaire dont avait bénéficié Stavisky, place à nouveau Bonny sur le devant de la scène. Désigné comme directeur d’enquête par le Garde des Sceaux, il échafaude un roman policier fantaisiste qui incrimine deux éminences de la pègre marseillaise, les fameux Carbone et Spirito. Cette fausse piste lui aliène le protecteur politique des deux truands, le sulfureux député Simon Sabiani, et le déconsidère lorsqu’un non-lieu s’ensuit. L’enquête, reprise par le commissaire de la P.J. Marcel Guillaume (qui inspira à Simenon son commissaire Maigret) conclut à un suicide probable. Cet échec est fatal à la carrière de Bonny, discrédité aux yeux de la police, de la presse et de la justice, et poursuivi par la haine influente de Chiappe et Sabiani. Les casseroles de son passé douteux resurgissent. De nouveau suspendu en juillet 1934, il est révoqué début 1935. Le ci-devant as de la police subit même deux périodes d’incarcération préventive et finit par être condamné en justice pour corruption. Le flic déclassé devient un paria aigri. Vivant dans la gêne, il subvient aux besoins de sa famille en publiant des piges dans la presse de gauche (notamment dans le… Canard enchaîné !) et en se reconvertissant en détective privé. Dans le cadre de cette nouvelle activité, il semble avoir joué un rôle dans les coulisses du démantèlement de la Cagoule, en livrant des renseignements aux ministres de l’Intérieur Sarraut puis Dormoy, dont il partage les affinités politiques et dont il escomptait sa réintégration dans la police… ce qui lui fut refusé.
Le numéro deux de la Gestapo française
Dans le Paris de l’Occupation, ses ressources financières se raréfient. Bonny choisit alors de rejoindre le chemin de l’aisance en empruntant ceux du crime et du déshonneur. Les circonstances de son recrutement fin 1941 ou début 1942 par l’officine de la rue Lauriston sont troubles, et constituent peut-être un recyclage après le refus d’un recrutement direct par l’Abwehr. En intégrant l’équipe de truands menée par Henri Chamberlin dit Lafont, l’ex-inspecteur lui apporte ses compétences techniques et son sens de l’organisation. Mélangeant collaboration économique et policière, marché noir et répression, gangstérisme et espionnage, la «Gestapo française» sait faire apprécier l’efficacité de ses services à ses protecteurs allemands. Prenant en charge le fonctionnement administratif de la «Carlingue», Bonny assume aussi le suivi procédural des affaires menées contre la résistance par ses complices. Cet expert en interrogatoires ne répugne pas à brutaliser ses détenus. Devenu le bras droit du malfrat Lafont, il est en relation régulière avec les responsables SS à Paris. Sa participation active et efficace aux actions de répression contre la résistance, et aux brigandages annexes commis par ses associés, est nettement établie. C’est lui qui arrête Geneviève de Gaulle. Il prend aussi part au recrutement des auxiliaires de la Brigade nord-africaine levée en janvier 1944 pour combattre le maquis, et les accompagne en opération dans le Massif Central. Guy Penaud lève enfin le lièvre, assez troublant, des relations entre les gens de la rue Lauriston et le sinistre médecin homicide Marcel Petiot…
Entre le débarquement et la libération de Paris, la bande de la rue Lauriston se disperse. Dans l’espoir d’anéantir toute trace des forfaits commis, Bonny détruit méticuleusement archives et dossiers compromettants. En un ultime et désespéré sauve-qui-peut, Bonny et Lafont se réfugient avec leurs familles dans une ferme du Loiret, en attendant de pouvoir fuir vers l’Espagne. Mais leur cachette est dénoncée par le très avisé trafiquant Joseph Joanovici, soucieux d’effacer les excellentes relations d’affaires qu’il avait entretenues avec les chefs de la rue Lauriston, au temps de leur splendeur, par cette superbe prise qui couronne d’aura patriotique les services qu’il avait su rendre aux résistants de la police. Interpellés dès le 30 août 1944, les deux captifs de haut vol sont soumis à des investigations bâclées, auxquelles Bonny coopère avec loquacité en s’efforçant de minorer son rôle. Réclamé par une opinion publique impatiente, le procès des Gestapistes français a lieu au début du mois de décembre. Neuf des onze prévenus sont condamnés à mort. Le châtiment ne se fait pas attendre : Bonny et ses acolytes sont fusillés le 27 décembre au fort de Montrouge. Nul, hors de sa proche famille, ne déplora cette justice brutale, qui concluait la destinée perverse d’un serviteur inattentif de la légalité républicaine devenu, par soif du gain et appétit de revanche sociale, le valet de l’ennemi.
Une biographie utile
On peut éprouver un certain désagrément graphique face à une maquette peu avenante, et surtout une mise en page élémentaire qui confine au défaut de finition. Le style de l’auteur a parfois la sécheresse -mais généralement la clarté- d’un procès-verbal. Par-delà ces apparences, cependant, le contenu mérite de retenir l’intérêt de qui s’intéresse au contexte troublé des années Trente, aux grandes affaires impliquant Pierre Bonny, et aux avatars de la Collaboration extrême. Car la mise en perspective proposée ne manque pas d’intérêt. Du regard porté par un policier historien sur un policier déviant, se dégage une expertise professionnelle sans complaisance, appuyée sur des sources renouvelées. La prise en compte des dossiers judiciaires et administratifs provenant des archives publiques permet de relativiser les assertions à charge (les accusations de la famille Seznec) comme à décharge (les souvenirs du fils et de l’avocat de Bonny) qui avaient jusqu’alors régné sans contrepoids. Le résultat de cette approche de fond nuance utilement le cliché historique auquel avait jusqu’ici été réduit le souvenir de l’inspecteur indigne. Cela rend concevable non pas la réhabilitation – inenvisageable- de Pierre Bonny, mais sa dédiabolisation.



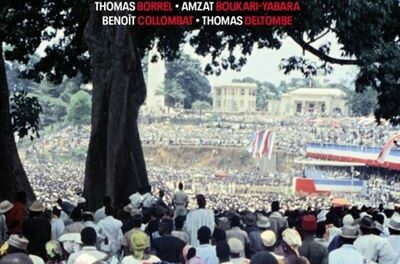










Excellente commentaire de Guillaume Lévèque qui donne envie de lire l’ouvrage de Guy Penaud, car en effet on trouve peu d’ouvrages très rigoureux quant à la vérité historique de Pierre Bony et on passe trop souvent d’un extrême à l’autre. Politiquement, l’évolution de la gauche radicale socialiste (voire communiste) à une collaboration effrénée y compris dès avant 1939 est un phénomène largement documenté chez de nombreuses personnalités de l’époque. Concernant le conseiller Prince, de nombreux témoignages font état du fait que son corps aurait été retrouvé ligoté sur la voie ferrée, si cela est exact la thèse du suicide semble difficilement tenable.