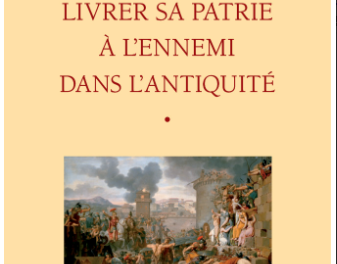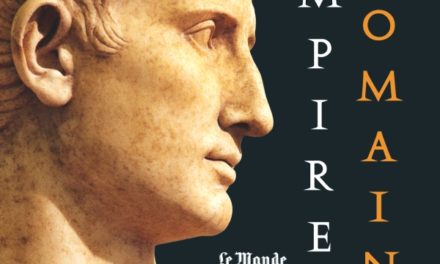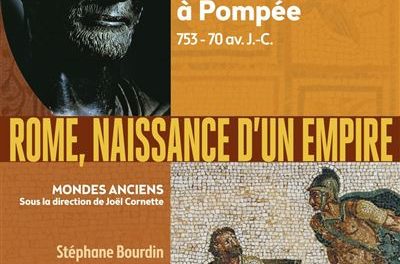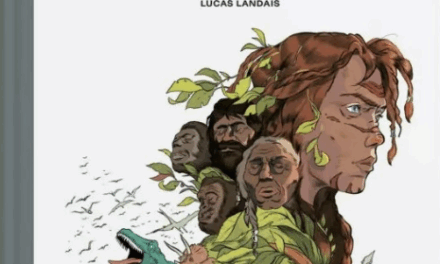« Monsieur, on ne fait pas jouer Platon en deuxième division » aurait répliqué Valéry Giscard d’Estaing à un diplomate, membre du cabinet du président de la Commission européenne, Commission qui s’apprêtait à rendre un avis quant à l’adhésion de la Grèce à la CEE.
Patrice Brun, professeur d’histoire grecque à l’université Bordeaux-Montaigne et membre de l’IUF, évoque nombre de poncifs, préjugés et fantasmes grotesques autour de la Grèce dans le propos liminaire de son ouvrage l’invention de la Grèce, la rédaction de son essai relevant d’une volonté « d’en finir avec une certaine histoire qui invente la Grèce antique, use et abuse d’une Antiquité tronquée à dessein pour mieux orienter un présent selon ses propres pensées (p.9) ».
Dans ses prolégomènes, l’auteur revient sur la fascination exercée par la Grèce sur l’extrême droite française (l’acronyme du groupe de réflexion de la « Nouvelle Droite », le GRECE, étant particulièrement révélateur), certaines élites sociales mais également la gauche, Syriza insistant, par exemple en pleine crise financière, sur l’idée que l’Europe avait une dette morale envers la Grèce, celle-ci ayant inventé la démocratie.
Patrice Brun n’entend mener une charge ni contre la Grèce antique, ni contre la langue grecque, ni même contre une étude analogique du passé mais « contre une fausse exploitation de l’Antiquité destinée, en y puisant des modèles controuvés, à légitimer en conscience et de manière mensongère un désir de présent (p.20-21) ».
Pour ce faire, il a structuré son écrit autour de trois grands axes intitulés respectivement « le monde perdu des Grecs », « un éloignement nécessaire : démocratie antique et démocratie moderne » et « l’incursion du grec et de la Grèce antique dans notre monde ».
Le monde perdu des Grecs
Cette première partie débute par un constat : nous nous reconnaissons comme des héritiers lointains des Grecs.
Patrice Brun choisit, en conséquence, dans ce premier chapitre, de confronter le kosmos des Grecs, leur monde, au nôtre.
Les Grecs, écrit-il, concevaient de manière dichotomique l’espace qui les entourait et ce dans tous les domaines de l’existence, d’où toute une série de « séparations » de type « hommes/dieux », « Grecs/barbares », « hommes/femmes », « jeunes/vieux », « citoyens/non-citoyens »…
Les rapports « jeunes/vieux », « Grecs/barbares » et « mythe/histoire » font l’objet d’une analyse circonstanciée.
Les Grecs ont, plus que nous, insisté sur la différence jeunesse/vieillesse avec un respect particulièrement marqué pour les anciens. La littérature s’en fait l’écho, tant dans l’épopée que dans la documentation épigraphique (Sparte) et thucydidéenne (Athènes).
L’opposition Grecs/barbares commence par un rappel : pour le Grec, le barbare est « quelqu’un ne sachant pas le grec, et rien d’autre (p.29) ».
Cette opposition n’existe pas dans l’épopée homérique et ce sont les guerres médiques qui vont transformer le rapport des Grecs avec leurs voisins. Le thème du barbare, adversaire des Grecs, devient récurrent dans la tragédie au Ve siècle et l’opposition Grecs/barbares amène également à développer une opposition « terre d’Europe » et « terre d’Asie (p.31) ».
Le terme connaît, au IVe siècle, une extension de son sens, ce que l’on retrouve chez Démosthène lorsqu’il dit de Philippe de Macédoine qu’il n’est « pas un Grec (…) » et qu’il n’est « même pas un barbare d’une origine honorable ». Patrice Brun précise qu’il « est inutile d’insister sur le fait que l’immense majorité des Grecs considéraient Philippe de Macédoine et ses sujets comme des Grecs, mais l’on voit le terme de barbare permettre de polariser et d’opposer deux mondes, fût-ce de manière factice (p.35) ».
La dichotomie mythe/histoire est la dernière à être évoquée. L’auteur rappelle avec de multiples exemples que, pour les Anciens, la frontière entre ces deux univers n’était pas la même que la nôtre et que le mythe, pour les Grecs, « était l’histoire d’avant l’histoire, transmise par la tradition orale (p.36) ». Le passage sur les jugements moraux de Thucydide à l’encontre de Cléon et d’Hyperbolos est particulièrement intéressant (p.39-40). En conclusion de ces trois premiers axes de réflexion, Patrice Brun écrit que les Grecs n’avaient pas de scrupule à exclure l’Autre et que notre propension à faire de même nous présente peut-être en héritiers des Anciens.
Nous partageons avec les Grecs une obsession du déclin.
L’antienne du « c’était mieux avant » est aujourd’hui rabâchée régulièrement et les Grecs ont connu cette tendance à regretter le passé et penser le « déclin ».
Ainsi, dans l’Iliade, le poète évoque la figure du héros exemplaire qui pouvait saisir une lourde pierre de sa main, « merveilleux exploit, que deux humains d’aujourd’hui ne pourraient même pas porter ». Thucydide voit encore dans la mort de Périclès « le début d’une décadence dans la qualité du personnel politique athénien (p.49) ».
L’auteur écrit également que l’idée d’un déclin de la Grèce au IVe siècle est devenu une sorte de topos chez des contemporains. On la retrouve chez certains historiens de l’Antiquité mais également chez Nietzsche ou chez un auteur comme Thierry Maulnier qui, écrit Patrice Brun (p.52), « mêle réflexion sur le déclin de l’Occident à des idées sur l’Antiquité grecque proche de celles ayant pignon sur rue durant le IIIe Reich ».
Dernier domaine exploré par l’auteur dans ce premier chapitre : la sexualité. L’auteur rappelle la succession de fantasmes attachée à la sexualité des Grecs de l’Antiquité et que ceux-ci avaient des valeurs différentes des nôtres dans leur rapport au corps.
Après avoir mentionné que le vocabulaire français contemporain touchant au sexe a beaucoup emprunté au grec ancien, Patrice Brun explicite le terme d’ Erôs. Il écrit ainsi qu’en Grèce, « l’erôs se conçoit dans ses deux dimensions, charnelle et sentimentale (p.62) ». Erôs est aussi dieu du désir et de l’élan amoureux. On apprend encore que Démosthène et Aristote ont été également les auteurs d’un Erôtikos, type d’œuvre littéraire vantant « la beauté des garçons (p.63) ».
L’auteur évoque ensuite la pédérastie grecque à propos de laquelle il écrit qu’ elle « est admise par la société et même codifiée dans les relations que l’amant (erastès) et l’aimé (eromenos) doivent avoir, relations affectives et amoureuses, initiatiques aussi, mais, ne nous voilons pas la face, également charnelles (p.66-67) ».
l’homosexualité féminine est ensuite traitée.
La figure de la poétesse Sappho, originaire de l’une des cités de Lesbos, est mentionnée.
Patrice Brun précise que « l’image d’une Sappho initiatrice de l’homosexualité féminine est une construction tardive, datant de l’époque d’Auguste et d’une manière formelle créée par le poète Ovide. Il faut donc penser que le succès des poèmes de Sappho et leur interprétation ont fourni un calage géographique à l’homosexualité féminine (p.77) ».
On apprend encore que pour les Grecs, les relations lesbiennes n’entraient pas dans le domaine de l’érotique et « par conséquent ne pouvaient pas être constitutives d’une accusation d’adultère (p.79) ».
Un éloignement nécessaire : démocratie antique et démocratie moderne
Cette seconde partie est la plus dense de l’ouvrage. L’auteur rappelle que dans l’Antiquité l’ « État Grèce » n’existait pas. Parler de Grèce dans le cadre antique revient à évoquer une culture commune. « Les Grecs », écrit Patrice Brun (p.87), « n’ont pas inventé seulement les mots (la terminologie politique ndlr), ils ont inventé aussi la politique d’abord, la démocratie ensuite et la nécessité de la discuter sur l’agora ou ailleurs en posant des problèmes que nous nous posons aujourd’hui encore. C’est ce qui nous la rend proche à deux millénaires et demi de distance ».
Les Grecs connurent bien sûr d’autres régimes politiques que la démocratie et la démocratie athénienne est le fruit d’un long processus historique.
Dans son exposé, l’historien évoque trois « états démocratiques » de la cité d’Athènes: la démocratie de l’Aréopage (508-461) ainsi qualifiée parce que ce conseil dominait encore les institutions ; la démocratie dite péricléenne et la démocratie radicale (le peuple est véritablement souverain), après la mort du grand stratège et ce jusqu’en 322.
La particularité d’Athènes à la fin du VIe siècle avant notre ère réside dans l’accession au logos, un « art de convaincre le concitoyen qui était aussi un pair, indispensable pour parvenir à une décision acceptable par tous (p.92) », par tous les citoyens.
La parrhèsia, « franc-parler », cette parole libérée, ne va pas sans charrier insultes à l’encontre de ses adversaires politiques et affrontements verbaux extrêmement violents au sein de l’ekklèsia.
Patrice Brun rappelle ensuite que démocratie et impérialisme sont souvent allés de pair et que la démocratie du temps de Périclès à Athènes était le plus impérialiste des régimes. Le petit peuple athénien était très attaché à l’impérialisme dont il tirait avantage et la puissance exercée par Athènes sur d’autres cités était par ailleurs pleinement assumée et justifiée par cette dernière.
Les droits politiques et civiques ne concernent que 10 % de la population athénienne tout au plus et l’Athènes démocratique, écrit Patrice Brun, « ne s’est pas privée de mettre au point tout un arsenal législatif d’exclusion de la vie civique (p.105) » avec l’ostracisme (condamnation à l’exil pour dix ans) et l’atimie (exil définitif).
Sur le plan de la démocratie sociale, Athènes rétribuait les charges publiques mais avait mis en place des mesures venant en aide aux plus modestes : pensions pour les invalides, fils et filles de soldats morts sur le champ de bataille entretenus par la cité jusqu’à leur majorité, misthoi…Et, pour reprendre le mot de l’auteur, Athènes sut « faire payer les riches » avec les liturgies.
Patrice Brun rappelle qu’Athènes est aussi une « démocratie de l’exclusion », un système politique qui fonctionne sur le mode de l’exclusion de tout ce qui n’est pas citoyen.
Les premiers de ces exclus sont les étrangers, les métèques, qui, sauf cas rarissime, ne pouvaient espérer devenir citoyen athénien. Le métèque dispose simplement d’un « protecteur » officiel, un prostatès, pour sa personne et ses biens. Pour les Grecs, en effet, seul le droit du sang légitimait la citoyenneté (p.115).
Les femmes sont également exclues de la vie politique et les textes en offrant une image déplorable sont très nombreux. On attend des femmes, épouses ou veuves de citoyen, qu’elles restent à leur place et qu’elles se taisent, en témoigne cet extrait de l’Ajax de Sophocle cité par l’auteur (p.119) : « la parure (kosmos) des femmes, femme, c’est le silence ! ».
Patrice Brun mentionne le texte du Pseudo-Démosthène (Contre Nééra) qui indique qu’il existe trois « catégories » de femmes : les hetairai (courtisanes), les pallakai (concubines) et les gynaikai (épouses). Le propos, fort intéressant, s’étend ensuite en un portrait de chacune d’entre elles, avec « l’hétaïre » Nééra, la « concubine » Aspasie et l’épouse « parfaite » qu’est Pénélope. L’exclusion politique des femmes reposait sur des considérations patriarcales mais également guerrières, ces dernières ne versant pas « l’impôt du sang (p.133) ».
Les esclaves sont aussi, de facto, complètement exclus de la vie politique. La cité compte plus d’esclaves que de citoyens, des milliers d’entre eux travaillaient dans les mines du Laurion dans des conditions effroyables et Athènes fut la plus esclavagiste des cités de l’époque classique.
Tout esclave pouvait être torturé en toute légalité dans le cadre d’une affaire judiciaire afin d’obtenir son témoignage. L’esclave permet à la démocratie directe athénienne de fonctionner comme elle l’a fait.
Patrice Brun écrit (p.143) que « de la même manière que la démocratie directe pratiquée par les Athéniens est indissociablement liée à l’esclavage, la démocratie sociale permettant à tous de participer à la politique reposait sur l’exploitation des « autres », les alliés ou les ennemis, ce que nous désignons aujourd’hui sous le terme d’impérialisme. C’est tout cela la démocratie antique ».
L’auteur rappelle, à propos de la démocratie directe, que les assemblées du peuple, réunies tous les dix jours environ, ne réunissaient pas une majorité de citoyens. Toujours dans ce cadre, aucune loi ou décret ne pouvaient parvenir directement devant le peuple.
La question du tirage au sort, qui agite encore les débats politiques contemporains, est ensuite abordée. Pour les Grecs, le tirage au sort est une chose naturelle mais que l’on ne peut séparer de sa dimension religieuse. Dans l’Athènes démocratique, le tirage au sort s’appliquait à la justice mais également à nombre de magistratures. L’auteur précise également que tout ne reposait pas sur le tirage au sort et que « pour les charges nécessitant expérience et compétences, on ne laissait ni au sort ni aux dieux le soin de décider : on privilégiait l’élection et on privilégiait aussi les plus aisés des citoyens, car les responsabilités électives n’étaient pas rémunérées (p.159) ».
La collégialité des charges publiques à Athènes interdisait, sur le plan institutionnel, l’apparition d’un pouvoir personnel trop important et le « personnel politique » athénien faisait l’objet d’une forte surveillance.
La guerre en Grèce est une chose naturelle et la paix, écrit l’auteur, « n’est jamais considérée autrement qu’à l’égal d’une simple trêve (p.171) ». Cette violence se retrouve dans la mythologie et les dieux grecs « sont violents, à l’image des hommes qui les honorent (ibidem) ».
Le monde grec est aussi le lieu de l’agôn, de la compétition, de la rivalité permanente, dans le sport mais aussi, par exemple, dans le théâtre.
La guerre est au centre des préoccupations dans les premiers poèmes et l’Iliade en constitue le parfait reflet. Les « crimes de guerre » ont existé lors des combats, à l’instar de l’attitude des Athéniens envers les Méliens en pleine guerre du Péloponnèse ou des Spartiates, en 427, à Platées.
La mort héroïque au combat permettait d’accéder « à une immortalité faite de gloire, seule immortalité à laquelle les Grecs croyaient véritablement (p.184) ». Léonidas et les héros de Marathon en sont l’ illustration. Cette dernière bataille a pu servir « d’encouragement à un héroïsme permanent » mais Patrice Brun écrit que « tout dans l’esprit grec, poussait à la guerre et que les Athéniens en particulier et les Grecs en général n’eurent pas besoin de Thésée, de Marathon ni de Salamine pour glorifier les luttes qui allaient les abaisser définitivement (p.193) ». La guerre est en outre un fort moyen d’enrichissement pour les hommes comme pour les dieux, ce dont témoignent les offrandes faites à certains sanctuaires.
L’incursion du grec et de la Grèce antique dans notre monde
La Grèce aujourd’hui reste envahie par son passé antique. Cette fascination se retrouve, entre autres, dans les diverses commémorations par l’État grec de « grandes batailles » de l’Antiquité.
Notre vie culturelle regorge également de références au monde grec, qu’il s’agisse de la production cinématographique ou des multiples usages, pas toujours heureux, de la mythologie et de l’histoire grecque dans la vie quotidienne.
Suit une présentation du grec ancien et du profil des hellénistes de la part de l’auteur, ce qui lui permet de revenir sur son propre parcours avec une rencontre tardive du grec ancien et une passion pour la civilisation attenante à partir de la troisième année de licence. Le grec est un marqueur culturel et social (mais pas toujours serais-je tenté de rajouter). Patrice Brun écrit qu’il « faut défendre le latin et le grec parce que ce sont des langues de culture à la base de notre langue actuelle (p.221) » et qu’il faut le faire « sans a priori, sans masquer aucunement tout ce qui fait la civilisation antique, dans ses aspects lumineux comme dans ses recoins les plus obscurs (ibidem) ».
Patrice Brun s’intéresse ensuite à l’utilisation de l’histoire et de la culture grecque. L’auteur écrit que « si le XVIe siècle fut avant tout philologique, le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle virent une efflorescence d’œuvres historiques (…) ou philosophiques prenant pour exemple faits et pensées du monde grec (p.226) ». La Révolution va utiliser l’Antiquité et les références aux Anciens vont être intégrées au combat politique. Saint-Just va ainsi louer Sparte lorsque Desmoulins s’avère être un « partisan » d’Athènes.
Les universitaires allemands vont utiliser Sparte et la Macédoine antiques à des fins idéologiques et ce, en toute conscience. Il existe un « mythe grec allemand » qui va aboutir à une forme d’identification de l’Allemagne à la Grèce. L’universitaire Karl Müller va publier en 1824, un livre ayant pour titre Die Dorier (Les Doriens). Ils présentent ces derniers comme des envahisseurs venus du Nord et des Aryens. Patrice Brun écrit que les Spartiates sont « représentés dans l’imaginaire allemand, et pas seulement nazi, comme de beaux Grecs blonds avec les yeux bleus (p.233) ».
Le racisme aryaniste de Müller va faire des émules qui vont voir dans Sparte « l’État « indo-germain » (…) idéal, inégalitaire, eugéniste, militariste, expansionniste. On le comprend aisément, la voie était bien tracée pour le nazisme qui, loin là encore de créer une idéologie de toutes pièces, n’eut dans l’affaire qu’à cueillir des fruits déjà bien mûrs par un siècle de Kultur (p.235) ». L’Allemagne nazie a utilisé la figure du spartiate dans une optique raciste et en vue de réécrire un passé complètement fantasmé.
En France, c’est la figure de Démosthène qui devient presque un modèle de vertu, notamment sous la plume de l’historien Gustave Glotz. Patrice Brun écrit que « Gustave Glotz et ses épigones défendent, au travers de Démosthène, (…) avant tout la démocratie représentative et parlementaire, la République française, face à un Empire allemand intemporel, reconnaissable derrière le voile transparent recouvrant le visage de Philippe de Macédoine (p.240) ». Clemenceau se fendra d’un Démosthène écrit sous le prisme de sa propre action politique. Aujourd’hui, la Grèce antique paraît très éloignée des préoccupations des femmes et hommes politiques et l’ouvrage se termine sur la vision de l’actuel président sur cette dernière.
L’auteur conclue que « nous ne tirerons pas de l’Antiquité des recettes valables pour notre temps et il n’est guère honnête ni utile de s’abriter derrière des pratiques anciennes pour promouvoir ses propres idées ; il n’est pas interdit toutefois de réfléchir à quelques-uns de ses préceptes (p.272) ».
L’ouvrage de Patrice Brun est d’une très grande qualité, alternant réflexions personnelles, traits d’humour pour le moins caustiques et érudition universitaire.
L’historien fait également œuvre utile en démystifiant nombre de poncifs relatifs à la Grèce antique savamment entretenus dans le débat public.
Son essai est à conseiller aux collègues d’Histoire comme de Grec ancien qui y trouveront matière à alimenter leurs séquences.
Grégoire Masson