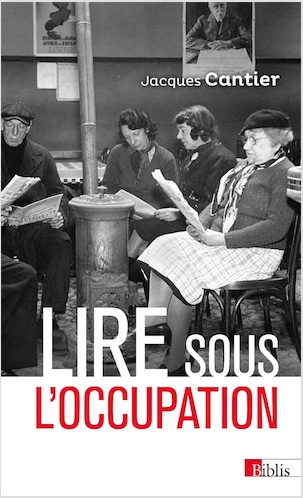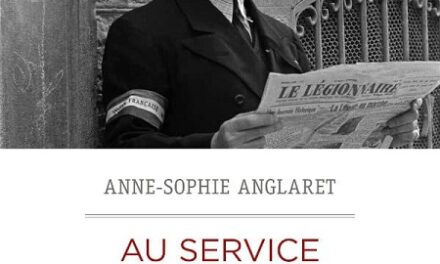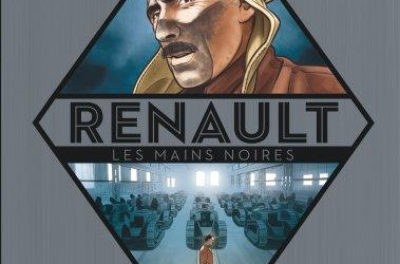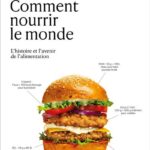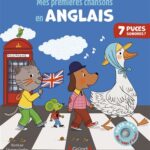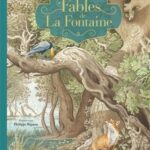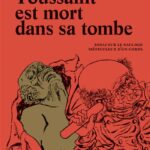Que lisait-on durant la Seconde Guerre mondiale ? Quel rôle a joué le régime de Vichy dans l’orientation des livres publiés ? Quelles stratégies menaient les maisons d’édition face aux contraintes de l’époque ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond cet ouvrage de Jacques Cantier.
La structure de l’ouvrage
Cet ouvrage est l’adaptation du dossier d’habilitation à diriger des recherches de l’auteur. Livres, lecteurs et lectures : le tryptique ainsi proposé amène du matériel au culturel, de l’objet à son usage par la médiation d’un sujet concret. Il est nécessaire d’avoir à l’esprit deux temporalités : le temps long des apprentissages culturels et le temps court du conflit mondial. Cet ouvrage est paru une première fois en 2019. Il s’organise autour d’une partie chronologique, d’une partie thématique et d’un épilogue . Il comprend un copieux appareil de notes, une bibliographie et un index.
La place du livre et de la lecture dans la France de la fin de la IIIe République
Les dynamiques qui ont amené la société française du temps de l’écrit rare et de la lecture minoritaire à la généralisation de l’accès au lire et au livre procèdent de la longue durée. L’ensemble des maillons de la chaîne du livre a été profondément transformé par l’entrée dans l’ère industrielle. La vente dans les gares se développe et un réseau de bibliothèques publiques se met en place. Le « Petit Larousse illustré » devient au début du XX ème siècle une institution. La lecture et son accès est au coeur du projet républicain. Le prestige du livre et de la lecture se retrouve dans les tentatives de construction de bibliothèques idéales. Les prix littéraires constituent une autre façon de parler et faire parler des livres. L’entre deux-guerres apparait comme un palier entre les grandes révolutions techniques et sociales du XIX ème siècle et les nouvelles accélérations de la fin des années 1950. Le paysage de l’édition française se caractérise alors par une grande diversité. On peut relever enfin l’essor des mouvements d’éducation populaire au milieu des années 1930.
L’ordre des livres de la drôle de guerre à l’effondrement de 1940
La dégradation de la situation internationale amène la France à adopter, dès 1938, une loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre. Elle comprend un passage sur les livres et leur protection. Le rétablissement de la censure constitue un autre marqueur du temps de guerre. La « littérature défaitiste » fait l’objet d’une surveillance systématique des censeurs. La place du livre dans la mobilisation culturelle ne se limite pas à la censure. Elle se traduit par l’organisation de la lecture aux armées. On essaye malgré tout de faire comme si les évènements ne pesaient pas sur tout, en maintenant, par exemple, les rituels qui jalonnent la vie du livre comme la remise de prix. Les pratiques de la lecture semblent relever d’une double polarisation : aspiration à l’évasion et aspiration à trouver un sens aux enjeux de l’heure. L’histoire constitue un autre fil conducteur des lectures de la période. Le sort des écrivains mobilisés est lié aux soubresauts de la campagne de France. Beaucoup d’entre eux se retrouvent parmi les centaines de milliers de prisonniers capturés par les forces allemandes.
La vie du livre dans la France occupée : entre contraintes et pénurie
Dès juillet 1940, s’installe un complexe appareil d’occupation comprenant des instruments de tutelle sur la vie culturelle. Les éditeurs français sont invités à une autocensure vigilante. Deux millions de volumes sont par ailleurs saisis en application des listes d’interdiction. Ils sont mis au pilon. La propagande met en place de multiples dispositifs d’influence. L’édition de classiques est le moyen le moins compromettant pour les éditeurs désireux de donner satisfaction aux autorités d’occupation. Le livre est aussi vu comme au service de la révolution vichyste. Une attention particulière est portée aux lectures scolaires. Il ne faut pas négliger la question matérielle avec le problème des ressources en papier. Les contraintes se durcissent en 1942.
La soif de lecture des années d’Occupation
Ce chapitre s’intéresse aux arts de lire diversifiés à partir des traces multiples mais ténues d’une époque qui ignore les grandes enquêtes statistiques. Un accueil favorable est réservé aux ouvrages consacrés à l’histoire immédiate. La collection « Que sais-je ? » est lancée en 1941. Jacques Cantier insiste sur la difficulté de quantifier. On peut noter, par ailleurs, que le prêt des livres dans les bibliothèques de la ville de Paris double entre 1939 et 1942. La « zone blanche » dans laquelle les dépenses de lecture sont les plus faibles correspond au « triangle d’inachèvement » de l’alphabétisation encore visible au début de la Troisième République. Le secteur du livre jeunesse reflète les contraintes de l’époque et ce n’est pas moins d’une douzaine de biographies de Pétain qui sont alors publiées. On se gardera de postuler une adéquation entre l’offre et le goût des lecteurs. Le journal d’Hélène Berr constitue une source essentielle illustrant la part réservée à la vie de la culture dans le quotidien d’angoisses provoqué par la persécution antisémite.
Les tribulations de la communauté des lecteurs professionnels
Le journal tenu tout au long de la guerre par Romain Rolland constitue, par sa richesse, un remarquable témoignage sur la place de la lecture dans l’intimité de l’écrivain. Le monde de la critique littéraire connait un certain nombre de recompositions avec la réduction au silence d’un certain nombre de voix influentes. « Je suis partout » qui se présentait dans les années 30 comme « le grand hebdomadaire politique et culturel » reparaît en février 1941 après huit mois d’interruption. « La Revue des deux mondes » s’inscrit dans l’orthodoxie de la Révolution nationale.
Lire pour reconstruire : un patrimoine disputé
A travers la question de la responsabilité de l’écrivain, c’est celle des effets sociaux de la lecture qui est posée. Le trauma de 1940 redonne une vigueur nouvelle à la dénonciation des livres dangereux. Dans la France morcelée du régime d’armistice, la relecture de la trajectoire historique de la littérature nationale est l’occasion d’une réflexion sur ses fondements géographiques. Différentes figures du panthéon littéraire font l’objet de relectures orientées visant à les glorifier ou à les dénigrer. Il ne faudrait pas oublier non plus le cas de la littérature clandestine. La création des éditions de Minuit constitue une étape essentielle dans la naissance d’une bibliothèque de l’ombre.
Sortir de la guerre
Plusieurs caractéristiques marquent le début de l’année 1944 : radicalisation d’un régime aux mains des ultras, logiques de guerre civile révélées par l’écrasement du maquis des Glières, flambée des prix et difficultés croissantes du ravitaillement. Certains professionnels auraient souhaité mettre à profit la réorganisation générale pour poser le problème de la distribution des livres et du rôle joué par les Messageries Hachette. Des éditeurs cherchent à corriger leur image. René Julliard prend ainsi du champ en fondant en 1943 « Les éditions littéraires de Monaco ». Alors que l’esprit critique officiel se vide de sa substance, l’espace clandestin affirme ses ambitions de relève. La question de l’épuration se pose et plusieurs éditeurs s’empressent de retirer de leur catalogue les titres litigieux et de valoriser les publications honorables. L’épuration des écrivains est aussi à l’ordre du jour. Dans un pays qui place la culture littéraire au coeur de l’identité nationale, la collaboration intellectuelle constitue un crime contre l’esprit. Plusieurs initiatives se mettent en place comme des bibliothèques circulantes.
En conclusion, Jacques Cantier insiste pour montrer que cette étude est une occasion de revisiter sous un jour différent les problématiques de la période. L’auteur n’en souligne pas moins ce qu’il reste à faire sur un tel sujet car, par exemple, bien des zones restent à cartographier. De même, bien des lecteurs critiques ou ordinaires restent à présenter.