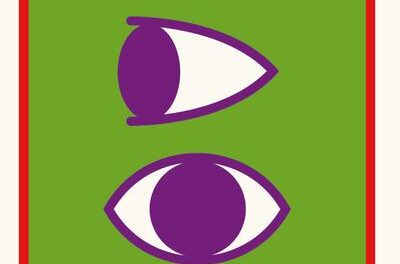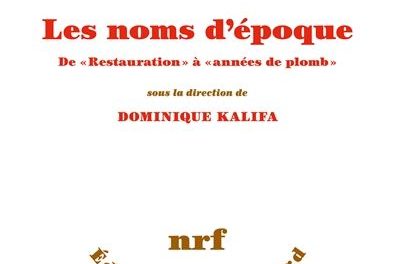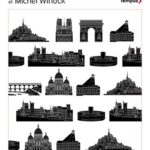La démonstration de Bertrand Müller, professeur d’histoire à l’Université de Genève, porte ainsi sur le travail critique de Lucien Febvre (1689 comptes rendus rédigés entre 1905 et 1957, les trois quarts ayant été publiés dans les Annales), contribution à la fois conciliatrice et clarificatrice à la définition de lignes de partage entre des sciences sociales à l’identité et à la légitimité encore mal assurées.
L’auteur est un bon connaisseur de Lucien Febvre, dont il a commencé par publier une Bibliographie (A. Colin, 1990) avant de s’intéresser à sa correspondance avec Marc Bloch (Fayard, 1994). L’ouvrage en question est la version remaniée de sa thèse de doctorat. L’idée de départ est qu’il y aurait là, dans ces « épluchures » de l’historien à son établi, ce que le co-fondateur des Annales n’a jamais réuni d’un seul tenant : ses idées de et sur l’histoire. Mieux, cette lecture critique quotidienne aurait même contribué à ordonner l’œuvre elle-même, créant un renversement du rapport entre le compte rendu et l’œuvre.
En réalité, plus que le travail critique de Febvre en lui-même, l’ouvrage couvre, avec une certaine ampleur, non seulement l’évolution de cette pratique disciplinaire encore peu étudiée, mais aussi les débats que le développement de l’histoire et des sciences sociales provoqua de la fin du XIXe siècle aux années 30.L’ouvrage s’ordonne autour de quatre chapitres qui sont autant de façons d’envisager l’évolution de la pratique du compte rendu critique : l’invention du compte rendu, les lieux, le moment, la discipline. Un choix de plan difficile, mais qui permet une progression très intéressante dans la mise en place des éléments du débat autour des sciences sociales, même s’il n’évite pas parfois certaines redites.
La genèse du compte rendu dans la sphère épistolaire, son institutionnalisation progressive dans le Journal des Savants (1665), puis dans les Nouvelles de la République des Lettres de Bayle (1684), sont rapidement évoqués et introduisent la politique des comptes rendus de Febvre. En effet, avant même la fondation des Annales, Lucien Febvre, qui collabore à la Revue de Synthèse de Henri Berr, les considère comme des instruments de combat, au cœur de la nécessaire réorganisation du travail historique.
Müller montre bien cependant que Febvre n’est pas tout à fait un novateur en la matière : la Revue critique d’histoire et de littérature fondée en 1866 par Gaston Paris et Paul Meyer l’envisageait déjà comme un mode d’intervention dans le débat historique qui s’efforçait de défendre au nom de l’école positiviste la nécessaire rigueur de la méthode scientifique. Le public visé était alors une minorité de « professionnels de l’érudition scientifique ».
L’Année sociologique de Durckheim offrait un autre modèle, dans lequel le compte rendu s’impose également comme une opération scientifique, le laboratoire critique d’une science en construction, faisant l’inventaire du travail fait et à faire.
On comprend dès lors pourquoi les Annales, créées en 1929 en compagnie de Marc Bloch, réservent une telle importance à la critique bibliographique. D’après Febvre, « l’attribution des livres à critiquer est la première, la plus importante des fonctions directoriales ». Müller note que cette priorité était déjà celle de la Revue d’histoire moderne et contemporaine créée par Pierre Caron en 1899, ce qui témoigne admirablement de la « consolidation intellectuelle et institutionnelle de la discipline historique ».La deuxième partie (« Lieux » ou plutôt « Lucien Febvre en comptes rendus ») commence par évoquer l’activité directoriale au sein des Annales. L’internationalisme des collaborations faisait l’originalité de la revue (surtout en comparaison avec la Revue historique, cette « voix de la Sorbonne » d’après Olivier Dumoulin), mais il diminua. La part prépondérante de Febvre dans le travail de critique bibliographique s’explique aussi par la difficulté de recruter un vivier de collaborateurs.
S’appuyant en grande partie sur la correspondance entre Marc Bloch et Lucien Febvre qu’il a éditée (Fayard, 1994), Müller évoque aussi les divergences entre les deux hommes : Febvre voudrait une revue d’idées, plus vivante, capable de s’écarter du milieu historien professionnel pour résonner aussi dans le monde des affaires. Pendant la guerre, c’est Febvre qui, refusant la disparition de l’entreprise, assume la plus grande partie de l’activité éditoriale ; Bloch préférait en replier l’activité en zone sud, voire recréer une nouvelle revue.Après cette longue présentation contextuelle, Bertrand Müller entre enfin dans le vif du sujet, les comptes rendus des 1946 ouvrages composant la bibliothèque critique de Febvre, dont il commence par souligner la diversité avant de dégager quelques lignes de force comme les Temps modernes, l’économie, les travaux des géographes français, etc. L’étude de l’évolution thématique des comptes rendus entre Revue de Synthèse et Annales est extrêmement fouillée, conforme à sa nature universitaire initiale, mais son manque de mise en perspective comparative (l’ensemble des comptes rendus des Annales ou un autre recenseur comme Bloch, par exemple) assèche un peu l’analyse et rend sa lecture un peu austère.
La troisième partie (« Moments ») est consacrée à l’attitude critique de Febvre. Elle est précédée d’une mise au point sur la normalisation et la codification récentes de la critique historique. L’autonomisation progressive de la littérature entraîne d’abord la professionnalisation de la critique littéraire au cours du XIXe siècle (ex. Taine). Mais il faut attendre la fin du siècle et l’épanouissement de la philologie allemande pour que se rompent les liens entre l’histoire et la littérature et que s’affirment les méthodes de la critique historique.
L’attitude critique de Febvre est ensuite envisagée suivant deux volets : l’histoire et les sciences sociales, ses combats vers une autre histoire.
Après un premier rappel très clair des fondements épistémologiques du débat entre sociologues, historiens et géographes et de la contestation réciproque de leur légitimité à rendre compte du social, la position intermédiaire de Febvre apparaît dans toute sa singularité. Trop jeune en 1903 pour prendre parti dans la controverse entre Simiand et Seignobos sur la question de la causalité en histoire, Febvre entre peu à peu dans le débat après la guerre en reprenant une partie des critiques de Simiand contre la géographie vidalienne : hostile au déterminisme de Ratzel, il pense que la géographie doit restreindre ses ambitions à l’étude des actions de l’homme sur le milieu et non l’inverse. En revanche, il montre bien les difficultés pratiques de l’étude comparative prônée par les sociologues et défend l’idée du choix français de monographies régionales inspiré par Vidal de La Blache, même s’il en critique les prétentions globalisantes.
Müller consacre ensuite deux chapitres à la linguistique ainsi qu’au folklore et à l’ethnographie ; Febvre était convaincu que lorsque les sources écrites faisaient défaut, les mots apportaient des éléments essentiels sur l’histoire culturelle mais aussi celle de l’Etat, de l’économie, etc. Dans le cadre de l’Encyclopédie française qu’il dirigeait, Febvre lança une série d’enquêtes sur tout le territoire afin d’inventorier les pratiques folkloriques et saluait avec enthousiasme le développement du folklore comme discipline dans les années 30. En ethnographie, c’est avec une certaine fascination qu’il rend compte des premiers travaux de Lévi-Strauss, le premier à rattacher l’ethnologie à l’histoire.
Enfin, s’agissant des rapports avec la sociologie, Febvre préféra éviter toute polémique, ne cessant de reconnaître sa dette à l’égard de l’Année sociologique de Durkheim.
La quatrième et dernière partie est consacrée aux combats vers une autre histoire menés par Febvre. Avec minutie, B. Müller restitue les éléments qui en forment l’arrière-plan : la rupture épistémologique constituée par l’œuvre de Durckheim à travers les comptes rendus de l’Année sociologique (3000 de 1898 à 1913 !), puis le déclin de l’histoire dans les années 20 et 30 (crise intellectuelle, institutionnelle, éditoriale) ont puissamment contribué à organiser le combat critique de Febvre. Après les débordements nationalistes et germanophobes liés au conflit, l’histoire doit se reconstruire une nouvelle identité et affirmer son statut de science. On peut enfin apprécier la vigueur polémiste de Febvre contre l’histoire « traditionnelle » (l’histoire événementielle, conformiste et petite-bourgeoise de Seignobos) et son enseignement (Lavisse), l’histoire économique de Boissonnade jugée totalement obsolète et trop abstraite), l’histoire diplomatique fondée sur les archives officielles considérée comme périmée, et ses plaidoyers en faveur d’une histoire économique et sociale vivante, d’une véritable histoire des sciences, d’une histoire des sensibilités. C’est incontestablement la partie la plus intéressante de l’ouvrage, qui montre comment les lignes de rupture traversent cette fois les disciplines elles-mêmes.
B. Müller peut alors resserrer son propos sur la posture critique de Febvre et ce qui en fait l’originalité : « L’histoire, ce n’est pas juger, c’est comprendre », une phrase qui résume toute son attitude intellectuelle (critique de l’histoire politique, distanciation à l’égard du nazisme, aversion pour les manuels qui ne reflètent pas les résultats de la recherche, etc.), qui s’exprime aussi à travers une méthode revendiquant la vertu herméneutique de l’hypothèse : le plus souvent, les recensions de Febvre tournent autour du « problème » posé par l’ouvrage, à partir de ce que l’auteur a écrit, explicitement ou non.
En épilogue, B. Müller renverse son hypothèse de départ : plutôt que chercher dans les comptes rendus ce qui a contribué à ordonner l’œuvre de Febvre, l’auteur se demande s’il ne faut pas plutôt considérer les livres de Febvre comme de longs comptes rendus : on s’arrêtera sur cette idée de l’unité du principe d’écriture et de la démarche intellectuelle (l’histoire s’écrit à partir d’une problématisation critique).
Au final, on a là un ouvrage dont la lecture gagne considérablement en intérêt au fur et à mesure que les termes du débat se précisent. Certes, le prix est parfois celui d’une certaine austérité, mais une telle présentation contextuelle était sans doute un passage obligé avant de mesurer tout à fait l’originalité de la pratique de Febvre.
Un regret peut-être, concernant l’absence d’évaluation du retentissement de ces comptes rendus. Mais comment pourrait-on mesurer leur influence réelle ? D’après quelles sources ? Quelle fut la part réelle de Febvre dans le renouvellement des études historiques en France ? Dans quelle mesure son œuvre critique a t-elle contribué à la dissociation progressive de l’enseignement et de la recherche ? B.Mûller apporte peu d’éléments de réponse. Certes, il évoque bien l’isolement des Annales par rapport aux réseaux internationaux de l’histoire économique, l’imperméabilité de Seignobos aux virulentes attaques de Febvre parues dans la Revue de synthèse ; en revanche, il avance prudemment que les propositions de Febvre en faveur du travail collectif n’ont certainement pas été étrangères à l’accélération de l’institutionnalisation de la recherche (création du CNRS en 1939).
Voilà en tous cas un ouvrage à lire, sur l’exigence intellectuelle d’un historien à l’exceptionnelle ampleur de vues. Les appels de Lucien Febvre en faveur d’une véritable histoire sociale nous invitent à une réflexion salutaire sur l’épistémologie de l’histoire et sur notre pratique d’enseignant. Lutter contre une histoire historisante, intégrer les acquis de la recherche à l’enseignement, adapter à la demande sociale les contenus et les méthodes de l’enseignement, voilà des pistes de réflexion essentielles si on veut échapper à l’enseignement d’un savoir figé.
CR de Stéphane Haffemayer,