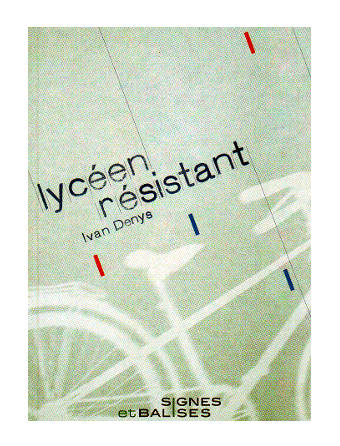
L’ouvrage d’Ivan Denys, né en 1926, agrégé de lettres classiques, médaillé de la Résistance, est un des tous premiers livres de sonr catalogue. Il s’agit d’un témoignage, celui d’un jeune lycéen, entré très tôt en résistance, au double sens de son âge (14 ans en 1940) et du début de son activité (il participe modestement à la manifestation du 11 novembre 1940). Mais c’est aussi un récit de ses années d’enfance, une évocation de la vie à Paris sous l’Occupation, et le témoignage d’une participation aux événements de la libération de Paris. C’est un petit ouvrage, fort bien écrit, dont l’auteur ne cherche à aucun moment à exagérer son rôle. Il se compose de quatre chapitres : un très bref récit du 11 novembre 1940 tel qu’il fut vécu par ce jeune garçon, une évocation de son enfance jusqu’à la drôle de guerre et à l’exode, le récit de ses activités de résistance à Paris, celui de sa participation à la libération, une brève évocation de l’immédiat après-guerre en guise de conclusion.
« Nous avons bravé les interdictions, nous avons célébré le 11 novembre »
Le 1er octobre 1940, Ivan Denys est en troisième au lycée Janson de Sailly. Le 11 novembre « une rumeur se répand dans la classe, court à travers le lycée pendant la récréation de dix heures. C’est le 11 novembre, le lycée est ouvert et nous avons cours ! (…) Le gouvernement de Pétain a décidé de l’ignorer, d’en faire un jour ordinaire ! (…) Nous sommes indignés (…) Curieusement, un élève, que nous n’avons jamais entendu parler de De Gaulle, nous offre pour une somme minime, un franc peut-être, de petites croix de Lorraine en cuivre, a épingler à la boutonnière de notre veston (…) Des bruits divers circulent dans la cour : il y aura, malgré l’interdiction, une manifestation (…) À la sirène de 4 heures, nous nous précipitons en nombre -une dizaine de notre classe- vers le portail, au milieu d’une foule de « grands » qui l’ont forcé, malgré les efforts des surveillants. Cette sortie massive, joyeuse, de plusieurs centaines d’élèves de 13 à 20 ans a des allures de reconquête de la liberté (…) Place de l’Étoile, sur le terre-plein entre les avenues Victor-Hugo et Kléber, une foule de jeunes nous masque en partie l’Arc de Triomphe (…) Nous sommes cloués sur place. Nous chantons La Marseillaise. Brusquement, après quelques dizaines de minutes, on entend de lourds bruits de moteurs qui s’approchent. S’agit-il de tanks, de camions allemands ou de la police ? On discute, on s’interroge. Impossible d’atteindre l’Étoile, impossible d’atteindre l’Arc de Triomphe : on se replie -sans se sentir vaincus. »
Enfance
L’auteur a vécu son enfance et son adolescence « entouré de femmes : mon arrière-grand-mère, ma mère et ma grand-mère maternelle ». Sa grand-mère avait épousé un Suisse francophile. Veuve, elle vint s’installer en France avec sa fille et son jeune petit-fils. En 1932 toute la famille s’installe à Paris. L’auteur évoque ses vacances d’été chez ses grands-parents, au bord du lac de Neuchâtel. Son grand-père paternel lui apprend La Marseillaise et L’Internationale. En 1934 sa grand-mère l’inscrit dans les classes primaires du « petit lycée » Janson-de-Sailly. Il prend conscience des événements politiques en 1934 et surtout durant l’été 1936, dans une famille plutôt de gauche qui, durant l’été 1939, s’installe dans un village de Normandie. L’année 1939-1940 fut pour lui « une année de vacances prolongées ». L’exode les conduits jusqu’à Châteauroux, et, quand sa grand-mère entend le maréchal Pétain affirmer qu’il faut « cesser le combat », elle considère immédiatement qu’il s’agit d’une trahison. De retour à Paris, il découvre les réalités de l’occupation : cartes d’alimentation, froid de l’hiver, présence des soldats allemands etc.
Résistance
Au cours de l’hiver 1940-1941, avec quelques camarades, Ivan Denys fait « circuler des feuilles dactylographiées, parfois de simples bouts de papier manuscrit, avec des mots d’ordre : il s’agissait surtout d’extraits de textes rédigés par Edmond Lablénie, professeur de lettres, qui exprimait ses sentiments sur la situation dans de petits écrits diffusés clandestinement d’octobre 1940 à octobre 1941 sous le titre Notre droit. Il s’en prenait surtout à l’esprit de résignation qui avait gagné beaucoup de Français. Il s’efforçait de mobiliser ses lecteurs en fustigeant la collaboration. »
L’auteur raconte tous les petits gestes et les petites actions qui sont la manifestation d’un esprit de résistance et qui constituent les premiers pas vers une action de résistance de plus en plus structurée, dans le cadre d’une organisation qui se constitue elle aussi très progressivement autour du professeur Lablénie : chahut lors de la venue de représentants du gouvernement de Vichy, inscriptions sur les murs, participation à ce que la BBC avait appelé « la campagne des V » qui consistait à tracer des V de la victoire un peu partout, distribution de tracts. C’est aussi la découverte de la politique antisémite et de l’exclusion de camarades juifs, qu’il faut protéger et cacher. L’année suivante le professeur Lablénie confie la distribution de numéro ronéotypées de l’Université libre, organe des universitaires résistants, fondé en octobre 1940 par Jacques Decour, Jacques Salomon et Georges Politzer, à Ivan Denys et quelques camarades qui constituent désormais un véritable petit groupe.
À partir de 1943, alors qu’il entre en classe de terminale, en philo, son activité devient une véritable activité de résistance : il est intégré dans une organisation qui est celle du Front National pour les lycéens de Paris, il est membre d’un « triangle », il reçoit des tracts et des journaux à Belleville, doit les transporter, les stocker chez lui, puis les transmettre aux responsables de divers groupes afin qu’ils soient distribués. Lorsque un responsable du Front National lui demande, le jour de ses 17 ans, s’il veut adhérer au parti communiste, « je répondis oui, sans hésiter ». « Il faut replacer ce oui dans le contexte de l’époque. Nous sommes en guerre, avec une seule préoccupation : libérer la France du nazisme et de la honteuse collaboration. L’essentiel, c’est l’efficacité. Or sur ce plan, le parti communiste est alors la formation la plus forte, la mieux structurée, la plus dynamique, la plus active. » Il devient responsable du Front National étudiant pour le lycée Janson. Il prépare et participe à des prises de parole au sein du lycée afin d’inciter à la résistance. Il a aussi la charge de distribuer des lots importants de journaux et de tracts aux responsables des groupes du Front National étudiant dans les lycées avec lesquels il a le contact.
Libération de Paris
Durant l’été 1944, avec des camarades, il procède à de petites opérations de sabotage sur des camions de la Wehrmacht et à deux tentatives réussies de récupération d’armes, l’une d’elles conduisant à abattre un officier allemand, ce qui lui fait connaître la peur et « la conscience dramatique d’avoir tué un homme pour la première fois -et d’ailleurs la seule- de ma vie ». C’est aussi l’arrestation et l’exécution quasi immédiate de son meilleur camarade.
Puis c’est la fiévreuse préparation des événements de la libération. Le Front National universitaire doit occuper le ministère de l’Éducation nationale et y installer son responsable, le psychologue Henri Wallon, désigné par le Gouvernement provisoire de la République française.
Immédiat après-guerre
Ce court dernier chapitre s’intitule « Amitiés-Espérances ». Ivan Denys appartient désormais à la cellule Lettres et psychologie du parti communiste de la Sorbonne, il est en hypokhâgne au lycée Henri IV et passe l’essentiel de son temps libre à la Maison de l’université. Il participe à un voyage en Yougoslavie en 1946 et y découvre la misère. Peu après Tito est devenu un traître, et il accepte les arguments officiels du parti communiste : « Je ne peux que m’étonner, avec le recul, de mon manque d’esprit critique, de jugement personnel. » Militant, ils vend Clarté et L’Humanité dimanche dans la rue parisienne. « De la nuit noire où régnait la mort surgissait maintenant avec intensité le désir de lutter, le goût de la vie. Nous avions confiance en l’avenir un avenir de paix… Nous attendions le bonheur et nous y croyions. »
Ici s’arrête le témoignage, sans que rien ne nous soit dit de l’évolution politique ultérieure de l’auteur. Mais il ne s’agit pas d’une autobiographie, et ce n’est pas l’esprit de la collection.













