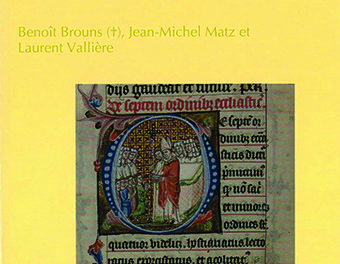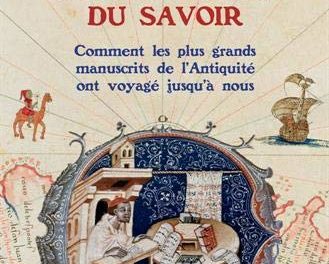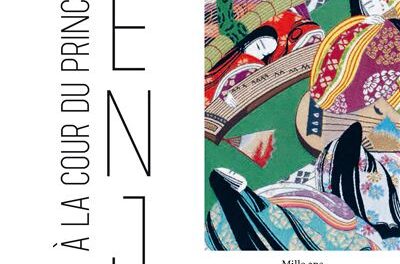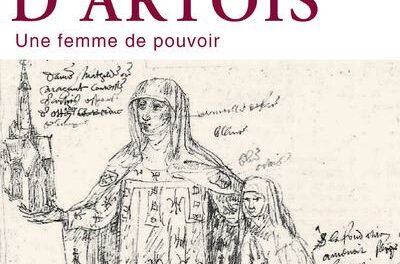On ne peut que se féliciter de la parution de ce manuel consacré à un moyen d’expression original du Moyen Âge occidental, à savoir les signes emblématiques inventés à partir du milieu du XIIe siècle et promis à un succès spectaculaire dans toutes les strates de la société médiévale. L’auteur en est Laurent Hablot, titulaire de la chaire d’emblématique occidentale et directeur d’études à la IVe section de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), où il succède à Michel Pastoureau − ce dernier étant bien connu du grand public pour ses publications sur la symbolique du Moyen Âge, mais aussi pour ses travaux de longue durée sur les couleurs ou les animaux.
L’ouvrage est un très bel objet, vendu de surcroît à un prix raisonnable : avec plus de 150 illustrations en couleurs, il donne une grande place à l’iconographie et offre une mise en page particulièrement soignée. Sa lecture n’est pas toujours aussi simple que ne le laisserait penser le terme de « manuel » : le sujet lui-même et son vocabulaire bien spécifique rendent la matière complexe. Le glossaire technique en fin de volume est en ce sens très précieux. Le lecteur s’y réfère régulièrement au début, puis de moins en moins au fur et à mesure de l’avancée de la lecture et de l’intégration de ces notions techniques (on signalera quelques oublis cependant, comme celui de l’« écartelé » ou de la « livrée »). Les lecteurs non spécialistes apprécieront aussi de disposer de dossiers commentés, de l’analyse détaillée de certaines figures et de sources textuelles venant à l’appui du discours iconographique, un code couleur aidant à discerner le texte théorique des étude de cas. Enfin, les orientations de recherche à chaque fin de partie, visant à inciter étudiants et universitaires à travailler sur le sujet, renvoient à une bibliographie polyglotte ample et diverse, accompagnée de sites, de blogs et de bases de données, comme ARMMA, SIGILLA et DEVISE dont l’auteur est le coordinateur.
Des apports majeurs
Laurent Hablot intègre donc sans exclusive dans cet ouvrage tous les signes d’identité présents dans la société médiévale et moderne, du XIIe au XVIe siècle. Cela concerne l’héraldique, définie comme la science étudiant les armoiries, et l’emblématique, à savoir l’étude de l’ensemble des signes identitaires. Il y a là un point épistémologique majeur. En effet, la distinction entre héraldique et emblématique, traditionnellement considérées comme des « disciplines sœurs » (y compris dans la préface de Michel Pastoureau), tend donc à se diluer au cours de la démonstration de Laurent Hablot, qui considère les armoiries comme un signe emblématique parmi d’autres.
La question des origines des armoiries est revisitée, en défiant l’idée reçue selon laquelle l’emblème héraldique serait apparu dans les années 1140 « sur le champ de bataille pour distinguer le cavalier devenu méconnaissable sous son haubert et son casque à nasal » (p. 25), une explication d’ailleurs reprise par Michel Pastoureau dans sa préface. La diffusion de ce signe sur le bouclier des chevaliers se ferait, selon l’auteur, à l’occasion de tournois dans la France du nord et sans doute lors des croisades, avant que la housse du cheval ne devienne un nouveau support d’armoiries au XIIIe siècle. La cérémonie d’adoubement constitue un autre vecteur de diffusion de ces armoiries, créant pour le nouveau chevalier une variante de l’armoirie de son parrain (entraînant la partition des écus, c’est-à-dire sa division en deux parties, dextre et senestre).
En tout cas, l’ensemble de la chevalerie est pourvue d’armoiries vers 1250, avant que d’autres groupes sociaux ne s’emparent à leur tour de ces signes identificatoires : en effet, les armoiries ne sont pas l’apanage de la noblesse, ni même des individus, puisque des personnes morales (abbayes, corporations…) en utilisaient aussi, d’où une prolifération spatiale de ces signes qui envahissent l’espace public, qu’il soit profane ou sacré, à la fin du Moyen Âge.
La réponse à la question : « À quoi servent les armoiries au Moyen Âge ? » (p. 47-108) montre parfaitement le côté novateur de l’approche développée par l’auteur et démontre les vertus de la « nouvelle héraldique » : elle s’intéresse à l’histoire sociale (la parenté, la justice, les élites) comme à l’histoire symbolique autour des identités, du pouvoir, de la mémoire, de l’imaginaire… L’auteur met en exergue les apports majeurs de ce renouvellement épistémologique, toujours expliqué par le recours à des images et des cas concrets, un renouvellement qui emprunte largement à l’anthropologie historique.
À partir du milieu du XIIIe siècle, des systèmes « para-héraldiques » se développent pour répondre à de nouveaux besoins politiques et sociaux. Ils complexifient progressivement les créations iconographiques et utilisent de nouveaux objets selon de modalités renouvelées de représentation : c’est le cas des cimiers, couronnes, des supports ou des cris, à l’exemple de ceux représentés autour des armoiries sur l’image de couverture (visible ci-dessous).
Une étude de cas
Comme on pouvait s’y attendre d’un livre étudiant la communication à travers des signes graphiques, cette image de couverture apparaît particulièrement bien choisie pour cerner plus aisément les différents types d’emblèmes successivement analysés au long de ce manuel (pour sa présentation, on se référera à la page 236 du livre).
Extraite d’un ouvrage commandité vers 1480 par Jean de Derval, l’image présente au centre l’armoirie de ce noble breton, que l’on retrouve plus lisible à gauche du texte placé au dessus de l’image. L’armoirie se décrit en ces termes : « Écartelé au 1 et 4 de Bretagne alias d’argent à cinq mouchetures d’hermine posées 2, 1, 2, et de Rougé (d’argent à deux fasces de gueules) ». Elle se retrouve fréquemment reproduite dans les manuscrits, les sceaux, les tapisseries ou les vitraux du château de Jean de Derval, car ces supports matériels constituent les principales sources de la matière héraldique. Comme toujours, cette « armoirie » est constituée de motifs simples aux couleurs vives, selon un montage plus ou moins complexe qui respecte des règles strictes.
Au dessus de l’armoirie, se trouve un heaume surmonté d’un cimier, c’est-à-dire un casque de chevalier entièrement fermé et surmonté de figures symboliques : ici, il s’agit d’une tête de maure intégrée dans un « vol aux armes » (en forme d’ailes). Le cimier se généralise dans les représentations à partir des années 1330, comme un héritage des casques peints, et il apparait désormais sur les sceaux des nobles et chevaliers. À y regarder de plus près, le cimier de Jean de Derval emprunte à un mode de représentations des armoiries, l’écu penché timbré. L’armoirie représentée sur un support de drap est en effet inclinée, tandis que le casque décoré reste droit. Ce standard de représentation héraldique va connaitre un succès grandissant dans le cadre des tournois et des joutes, y compris pour les « sans-armes ». Beaucoup de ces cimiers n’ont qu’une fonction simplement ornementale, à l’exemple de la tête de maure de Jean de Derval. Pourtant les cimiers qui peuplent les livres armoriaux à partir du XIVe siècle sont conservés sur plusieurs générations : sans pour autant être un substitut de l’armoirie, le heaume coiffé du cimier devient un signe emblématique personnel. L’usage de cet attribut est considéré comme un privilège nobiliaire, au point que les législations royales en Europe tentent d’en limiter l’usage au cercle des seuls nobles.
La présence de la couronne royale à fleurons sur le heaume du noble breton Jean de Derval a de quoi surprendre. En effet, cet attribut princier apparaît coiffant un écu au moment où se cristallise le concept de Couronne, au milieu du XIIIe siècle, même s’il faut attendre Charles V pour que le motif de l’écu royale couronné devienne un emblème fréquent dans le royaume de France. Il est vrai que les ducs de Bretagne utilisent aussi cette couronne fleuronnée pour affirmer leur pouvoir régalien face au roi de France qui leur conteste cette prérogative. Sa présence au dessus de l’écu de Jean de Derval a peut-être à voir avec la promotion de sa seigneurie comme l’une des neuf baronnies de Bretagne quelques décennies plus tôt, à moins qu’il ne fonctionne aussi comme un rappel de la parenté de son épouse Hélène de Laval, petite-fille du roi de France. En marge de cet écu armorié, se trouvent deux autres signes qui font office de supports ou de tenants : il s’agit ici d’une femme et d’un homme sauvage. Quand ce ne sont pas des animaux qui servent de tenants, comme la sirène ou la licorne, l’homme sauvage et la pucelle forment le couple privilégié de ces supports, parce qu’ils représentent la force brute virile face à l’innocence courtoise, autrement dit les deux facettes de l’identité chevaleresque.
Encore au-delà, deux phylactères mettent en exergue le « mot » de ce grand seigneur, « sans plus », placé de chaque côté de la composition. En effet, l’emblématique s’étend aussi à des signes écrits : ces courtes sentences se retrouvent inscrites dans ces images, au même titre que les devises, jurons et autres cris. Ces derniers rappellent la dimension sonore de l’emblématique : qu’ils soient des cris de guerre, des cris d’armes (ou cris seigneuriaux), puis plus tard des cris nationaux (France, Bourgogne, Bretagne…), ils furent d’abord utilisés lors des conflits ou des tournois, avant de trouver leur place dans la panoplie héraldique.
Ces « mots » ne doivent pas être confondus avec la « devise » proprement dit, qui est en ensemble de signes constitués d’images, de sentences, de lettres et de couleurs : ce sont autant des emblèmes qui renvoient à la personne du prince que des symboles qui expriment ses idéaux. Ils empruntent massivement au monde animal et végétal, mais aussi à la foi, l’amour, les astres… Rien d’étonnant dès lors que ce code emblématique complémentaire des armoiries ait été le support de discours de « propagande », en particulier lors de conflits de la fin du Moyen Âge. On les retrouve sur les étendards et sur les livrées, à savoir les premiers vêtements uniformes, aussi bien à la cour que sur les champs de bataille.
Ces devises sont en fait à relier aux premiers ordres de chevalerie qui apparaissent à partir du milieu du XIVe siècle, d’abord en Angleterre avec l’ordre de la Jarretière. À cet égard, Jean de Derval était chevalier de l’ordre breton de l’hermine et de celui de l’Épi, comme on le voit au folio 293v du même manuscrit où un portrait de groupe le montre au centre arborant un collier orné de ces emblèmes. En effet, l’auteur considère rapidement l’apparition des portraits individuels à la fin de la période, même s’il les présente comme étant à la marge des systèmes emblématiques, de même que les signatures personnelles et les signes collectifs, tels les marques professionnelles.
Un manuel de référence
On pourra repérer dans le texte quelques rares fautes d’orthographe ou coquilles, comme aux pages 220 (où le château de « Suscinio » est devenu « Suscino ») ou 222 avec l’oubli du « en » avant l’occurrence. Sur le plan de l’analyse, c’est sans doute pousser trop loin l’interprétation que d’affirmer que la figure du XVe siècle montrant un homme pendu à l’envers, à côté de ses armoiries, renvoie au suicide par pendaison de Judas (page 72) ; dans les images médiévales, ce dernier n’est pas représenté suspendu à l’envers, mais bien pendu par le cou, tandis que sa langue sort de sa bouche et que ses viscères s’échappent de son ventre.
Ces quelques remarques anecdotiques n’enlèvent rien à l’ampleur de la synthèse proposée et à l’originalité des approches. Elles ne proposent pas un traité d’héraldique à l’ancienne, mais traitent à parts égales l’héraldique et l’emblématique. Elles ne conçoivent pas cette histoire longue de la panoplie emblématique comme une « science auxiliaires de l’histoire », mais comme une histoire globale du second Moyen Âge, caractérisé par des évolutions et des innovations permanentes. Elles ne considèrent pas tous ces signes iconographiques comme de simples moyens d’identification de personnages ou de groupes, mais comme des marqueurs du statut social, des signes d’affiliation politique, des outils de droit, des marqueurs eschatologiques. Quant à la brève mais percutante conclusion, elle ne fait rien moins que sérier toutes les règles au fondement des « systèmes emblématiques », ouvrant ainsi la voie à une histoire comparée et mondiale des emblèmes.