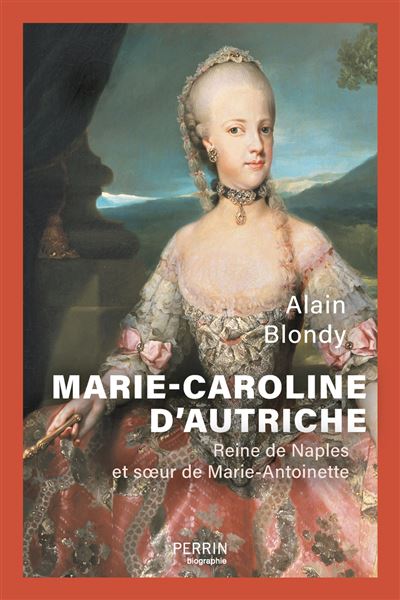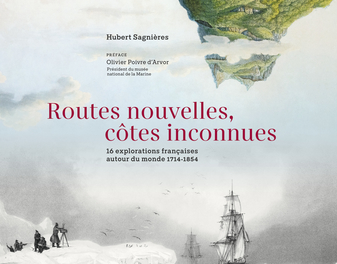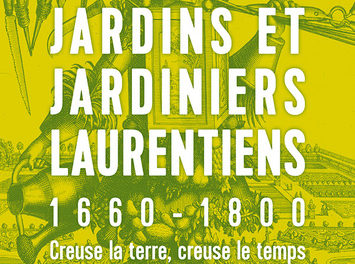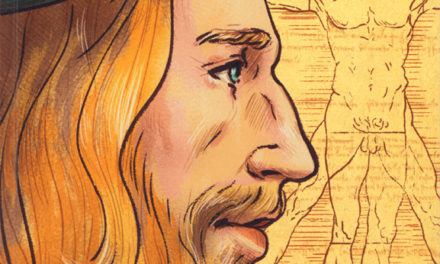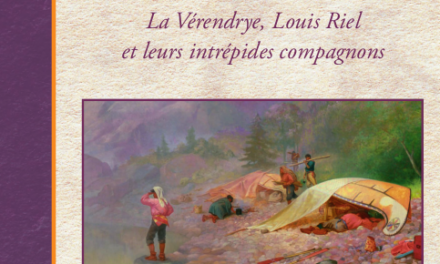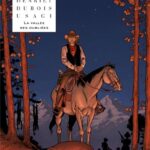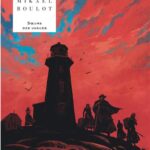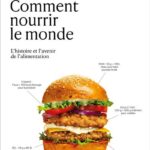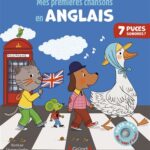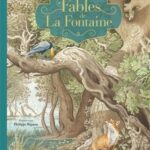Alain Blondy se propose de retracer la vie et l’œuvre d’une femme peu connue, bien que sœur de Marie-Antoinette. Cet ouvrage, consacré au royaume de Naples dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est une biographie minutieuse de Marie-Caroline de Habsbourg-Lorraine tant dans sa vie politique que familiale.
Insouciance et illusions 1752-1770
Cette première partie retrace la jeunesse et les premières années du mariage de la fille de Marie-Thérèse d’Autriche.
L’auteur la situe dans la lignée des Habsbourg avant de décrire la vie à Vienne de la jeune princesse, sa formation intellectuelle. On la suit dans sa traversée de l’Italie pour son mariage.
Les premiers mois avec un mari inculte et violent ne furent pas heureux, mais la jeune princesse tenait à son rôle de reine. Elle s’oppose à Bernardo Tanucci, le conseiller du roi Charles de Bourbon puis de son époux Ferdinand IV.
Audace et ambition 1771-1786
En une quinzaine d’années, la jeune reine assoit son pouvoir. Elle commence par se débarrasser de Tanucci, en s’appuyant sur les réseaux maçonniques et grâce à la naissance d’un héritier. Tout en s’éloignant de l’influence de sa mère.
Pour asseoir son autorité, Marie-Caroline doit aussi se libérer de la tutelle du roi d’Espagne Charles III. L’auteur évoque la participation des Napolitains au siège de Gibraltar, aux côtés des Anglais.
Il décrit la vie de la cour à Naples.
Confrontée au conflit qui oppose les Bourbons aux Habsbourg, elle se mêle au jeu des alliances dans les années 1780.
Alliances et révolutions 1786-1794
Dans cette période troublée, comment se situent le royaume de Naples et la reine ?
Elle s’éloigne des Bourbons et se rapproche de l’Angleterre. Les échos de la Révolution l’incitent à se séparer des libéraux. L’auteur décrit une diplomatie de médiation : guerre russo-turque, attentive aux émigrés français.
Les relations avec la jeune république française sont houleuses : blocage de la baie de Naples par la marine française, rupture des relations diplomatiques après la mort de Louis XVI, participation à la première coalition.
A l’intérieur, elle mène une politique répressive contre les libéraux et les francs-maçons qui l’avaient longtemps soutenue.
Menaces et oppositions 1795-1799
C’est d’abord la guerre avec la France (campagne d’Italie de Bonaparte) jusqu’à la paix du 10 octobre 1796. Après quelques mois, Marie-Caroline relance une alliance avec l’Autriche, mais refuse une alliance trop visible avec l’Angleterre de peur de la réaction française, du moins jusqu’à la victoire de Nelson à Aboukir.
La guerre avec le Directoire (chute de Naples en décembre 1798) la contraint à se réfugier à Palerme. Dans cette période troublée, une courte république (janvier-juin 1799) s’installe à Naples, tandis que les campagnes, comme ailleurs dans la péninsule italienne, les campagnes demeurent fidèles à la royauté. L’opposition ville/campagne facilite la reconquête royale, suivie d’une répression sanglante du « triumvirat de la haine » : Marie-Caroline, Nelson, Emma Hamilton.
Exils et déceptions 1800-1814
Marie-Caroline apparut alors comme « une harpie sanguinaire ». Déconsidérée, elle décide de quitter Palerme pour Vienne, retrouvant ainsi sa fille, l’impératrice, tandis que le prince héritier exerce le pouvoir à Naples, pris dans les diverses influences européennes et les ambitions de Bonaparte. Dans les remous de l’Europe Marie-Caroline connaît un second exil à Palerme et des mois de désillusions dans sa lutte contre Joseph Bonaparte. Lorsque Murat devient roi de Naples (1er août 1808), cela marque la victoire de Napoléon et la déchéance de Marie-Caroline malgré le soutien anglais.