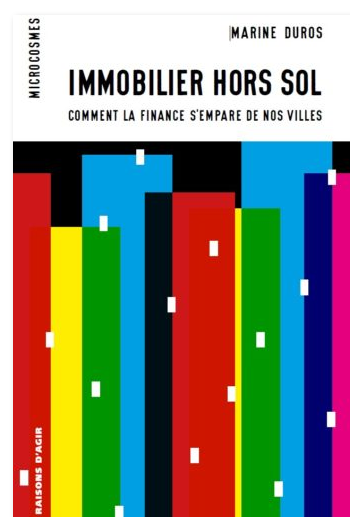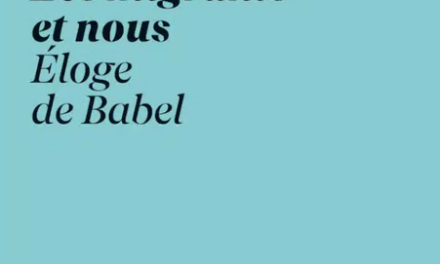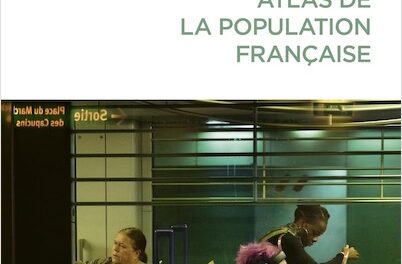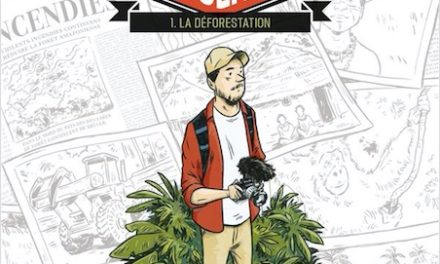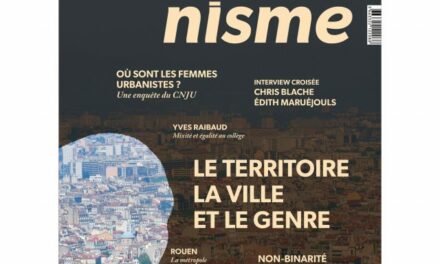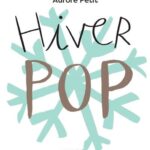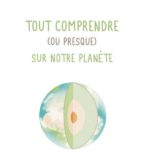La situation du logement évoquée dans cet ouvrage s’articule autour d’un paradoxe : la demande de logements sociaux est non pourvue tandis que l’offre d’immobilier d’entreprises n’arrive pas à trouver suffisamment de preneurs. En France, ce sont 9 millions de m² d’immobilier qui sont vides.
C’est à l’appui de sa thèse sur le sujet que Marine Duros expose les rouages de cette « financiarisation urbaine » réellement structurelle, la baisse de la demande de bureaux du fait du COVID n’était qu’une légère variation d’une tendance bien établie.
Si l’entreprise a, dès le XIXème siècle, commencer à financer la ville, la nouveauté tient à l’ampleur du phénomène mais surtout à la création de fonds d’investissements immobiliers qui génèrent de nouveaux acteurs.
Pour reprendre David Harvey, le capital se déploie dans l’espace pour éviter de se dévaluer, ainsi l’immobilier est une solution spatiale.
L’immobilier de bureau apparait moins entravé de contraintes réglementaires que le logement, ce qui facilite son développement. Tout cela accroit la pression foncière.
Il y a une dimension psychologique réelle à vouloir toujours construire, investir sans penser au risque d’éclatement de bulles immobilières.
La chronologie début aux années 1990, virage où l’immobilier passe du statut de « bien patrimonial » à celui « d’actif financier ». Au départ, la Caisse des Dépôts et Consignations et différentes compagnies d’assurances se voient privatisées et commencent à investir plus massivement dans l’immobilier d’entreprise sous forme « directe » mais aussi en « pierre papier » (avec des parts dans des SCPI).
Le changement de paradigme est également spatial : on ne cherche plus tellement à réduire les inégalités territoriales mais on veut à tout prix faire de Paris une « super championne » en espérant le ruissellement ailleurs. Il fallait bien se placer dans la compétition entre métropoles et être suffisamment cher. Les prix augmentent massivement sur toute la décennie 1980 et la surproduction est manifeste à partir de 1991.
La vision se veut moins à long terme qu’à court ou moyen terme.
A partir des années 2000, les prix réaugmentent et les actions en faveur du droit au logement, bien que légitimes, ne semblent pas pouvoir changer la donne.
L’Etat se désengage du secteur étudiant et du secteur de la santé, ce qui donne du champ au privé pour proposer son concours. Dans le même temps, la loi SRU (solidarité renouvellement urbain) se voit assouplie. Les formations, notamment les Master sur le sujet immobilier, se développent. L’immobilier forme un club très fermé, un entre-soi surtout localisé dans l’Ouest parisien et avec une déontologie toute relative.
Les cabinets de conseil mettent en scène la bonne forme du marché, non sans un humour convenu, pour que tout le monde soit confiant. Le façonnement d’indicateurs flous à l’aide de besoins supposés des utilisateurs et une prospective toujours optimiste contraste avec des informations plus sombres qui sont données en « off ». D’où la nécessité de savoir lire entre les lignes mais de donner aux potentiels acheteurs l’image d’un marché sain.
Les bureaux apparaissent surévalués de 30 % dans le quartier central des affaires de Paris et de 20 % en région Ile de France. C’est le Haut Conseil de la Stabilité Financière qui l’évoque mais le « secteur » réfute. Les prix sont redescendus après éclatement d’une bulle immobilière.
Plusieurs catégories d’investissements coexistent en fonction du niveau de risque et de la potentielle plus-value : du « CORE » (des immeubles neufs dans des quartiers d’affaires) au « OPPORTUNISTIC » (des bureaux vides en seconde couronne).
Montrer que l’on achète cher pour espérer recevoir davantage de propositions d’offres est une stratégie qui se veut courante.
L’ORIE (observatoire régional de l’immobilier d’entreprise) lance en 2024 un groupe de travail « Que faire des millions de m² de bureaux vacants en Ile de France ? ». La proposition de la réversibilité des bâtiments pour en faire des logements apparait séduisante. La taxation des bureaux vides et l’assouplissement des règles sont des pistes aussi pour aller vers cette flexibilité des usages. Mais il y a toujours le spectre du virage dans l’autre sens avec une « industrialisation » de la transformation qui pourrait amener à la surproduction de « résidences services ».
La conclusion tourne autour de l’idée que l’action des acteurs du secteur se fait par lobbying direct ou de façon plus détournée (intégrer l’ORIE, les formations universitaires…) pour ainsi arriver à leurs fins. Les bulles immobilières, de ce fait, sont inévitables. Qui gagne au final ? Les gérants de ces fonds d’investissement et leurs intermédiaires. Le système d’un salaire fixe avec bonus sans jamais de malus aide aussi à perpétuer le jeu. Les investisseurs institutionnels et les riches ménages y trouvent leur compte aussi. Mais les perdants sont les locataires moins fortunés qui voient d’ailleurs les coûts augmenter. Le coût écologique et social est également considérable.
Agir peut se faire dans le cadre des GPII (Grands projets inutiles et imposés) et dans le cadre d’une production de contre-expertise. Mais ce n’est pas simple ! Se réapproprier le vide urbain se fera en faisant appliquer les lois sur les réquisitions de logements. L’urbanisme transitoire est une dernière piste qui a des visées sociales et écologiques. Taxer les multipropriétaires, amener des malus sont aussi des pistes.
Une solide étude de la part de l’auteure qui, comme indiqué en annexe méthodologique, a su « inverser la logique » en se faisant recruter un temps comme stagiaire dans un cabinet de conseil immobilier. Le statut de doctorante, rarement valorisé, a ici été un atout pour l’image de l’entreprise.